★ L’ANARCHISME AUJOURD'HUI
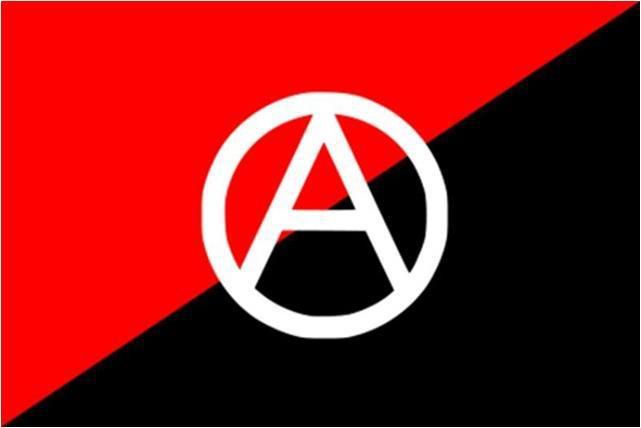
L’Anarchisme aujourd’hui, par Jean Barrué – 1970.
INTRODUCTION
On ne trouvera pas dans les pages qui suivent un exposé de la doctrine anarchiste : l’anarchisme, en effet, n’est pas une doctrine rigide, avec ses articles de foi, ses tables de la Loi, ses Prophètes et aussi ses excommunications, ses procès en hérésie et ses exécutions capitales… Il existe cependant un fonds commun d’idées et de principes, sur lesquels accorder tous les anarchistes, et les diverses tendances de l’anarchisme manifestent entre elles plus de communion spirituelle que les sectes issues du marxisme : je vois plutôt les anarchistes devisant amicalement dans le jardin d’Épicure et les prêtres de l’actuel communisme se lançant l’anathème dans les conciles de Byzance à propos du sexe des anges.
Ce sont ces principes communs que j’ai essayé de dégager, aussi bien de la pratique des luttes ouvrières que de l’œuvre des philosophes de l’anarchisme et tout particulièrement des écrits de PROUDHON et de BAKOUNINE; On ne trouvera donc pas dans ces quelques pages une « histoire » de l’anarchisme : il n’y sera pas question des précurseurs de l’anarchisme et je ne ferai que de brèves allusions à l’œuvre de Stirner, Kropotkine, Malatesta et au socialisme libertaire de Landauer.
Je considérerai surtout l’anarchisme dans ses rapports avec le mouvement ouvrier et je n’étudierai pas le comportement des anarchistes dans la vie sociale, cette morale anarchiste à laquelle reste associé le nom de Kropotkine. Cette lacune, due à la nécessité de limiter mon sujet, ne doit pas faire oublier au lecteur que l’anarchisme est une philosophie qui non seulement interprète et veut transformer la société et l’économie, mais encore embrasse toute les créations de l’esprit et tous les sentiments de l’individu.
Traitant des idées essentielles de l’anarchisme, j’ai dû laisser de côté les réalisations ou tentatives de réalisation survenus en Ukraine, à Cronstadt, en Espagne : disons simplement que l’Oeuvre de l’Anarcho-Syndicalisme espagnol s’inspire du fédéralisme et de la gestion ouvrière directe, fondements de l’anarchisme . On ne s’étonnera point si je confronte longuement l’anarchisme avec le marxisme et les partis qui se réclame du marxisme. Je pense avoir été objectif, mais qu’il me soit permis de dire, une fois pour toutes que je considère les léninistes, trotskyste et autre maoïstes comme les pires ennemis de la classe ouvrière et que je n’oublie pas les innombrables compagnons anarchistes poursuivis, emprisonnés ou assassinés dans le monde par les policiers du Communisme international.
J’espère que mes camarades anarchistes retrouveront dans ces quelques pages des idées qui leur sont familières et ne m’accuseront point d’avoir défigurer l’anarchisme. Mais même si je n’avais exposé que « mon » anarchisme, qu’on se rassure ! je n’ai à craindre aucune excommunication, je n’aurai à prononcer aucun mea culpa, et je n’ai eu à solliciter aucun « imprimatur ».
JEAN BARRUE - AVRIL 1970.
★ L’ANARCHISME AUJOURD’HUI
MÉCONNAISSANCE DE L’ANARCHISME
Anarchisme, anarchie, anarchiste : quelles images ces mots évoquent-ils chez ce français moyen qui déteste le percepteur mais respecte le gendarme, n’aime pas rempiler mais court aux revues du 14-Juillet, méprise les parlementaires mais accomplit scrupuleusement son devoir électoral ? Pour ce bon citoyen, l’anarchisme est le fauteur de désordre, le criminel ou l’illuminé qui ne comprend pas que ces révolutions appartiennent au passé et qui rêve de barricades, d’incendies et de massacres. Pour les indulgents, l’anarchiste est un fol utopiste, un pèlerin de l’absolu : il veut la liberté, comme si l’on pouvait vivre sans autorité et sans gouvernement ; il veut l’égalité, comme si une société était concevable sans riches ni pauvres ; il veut la fraternité, comme si – les choses étant ce qu’elles sont ! – il ne fallait pas d’abord songer à ses petites affaires ! Au diable ce songe-creux qui voudrait ployer les lois qui font rouler les mondes !
Ceux qui se piquent de quelque connaissance en histoire anecdotique évoquent Ravachol, les attentats, les bandits tragiques… Peut-être certains regrettent-ils d’être nés trop tard et de n’avoir pu faire partie de cette foule sadique qui, à Choisy-le-Roi et à Nogent-sur-Marne, assistait avec une joie féroce à l’agonie de ces hors-la-loi traqués par les forces de l’ordre.
Rares sont ceux qui, renonçant aux idées toutes faites et à la petite histoire, étudient l’anarchisme en tant que philosophie, doctrine économique et organisation d’une société rompant avec l’absurde, avec les privilèges injustifiés et les autorités abusives. Certes, l’anarchisme c’est d’abord la foule de tous ces combattants obscurs qui sont tombés victimes des États bourgeois ou prétendus socialistes. Mais c’est aussi, dans le monde des idées, l’œuvre de ces philosophes, penseurs et militants qui ont défini les principes essentiels dont se réclament les anarchistes et tiré de l’action ouvrière, de ses victoires et de ses défaites les enseignements utiles pour l’avenir. Étudier l’anarchisme, ce serait d’abord – en nous bornant aux plus grands noms- lire les œuvres de Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkine, Élisée Reclus, les écrits des militants du syndicalisme révolutionnaire, et il faut reconnaître que le mouvement anarchiste a bien peu contribué à la diffusion de tous ces textes. Stirner, connu bien tard en France, a bénéficié de quelques tirages aujourd’hui épuisés et ses écrits autres que « l’Unique et sa propriété » n’ont jamais été traduits. On trouve en librairie quelques œuvres de Bakounine, mais l’édition critique monumentale des écrits de Bakounine, publiée par l’institut d’histoire sociale d’Amsterdam, est loin d’être achevée. quelques rares textes de Kropotkine, Reclus, Pelloutier, Pouget, Griffuelhes sont encore – difficilement accessibles. Seul Proudhon bénéficie d’une édition complète de ses œuvres. Quant aux anarchistes et socialistes antiautoritaires allemands tels que Mühsam et Landauer, ils sont inconnus en France.
Il faut donc un réel effort pour étudier la pensée anarchiste. Au contraire, les moindres écrits de Marx, Engels, Lénine, Trotsky sont assez largement répandus. Certes, je n’affirme pas que les adhérents des partis ou des sectes dissidentes qui se réclament du marxisme aient lu les œuvres des prophètes, mais enfin ils ont la possibilité de le faire… On me dira qu’il a paru, et qu’il paraît, surtout depuis quelques années, des ouvrages traitant de l’anarchisme. Hélas! si tous ne font pas preuve d’un dénigrement systématique, ils présentent souvent l’anarchisme d’un point de vue non anarchiste et il faut faire toute réserve sur cette tendance à concilier marxisme et anarchisme : déjà avant 1914, Fritz Brupbacher avait publié dans « la Vie Ouvrière » un article intitulé : Social-Démocratie et anarchisme, ce qui montre que cet essai de conciliation n’est pas nouveau ! Les écrivains bourgeois ont dénaturé a plaisir l’anarchisme, on ne peut relever ici toutes les insanités écrites sur Proudhon et Bakounine : le lecteur trouvera dans l’introduction à « La Réaction en Allemagne » quelques échantillons de cette prose délirante. Mais les marxistes, depuis Marx jusqu’au moindre pisse-copie de « l’Humanité », n’ont rien à envier aux porte-plumes de la bourgeoisie. Marx a exécuté ses trois bêtes noires – Stirner, Proudhon, et Bakounine – en deux mots péremptoires : Lumpenproletariat et Kleinbürger. Il est entendu une fois pour toutes que les anarchistes défendent le prolétariat-en-guenilles et sont des petits bourgeois. Pour la définition de ces termes, ne pas s’adresser au communiste du coin mais se reporter aux œuvres complètes de Marx ! Faut-il donner d’autres exemples ? J’ouvre l’édition allemande du « Que faire ? » de Lénine, parue à Berlin-Est, en République démocratique allemande, et je trouve des renseignements biographiques effarants sur Proudhon et Bakounine. Passons…, mais je lis aussi que « Bakounine, comme il représentait les intérêts du prolétariat en guenilles et de la petite bourgeoisie, réclamait la destruction de l’état » ! Et Proudhon – en vingt lignes ! – est traité trois fois de « petit-bourgeois » et deux fois de « réactionnaire » ! Autre exemple : un certain Helms – frère ignorant dans l’Église marxiste – a déposé à la suite d’une édition de « l’Unique et sa propriété » une postface où la mauvaise foi l’emporte sur l’incompréhension. (Carl Hansen Verlag – 1968). On apprend avec étonnement que Stirner justifie le capitalisme et le meurtre et qu’il confond la classe ouvrière « avec le prolétariat-en-guenilles, avec ces petits bourgeois prolétarisés! » Méditer sur ces associations de termes donne le vertige…
A l’égard du rôle des anarchistes dans la Révolution russe, en Espagne, le mensonge et la calomnie sont de rigueur. Il est entendu, une fois pour toute, que les anarchistes furent « objectivement » des auxiliaires de la contre-révolution et du fascisme. Et ces falsifications éhontées de l’histoire sont antérieures au stalinisme. Voici comment « l’Annuaire du Travail » (bibliothèque communiste – 1923) liquide les paysans de Makhno et les marins de Cronstadt : sous le titre La guerre des bandes, on réunit pêle-mêle comme agent de la contre-révolution Savinkov, Petlioura, Makhno, les gardes blancs finlandais et les vaincus de Cronstadt. Cette sale besogne bénéficie de la bénédiction de Lénine, Trotsky, Kamenev, Radek, etc., Qui ont écrit certains chapitres de cet « annuaire ».
Mais il s’agit là d’une caricature de l’anarchisme presque « littéraire », présentée dans des ouvrages où les intellectuels de service font assaut de dialectique et de jargon. A un échelon inférieur – si l’on peut dire ! – on trouve la presse communiste officielle : là, les anarchistes sont tout simplement des agents provocateurs, des repris de justice, des policiers, la lie de la population. Toutes ces aménités étaient d’usage courant en mai 1968 : il serait d’ailleurs ridicule d’attacher à ces insultes une importance quelconque. Entre marxistes-léninistes les propos injurieux sont de tradition : traîtres, vendus à l’intelligence Service, vipères lubriques. Chez ces gens là, insulter et tenter de déshonorer l’adversaire est un procédé que Marx n’évita pas toujours.
Mais il y a d’autres raisons à cette méconnaissance de l’anarchisme. Les anarchistes ne forment pas un parti monolithique et, tout en restant fidèles à quelques principes essentiels, ils se divisent en bien des tendances plus encore au début de ce siècle que dans la période actuelle. Certains anarchistes s’orientent plus particulièrement vers la Libre-Pensée, vers le pacifisme, ver la non-violence, jadis vers l’antimilitarisme, l’illégalisme, la fondation d’ateliers libertaires. Et j’oublie les malthusiens, les partisans de l’amour libre, les végétariens. Toutes ces activités sont compatibles avec l’anarchisme, mais ne sont pas nécessairement l’anarchisme. En mettant l’accent sur telle ou telle de ces tendances, les compagnons ont rendu un mauvais service à l’anarchisme proprement dit et en ont donné une image déformée pour le public mal instruit de ces questions. Aussi dans tout ce qui suit, il ne sera plus question de ce côté « anecdotique » de l’anarchisme
L’anarchisme ? l’emploi de ce terme ne serait-il pas une cause de la méconnaissance de nos idées ? Certains camarades le pensent et rejettent le mot anarchie qu’évoque pour le Français moyen l’idée de désordre, de pagaïe, de chaos (comme dirait le Général !). Ils préfèrent le terme de Socialisme libertaire, de Socialisme anti-autoritaire. Si Proudhon s’est proclamé anarchiste, Bakounine a peu employé ce terme et opposait le collectivisme anti-autoritaire au Socialisme d’État, ou communisme. Pour ma part, je crois qu’on peut indifféremment user des deux termes d’anarchiste et de libertaire en français. Mais, en allemand par exemple, freiheitlich traduit à la fois libéral et libertaire. L’emploi de anarchistisch permet d’éviter des périphrases pénibles – et ridicule ! travers dans lequel tombe la petite revue libertaire « Neues Beginnen », fondée récemment à Hambourg et qui s’intitule à la fois : publication des Socialistes anti-autoritaires, dans un esprit libéral de gauche, démocratique et socialiste libre. Le seul mot « anarchiste » serait préférable à ce pathos…
ACTUALITÉ DE L’ANARCHISME
Cet anarchisme, trop souvent défiguré et mal connu, est brusquement entré en mai 68 dans l’actualité. Dans les manifestations de jeunes étudiants et ouvriers, on a vu apparaître à côté des drapeaux rouges le drapeau noir, ce signe de ralliement des anarchistes. ET cette humble étoffe noire a crée dans le public un choc psychologique : déchaînant l’indignation des bien pensants de toute obédience, frappant d’étonnement ceux qui croyaient l’anarchisme à jamais enterré, et faisant naître chez certains le désir de s’instruire et de pénétrer la pensée libertaire. En France, et surtout en Allemagne, on a rééditer quelques ouvrages de Bakounine. Divers écrits ont paru donnant de l’anarchisme une vue parfois correcte, parfois tendancieuse. On constatait la présence de l’anarchisme, la survivance, disaient les plus malveillants. On ne peut nier que beaucoup des idées qui furent énoncées, discutées, passionnément approuvées ou contestées durant les journées de mai 68, étaient des idées libertaires… Il se dégageait des jeunes une méfiance totale à l’égard des partis traditionnels et tout particulièrement du Parti communiste qui tirait les ficelles de la C.G.T. et pratiquait un double jeu opportuniste. On dénonçait au cri de « Élections-Trahison » ce maquignonnage qui conduisait, pour assurer, l’ordre électoral, à condamner tout désordre dans la rue. On opposait à l’économie capitaliste et au communisme d’État autoritaire et totalitaire l’autogestion des entreprises par la classe ouvrière. Je sais bien que ces idées étaient confuses, que souvent le « mot d’ordre » se substituait à l’idée, que l’autogestion nécessite une longue étude du fonctionnement de l’économie. Mais ne jetons pas la pierre à tous ces jeunes qui, animés par un enthousiasme entraînant, pensaient en anarchistes plutôt qu’en marxistes-léninistes. Qu’il y ait eu, qu’il y ait encore confusion dans les esprits, ce n’est que trop certain. On a vu dans les manifestations en Allemagne promener les portraits de Lénine, Trotsky, Che Guevara, Bakounine, Ho-Chi-Minh et Naos ! dans l’Association des étudiants socialistes allemands (S.D.S.) et dans l’opposition extra-parlementaire (I.) qui sont t deux groupements nettement gauchistes, il y a des camarades anarchistes à tendance maoïste ou néo-marxiste. En France, il est difficile d’établir à l’intérieur l’U.N.E.F. des différences idéologiques bien nettes entre ceux qui se réclament du P.M.U.., de Rouge, de Mao-Spontex, ou d’un vague anarchisme.
Cette confusion dans les esprits aurait pu disparaître si, dans les milieux de jeunes, on avait depuis 1968 étudié avec sérieux le mouvement ouvrier, les avatars du marxisme, l’évolution de l’U.R.S.S. Malheureusement, l’histoire est assez mal vue : on oppose à l’étude l’action, l’activisme. Mais toute action qui se prétend révolutionnaire n’est qu’une agitation stérile si elle ne repose pas sur une connaissance solide du passé des luttes ouvrière.
L’ignorance dans ce domaine conduit tout droit à l’ aventurisme plein de bonnes intentions mais qui fait le jeu des pires adversaires. Combien de jeunes acclamant l’auto-gestion , les conseils ouvriers, c’est à dire fédéralisme économique, se sont laissés embrigader par les trotskystes qui luttent, paraît-il, contre « la bureaucratie ». La moindre connaissance de Trotsky, ennemi juré des syndicats ouvriers, partisan de la dictature impitoyable du parti, bourreau de la Commune de Cronstadt, aurait empêché ces adhésions inconsidérées. L’expérience n’est pas fonction de l’âge, elle s’acquiert – avant l’épreuve de la vie – par l’étude de l’action ouvrière. Ainsi pourrait éviter le recommencement de ces erreurs tragique qui, en Russie, en Espagne, à Cuba, ont conduit à l’écrasement et à l’assassinat des anarchistes naïvement associés aux communistes dans la lutte révolutionnaire et confiants dans leurs promesses.
Les anarchistes ont mal profité des événement. Ils ont laissé passer l’occasion de faire pénétrer systématiquement leurs idées dans des milieux qui au départ, étaient nettement sympathisants. Quand on ne pratique pas la politique de la présence, on est vite oublié. Et c’est ce qui explique les succès indéniables qu’ont remportés les sergents recruteurs du trotskisme. Même le Parti communiste, malgré l’évidence de sa trahison, profitant de la carence de ses adversaires, à spectaculairement progressé dans le milieu étudiant et dans les syndicats de l’Enseignement. De cette évolution imprévue, le mouvement anarchiste porte une lourde responsabilité : le petit nombre des anarchistes n’explique pas tout. Il y a dans le mouvement anarchiste une certaine répugnance à discuter, à bagarrer avec les politiciens démagogues prodigues de mensonges, un certain mépris à l’égard du travail ingrat de recrutement. Il y a eu aussi, à l’égard des jeunes et surtout des étudiants, ce sentiments de supériorité du militant « instruit » sur le néophyte enthousiaste mais ignorant « des grands principes de l’anarchisme ». Hélas ! je n’exagère pas. La petite revue libertaire « Neues Beginnen » (voir plus haut) a publié un article où les gauchistes de la S.D.S. et de l’A.P.O. sont traités d’auxiliaires du fascisme en des termes que ne désavouerait pas le stalinien le plus orthodoxe !
Mais je tiens à éviter tout malentendu : le fait d’être anarchiste n’entraîne aucune obligation capillaire ou vestimentaire. Il n’y a pas un uniforme de l’anticonformisme. Sans nier l’importance du problème sexuel et de l’érotisme, il n’en faut point faire le fondement de l’anarchisme. L’individu et le couple ont une vie extérieure et privée qui concerne chaque individu et chaque couple. Je pense que ces problèmes sont étrangers à un exposé des principes essentiels de l’anarchisme dont l’aboutissement est, avant tout, une transformation radicale de la société et du monde actuels.
TRANSFORMER LE MONDE… QUI LE TRANSFORMERA ?
Seuls, des naïfs ou des fous peuvent avoir l’intention de « changer le monde ». Telle est l’opinion d’abord des privilégiés qui bénéficient de l’organisation ou ayant compris son absurdité et son injustice, sont découragés avant même de lutter et s’abandonnent à une résignation impuissante ou a l’espoir d’un au-delà consolateur. Il reste ceux qui n’acceptent pas et dont la non-acceptation conduit à la révolte : qu’ils appartiennent au groupe des privilégiés ou à celui des victimes. Et ainsi, à toutes les époques de l’histoire, sont apparus des fabricants d’utopies, des réformateurs qui essayaient de décrire la Cité idéale. Rêveries rarement suivies d’action, puis conduisant à des protestations et à des revendications de plus en plus précises, et après un long cheminement, la Révolution française supprime les derniers restes de la féodalité et transforme politiquement la société.
Mais sans une révolution économique, les changements réalisés apparurent bientôt fragmentaires, sinon illusoires. C’est dans la voie d’une transformation radicale de la société que s’engagèrent avant 1845 aussi bien ces socialistes français, qu’on qualifie – avec quelque malveillance – d’utopistes, que Proudhon, Marx et Bakounine. On les traite souvent de froids doctrinaires, de théoriciens sensibles seulement à une logique inhumaine. On oublie alors cette indignation qui s’exprime aussi dans les premiers écrits de Proudhon, que dans ceux de Marx et de Bakounine. Indignation devant cette accumulation de misères et de souffrances qui marque la naissance de capitalisme : surexploitation de la classe laborieuse, travail des enfants, sous-alimentation dans des taudis, chômage, répression impitoyable des grèves. Transformer le monde, c’est donc autre chose que l’application d’une théorie : c’est mettre fin à des injustices et à des inégalités intolérables, c’est délivrer de l’esclavage économique ceux qu’on commençait à appeler les Prolétaires.
On peut considérer les « thèses sur Feuerbach », écrites par Marx au printemps 1845, comme le point de départ du « marxisme » ou, si l’on préfère du socialisme dit scientifique. et le dernier paragraphe de ces thèses affirmait de façon fracassante : les philosophes n’ont fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différente manières. Il s’agit maintenant de transformer. Qu’on ne s’étonne pas de voir le marxisme intervenir dans une étude de l’anarchisme. En effet, depuis un demi-siècle, des mouvements révolutionnaires ont bouleversé le monde et se sont réclamés – à tort ou à raison ! – du marxisme : ils ont tous mis l’anarchisme hors-la-loi ! il nous est donc difficile de nous désintéresser du marxisme. D’autre part, les anarchistes, et tout particulièrement Bakounine, ont toujours rendu hommage à la vaste intelligence, à la ténacité, à la puissance de travail de Marx et reconnu la valeur d’un ouvrage comme le « capital ». Ils n’acceptent pas toutes les prophéties marxistes et ils constatent que Marx, par certains silences, certaines affirmations, certaines ambiguïtés, a permis à ses disciples d’instaurer, au nom même du marxisme, des régimes qui sont une caricature du socialisme. Ceci étant dit, il faut souligner les points communs qui existent entre le marxisme et l’anarchisme, tous deux jugeant nécessaire la transformation du monde.
Une pièce fondamentale du marxisme est le matérialisme historique ou mieux le matérialisme dialectique. Il ne s’agit point d’une philosophie de l’histoire mais d’une théorie ramenant les divers facteurs historiques à être subordonnés à un facteur unique : les rapports de production (c’est-à-dire les conditions économiques) forment l’infrastructure de l’histoire et sont à l’origine de la division en classes, de l’État, du Droit, des sentiments moraux, des habitudes, en un mot de toutes ces idéologies dont l’art, la science et la religion ne sont que des reflets. L’histoire (l’histoire moderne, tout au moins, précisera Engels en 1886) est une histoire de lutte des classes. Le but de l’histoire est l’émancipation économique et l’avènement d’une société sans classes : la classe exploitée et opprimée ne peut plus s’affranchir de la classe qui l’exploite et l’opprime, sans affranchir en même temps et à tout jamais la société entière de l’exploitation, de l’oppression et des luttes de classes. (Engels, Préface de 1883 au « manifeste communiste ».)
Si l’on énonce ce qui précède comme une loi abstraite et rigide, analogue à une loi physique, on en arrive à dire que l’histoire se réduit à une histoire économique : ainsi sombrent dans le ridicule les disciples ignares qui sous le moindre fait historique cherchent l’infrastructure économique responsable ! Marx ne doit pas être rendu responsable de ses descendants dégénérés…
Dans l’ensemble, l’anarchisme s’accorde là-dessus avec le marxisme, tout en faisant remarquer que Proudhon lui aussi a exprimé des idées analogues. C’est ainsi que Bakounine écrit en 1871 dans « Dieu et l’état » : … Oui, les faits priment les idées ; oui, l’idéal, comme l’a dit Proudhon, n’est qu’une fleur dont les conditions matérielles d’existence constituent la racine. Oui, toute l’histoire intellectuelle et morale, politique et sociale de l’humanité est un reflet de son histoire économique. »
Il convient toutefois de remarquer que les formules rigoureuses à peu près ou dans une large mesure. On ne peut méconnaître à côté des facteurs économiques le rôle de la race, du tempérament, de la personnalité, l’action de ces grands hommes qui, s’ils ne sont pas les créateurs, sont certainement les collaborateurs de l’histoire (1).
Il faut enfin ajouter que les anarchistes ne traduisent pas le matérialisme historique en une finalité historique (et là-dessus, ils sont bien d’accord avec Marx lui-même !) : l’émancipation économique du prolétariat serait alors inéluctable, serait une fin nécessaire de l’histoire, ce qui conduit au plus plat réformisme. Ils ne croient pas non plus au fameux « sens de l’histoire », cette tarte à la crème des pseudo-marxistes du communisme officiel, qui n’est qu’une autre forme de la finalité historique.
On sait que Marx avait été, jusqu’en 1844, un admirateur enthousiaste des premières œuvres de Proudhon. La rupture survint en 1846 et à partir de cette date, Marx poursuivit d’une haine tenace le proudhonisme et les proudhoniens. Marx et Proudhon poursuivaient des buts communs, mais en 1846, Marx s’irrite de constater que les développements proposés par Proudhon sont différents de ceux qu’il attend et il est d’autant plus critique que la matière traitée est exactement celle pour laquelle il commençait à amasser des matériaux. (Pierre Ansart – Sociologie de Proudhon » – Paris 1967.) Il est donc indispensable d’indiquer les conclusions auxquelles ils parviennent et dont Pierre Ansart dresse un catalogue complet. En voici l’essentiel que j’emprunte à l’ouvrage cité : les contradictions sociales sont une conséquence du régime propriétaire ou du capitalisme bourgeois ; le capitalisme par l’accaparement des instructions de travail condamne le prolétariat au salariat ; la théorie marxiste de la plus-value ne fait que préciser l’analyse proudhonienne du vol capitaliste ; le travail est le seul créateur de la valeur et le profit est donc une partie du travail lui-même ; la fin de l’exploitation passe par la destruction du régime capitaliste de production ; Proudhon, comme Marx, affirme que le bénéfice capitaliste provient d’une part de travail non rétribuée ; tous deux voient dans l’État capitaliste le défenseur des intérêts économiques de la bourgeoisie et des industriels ; tous deux enfin considèrent le régime capitaliste comme engendrant une coupure dans la société, qui entraîne sa condamnation historique.
Marx et Proudhon différaient par leurs origines sociales, par leur tempéraments, par leur formation intellectuelles : Marx étaient un universitaire nourri d’hégélianisme, Proudhon un autodidacte rebelle à « l’idéomanie » hégélienne. Les points d’accord signalés plus haut n’en ont que plus d’importance et toute étude impartiale de l’anarchisme se doit de les mentionner.
Chez Proudhon comme chez Marx, la transformation de la société apparaît comme une conséquence de l’antagonisme entre la classe bourgeoise ou capitalisme et la classe ouvrière ou prolétariat. Le proudhonisme et le marxisme ne donnent d’ailleurs aucune définition suffisamment précise de ces classes économiques, ce qui n’exclut pas leurs rôles politique et idéologique. La classe capitaliste détient les moyens de production, la classe ouvrière ne les détient pas. Marx définit les prolétaires comme étant « les ouvriers modernes » et il écrit dans le « Manifeste communiste » : A mesure que grandit la bourgeoisie, c’est-à-dire le capital, à mesure aussi grandit le prolétariat, je veux dire cette classe des ouvriers modernes, qui n’ont de moyens d’existence qu’autant qu’ils trouvent du travail et qui ne trouvent du travail qu’autant que leur travail accroît le capital. Le moteur de la transformation sociale c’est le prolétariat. On connaît le schéma marxiste : en raison de la concentration capitaliste le nombre des capitalistes diminue tandis que le nombre des prolétaires augmente et le prolétariat se recrute dans toutes les couches de la population. L’amélioration du machinisme entraîne une paupérisation accrue des prolétaire : la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. La ruine de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Je n’ai pas l’intention ici de souligner les erreurs et les exagérations de ce schéma célèbre, lorsqu’on les confronte avec l’évolution du capitalisme et du prolétariat dans les pays fortement industrialisés. Retenons seulement que pour Marx l’agent de la transformation sociale est le prolétariat : la classe paysanne est par nature réactionnaire et Marx la confond dans ces classes moyennes essentiellement conservatrice qui « tentent de faire rétrograder la roue de l’histoire, et qui ne sont révolutionnaires qu’en tant qu’elles discernent qu’elles sont condamnées à se fondre dans le prolétariat.
Les anarchistes acceptent-ils la classification de Marx ? C’est un lieu commun de la littérature marxiste que de présenter Proudhon comme un « petit-bourgeois », le défenseur attardé des paysans et de classes moyennes. Une mise au point s’impose… Sans espérer d’ailleurs convaincre les cerveaux obtus ! Proudhon a jugé les paysans en termes extrêmement sévères : classe égoïste, vénale, hypocrite, propriétaire enragée. Mais il pense qu’en face du capitalisme, les intérêts des paysans rejoignent ceux des ouvriers : ces derniers devront entraîner les paysans et leur montrer qu’à la possession des instruments de production, il faut joindre, pour la paysannerie, la possession de la terre. Et Proudhon souligne combien l’existence de la petite propriété pèse sur la mentalité paysanne. La classe ouvrière – le prolétariat ! – doit lutter en commun avec la paysannerie et on ne conçoit pas une transformation sociale réalisée sans ou contre les paysans. Songeons seulement au tragique exemple de la révolution bolchevique et à ces milliers de paysans russes massacrés, déportés ou réduits à un nouveau servage au nom de la dictature du prolétariat et du socialisme.
Et la classe moyenne ? Proudhon range sous cette dénomination une petite bourgeoise travailleuse, plus proche du prolétariat que du capitalisme. Certes, elle travaille à son compte et n’est pas « salariée ». Elle est aussi victime, dans une certaine mesure, du capitalisme et de l’état bourgeois. Elle peut être entraînée à agir en commun avec les ouvriers dans une situation révolutionnaire et il ne faut point à l’avance l’écraser de notre mépris en donnant à son ralliement des motifs sordides.
On sait l’importance que Bakounine accordait à la classe paysanne. Songeant à la Russie, il voyait en elle un élément au moins aussi révolutionnaire que le prolétariat. Et il s’est consacré une grande partie de son action à l’organisation économique des ouvriers, il savait distinguer dans ce prolétariat abstrait deux sortes d’éléments : … Cette couche ouvrière séparée, en partie déjà privilégiée grâce à de hauts salaires… à ce point imprégnée des idées, des aspirations et de la vanité bourgeoises que les ouvriers qui appartiennent à ce milieu ne se différencient des bourgeois que par leur condition, nullement par leur tendance…, et ce prolétariat en haillons dont MM. Marx et Engels parlent avec le plus profond mépris et cela bien injustement, car c’est en lui et en lui seul, et non dans la couche embourgeoisée de la classe ouvrière, que résident en totalité l’esprit et la force de la future révolution sociale. Cette citation empruntée à « Étatisme et Anarchie » doit être complétée : Bakounine faisait grand cas des brigands et des hors-la-loi et évoquait Pougatchev et Stenka Razine. De là à prétendre que Bakounine et les anarchistes recrutent parmi les truands et les gangsters il n’y a qu’un pas. En fait, il y a plus d’un siècle, en Russie, vivaient des serfs en rupture de servage, des hors-la-loi, des hommes misérables traqués par les forces de l’ordre et qui étaient en lutte permanente avec la société. Ces temps sont révolus et Robin des Bois, le brigand, l’outlaw appartiennent au passé.
Bakounine n’oublie pas non plus une partie de la jeunesse, ceux d’entre les bourgeois studieux qui se sentiront lasse de haine contre le mensonge, l’hypocrisie, l’injustice et la lâcheté de la bourgeoisie… pour embrasser sans réserve la cause juste et humaine du prolétariat, mais ces ralliés à la cause de la transformation sociale seront les instruments fraternels du peuple ; grâce à eux, on n’aura que faire du gouvernement des savants. (« Dieu et l’État ») Avis aux « intellectuels » » toujours prêt à former un état-major ou des cadres dirigeant, et n’oublions pas que Bakounine ne s’est jamais considéré que comme un simple propagandiste des idées anarchistes.
Ainsi le moteur de la transformation sociale n’est plus ce prolétariat abstrait, rigide, défini uniquement par sa fonction économique.
On voit apparaître un autre critère que la non possession des instruments de production : le niveau des revenus de l’individu et de la famille. La division entre riches et pauvres, entre ceux qui ont trop et ceux qui n’ont pas assez apparaît essentielle. Certes, la partie consciente et la plus déshéritée de la classe ouvrière reste l’élément déterminant, celui qui entraînera d’autres individus, d’autres couches sociales. Mais l’ensemble de ceux qui luttent pour transformer la société constitue ce que Bakounine, comme Proudhon, appelle le peuple : la classe des pauvres gens qui forme sans aucun doute l’immense majorité de l’humanité (Bakounine). Et Proudhon précise ainsi la notion de prolétariat : la classe salariée, la plus nombreuse et la plus pauvre, d’autant plus pauvre qu’elle est plus nombreuse.
La classe ouvrière, reconnue comme facteur déterminant de la transformation sociale, est-elle capable de remplir cette tâche ?
CAPACITÉ POLITIQUE ET SPONTANÉITÉ DE LA CLASSE OUVRIÈRE
Il y a plusieurs réponses possibles à la question précédente : aussi exposerai-je d’abord le point de vue anarchiste, puis le point de vue marxiste-léniniste, ce qui mettra en évidence leur opposition.
Dans son ouvrage « De la capacité politique des classes ouvrières » qui est son testament de philosophe et de militant, Proudhon donne de cette expression la définition suivante : le problème de la capacité politique dans la classe ouvrière, au point de vue de ses rapports avec la société et avec l’État, a acquis conscience d’elle-même ; si comme être collectif, moral et libre, elle se distingue de la classe bourgeoise ; si elle en sépare ses intérêts, si elle tient à ne plus se confondre avec elle ; b) si elle possède une idée, c’est-à-dire si elle s’est crée lune notion de sa propre constitution ; si elle connaît les lois, conditions et formules de son existence ; si elle en prévoit la destinée, la fin… c) si de cette idée la classe ouvrière est en mesure de déduire, pour l’organisation de la société des conclusions pratiques qui lui soient propres… » Oui répond Proudhon au premier point, la classe ouvrière a pris conscience d’elle-même depuis 1848. Pour le second point Proudhon répond : « Oui, les classes ouvrières possèdent une idée qui correspond à la conscience qu’elles ont d’elles-mêmes, et qui est en parfait contraste avec l’idée bourgeoise. » Quant au troisième point, Proudhon en 1865 – répond : non, la classe ouvrière n’est pas parvenue à déduire des principes qui constituent sa foi nouvelle « une pratique générale conforme ».
Proudhon reconnaît que le problème social n’a pas été posé d’abord par des ouvriers. Mais ceux-ci n’acceptent pas sans discussion les thèses des différentes écoles socialistes. Ils n’adoptent que les idées et les principes qu’ils estiment conformes à leurs intérêts dans la lutte sociale, il ne peut donc y avoir un parti privilégié qui décide qu’il est le guide souverain et incontestable et qu’il détient la vérité absolue ; on ne peut faire confiance à des docteurs ès-sciences économiques ou à des théoriciens qui veulent diriger le mouvement ouvrier selon des schémas arbitraires. « Les socialistes révolutionnaires croient qu’il y a bien plus de sens pratique et d’intelligence dans les aspirations instinctives et les besoins réels des masses populaires que dans les esprits profonds de tous ces docteurs patentés et de ceux qui se sont désignés eux-mêmes comme tuteurs de l’humanité. » (Bakounine). La classe ouvrière repensera les diverses théories et sera capable d’élaborer les principes généraux qui guideront son action. Elle ne fondera pas une doctrine rigide qui s’impose autoritairement, mais adoptera, grâce à la réflexion collective et à l’expérience tirée des luttes quotidiennes, un ensemble de règles, une philosophie exprimant la vie dans sa plénitude.
C’est ainsi que le syndicalisme révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme ont été des créations de la classe ouvrière ; il s’agissait pour la partie la plus consciente du prolétariat de mettre sur pied un mouvement et des organisations capables de défendre les intérêts immédiats et matériels des ouvriers et de lutter pour la disparition du salariat et l’établissement d’une société sans classes et sans État. Ce double combat devait être mené directement sans subordination à des partis politiques, sans intégrations dans l’État, sans compromission avec les maquignons du parlementarisme. On retrouve dans le syndicalisme révolutionnaire des éléments empruntés au marxisme, d’autres – plus nombreux – tirés du proudhonisme et bakouninisme : aussitôt les marxistes orthodoxes ont dénoncé la confusion, la pensée disparate de ce mouvement et stigmatisé l’action directe comme un retour aux instincts primitifs d’un prolétariat arriéré. Les socialistes autoritaires, aveuglés par l’idée d’un parti dirigeant ne comprenaient pas que le syndicalisme révolutionnaire était une image parfaite de la lutte des classes, opposant directement la classe ouvrière à la classe capitaliste dans un conflit qui comportait aussi bien la négociation pacifique que la violence révolutionnaire.
Marx et Engels avaient parfaitement saisi le danger que présentait pour le socialisme scientifique l’assimilation par la classe ouvrière française de divers éléments idéologiques conduisant à une conception originale de la lutte sociale. En dénonçant certains amalgames, ils ont – volontairement ou non – commis des erreurs ridicules. Le 20 Juin 1856, Marx écrit à Engels que les ouvriers parisiens férus de fédéralisme et de communalisme sont sous l’influence d’un Stirnérisme proudhonisé, ce qui est franchement absurde, Stirner étant à cette date totalement inconnu dans les milieux ouvriers français (et même européens !). Et Engels donne en 1886 cette définition singulière de l’anarchisme : « Stirner resta une curiosité, même après que Bakounine l’eut amalgamé avec proudhon et qu’il eût baptisé anarchisme cet amalgame. » (« Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique ».)
On rattache souvent la notion de spontanéité de la classe ouvrière à celle de sa capacité et on en fait – soit qu’on l’approuve ou la condamne – une caractéristique de l’anarchisme. L’action spontanée des masses est une idée chère à Bakounine ET JE ME CONTENTERAI DE CITER DEUX TEXTES CÉLÈBRES : « La vie, non la science, crée la vie ; l’action spontanée du peuple peut seule créer la liberté », et : « contrairement à cette pensée des communistes autoritaires, selon moi tout à fait erronée, qu’une révolution sociale peut être, décrétée et organisée soit par une dictature, soit par une assemblée constituante issue d’une révolution politique, nos amis les socialistes de paris ont pensé qu’elle ne pouvait être faite et amenée à son plein développement que par l’action spontané » et continue des masses, des groupes et associations populaires. »
Proudhon pense que la classe travailleuse peut et doit opérer elle-même sa propre émancipation. Mais la spontanéité du peuple peut conduire à des erreurs ou se manifester pour des opinions ou des actions contraires à ses intérêts véritables. Le peuple peut se tromper et être tromper. Pour que l’action spontanée du peuple s’exerce à bon escient en vue de son émancipation, il faut que le peuple constitue son organisation économique, une organisation qui lui soit propre et que ne suive pas les injonctions d’un parti politique. Pour Proudhon, c’est surtout en période de crise ou de révolution, que joue la spontanéité collective du peuple, à condition que le peuple ait pris conscience de son véritable rôle, possède une idée, et en ait déduit, les conclusions pratiques qui s’imposent
Il importe maintenant définir avec précision ce qu’on entend par spontané. Une action est spontanée lorsque celui qui agit le fait de lui même sans obéir à des influences extérieures. L’action spontanée du peuple peut être, en période de crise aiguë, un mouvement unanime animé par une idée-force irrésistible qui réunit en un seul faisceau toutes les énergies éparses. Elle peut être aussi une action décidée par les organisations propres à la classe ouvrière, dans une situation déterminée et avec l’accord motivé de l’immense majorité des intéressés. Pour plus de clarté, précisons ce qu’est une action non spontanée : ce sera un mouvement décidé par une fraction de la classe ouvrière ou par un parti extérieur à cette classe, bien que prétendant parler en son nom. Si le prolétariat à la faiblesse de suivre ces mauvais bergers, il sera entraîné, dirigé, encadré, en un mot enrégimenté pour faire triompher les intérêts de cette fraction ou de ce parti. Ce sera pour la classe ouvrière la pire des aliénations et le plus tragique désastre. La spontanéité, c’est la garantie pour le prolétariat de sauvegarder l’avenir, c’est la condition pour que l’émancipation des travailleurs soit l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Nous venons de voir la conception qu’ont les anarchistes de la capacité politique et de la spontanéité de la classe ouvrière. Voyons maintenant ce qu’en pense Marx. La victoire sur la bourgeoisie d’un prolétariat toujours plus nombreux est inévitable. Il semble donc que Marx affirme sans discussion la capacité politique de ce prolétariat. En réalité il la lui retire par un tour de passe-passe ! Ce qui compte dans le schéma de Marx, c’est moins la classe proprement dite que la conscience que la classe a d’elle-même. Le prolétariat, ensemble des ouvriers modernes, a bien une conscience de classe, mais obscure, contaminée. Seule une fraction bien déterminée du prolétariat arrive à une conscience révolutionnaire pure, à une vision nette de l’avenir historique du prolétariat, de sa mission, du but poursuivi. Cette fraction est formée des seuls communistes, c’est-à-dire de ceux qui acceptent les enseignements de Marx. Certes Marx dira dans le « manifeste communiste » que « les communistes ne forment pas un parti distinct en face des autre partis ouvriers », qu’ils n’ont pas des principes » sur lesquels ils aient dessein de modeler le mouvement ouvrier », mais il ajoute aussitôt que « les communistes représentent les intérêts du mouvement intégral », et il conclut : « Dans la pratique les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, celle qui sans trêve leur donne une impulsion nouvelle. Dans la théorie, ils ont sur la masse prolétarienne l’avantage que donne l’intelligence des conditions, de la marche et des résultats généraux du mouvement prolétarien. »
Les communistes constituent donc une fraction a priori privilégiée et la masse prolétarienne est mineure : elle est la piétaille et les communistes, guide providentiel et infaillible, éclairé par le marxisme, qui sera l’unique moteur (et l’unique bénéficiaire !) de la transformation sociale La capacité politique du prolétariat passe au parti, un parti qui n’est d’ailleurs que partiellement prolétarien. Marx est toujours resté fidèle à cette conception du parti, malgré le coup de chapeau dont il a salué la Commune de Paris, après avoir, maintes fois, méconnu et ridiculisé le proudhonisme et le bakouninisme des ouvriers parisiens.
Les critiques qui précèdent peuvent paraître injustes : elles visent en effet un point de vue théorique qui, du vivant de Marx, n’a pu avoir de conséquences pratiques, aucun parti communiste marxiste n’ayant assez de force pour impulser le prolétariat. Elle s’appliquent plutôt aux partis marxistes contemporains. Il faut d’ailleurs reconnaître que Marx, par ailleurs, a insisté sur l’importance des organisations économiques et syndicales, sur la suprématie du social et la dévalorisation du politique. Dans une déclaration célèbre à des syndicalistes allemands (1869), Marx s’exprime ainsi : « … Les syndicats captent la masse de façon durable ; seuls, ils sont capables de représenter un véritable parti ouvrier et d’opposer un rempart à la puissance du capital. Ce texte, postérieur de vingt en un ans au » manifeste communiste », montre une évolution consécutive à une nouvelle situation et à l’existence de l’internationale. Malheureusement, comme nous allons le voir maintenant, eux qui se recommandent du marxisme, ont écarté du marxisme tout ce qui pouvait être une reconnaissance de la capacité politique de la classe ouvrière.
*
En ce début de 1970, il existe des groupes de jeunes gens, aussi naïf que plein de bonne volonté qui s’intitulent marxistes-léninistes et rêvent de cet âge d’or de la révolution bolcheviste, lorsque, sous la houlette de Lénine et de Trotsky, prospéraient les Soviets, les conseils ouvriers et que triomphait la spontanéité créatrice de la classe ouvrières… Quelle a été la position de Lénine à l’égard des questions qui nous intéresse dans ce chapitre ? Il n’y a pas eu une position, mais plusieurs, ces variations étant le fait de l’opportunisme et de la duplicité de Lénine.
Dans l’ouvrage paru en 1903 sous le titre : « Que faire ? », Lénine condamnait avec éclat toute croyance à la capacité politique du prolétariat, toute foi dans la spontanéité de la classe ouvrière. Il substituait à l’idée d’un parti organisé démocratiquement, la conception d’un noyau de révolutionnaires professionnels auxquels serait subordonné le reste du parti. Il est indispensable de citer quelques passages de « Que faire ? », mais la lecture de l’ouvrager tout entier s’impose (2) :
Les ouvriers ne pouvaient pas avoir encore la conscience social-démocrate (c’est à dire révolutionnaire). Celle-ci ne pouvait leur venir que de l’extérieur. L’histoire de tous les pays atteste que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu’à la conscience trade-unioniste, c’est-à-dire à la conviction qu’il faut s’unir en syndicats, se battre contre les patrons, réclamer du gouvernement telles loi nécessaires aux ouvriers. Quant à la doctrine socialiste, elle est née des théories philosophiques, historiques, économiques, élaborées par les représentants cultivés des classes possédantes, par les intellectuels. Les fondateurs du socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, étaient eux-même, par leur situation sociale, des intellectuels bourgeois. De même en Russie, la doctrine social-démocrate surgit, d’une façon tout à fait indépendante de la croissance spontanée du mouvement ouvrier, comme le résultat naturel et inéluctable du développement de la pensée chez les intellectuels révolutionnaires socialistes ».
« tout culte de la spontanéité du mouvement ouvrier, toute diminution du rôle de l’élément conscient, du rôle social-démocratie signifie par là-même – qu’on le veuille ou non, cela n’y change rien – un renforcement de l’influence de l’idéologie bourgeoise, d’exagération du rôle de l’élément conscient, se figurent que le mouvement purement ouvrier est par lui-même capable d’élaborer une idéologie indépendante, à la condition seulement que les ouvriers arrachent leur sort des mains des dirigeants. Mais c’est une erreur profonde. »
« … La conscience politique de classe ne peut être apportée à l’ouvrier que de l’extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. »
Et Lénine s’appuie sur l’autorité de Kautsky dont il cite les paroles « justes et significatives » :
« … La conscience socialiste serait le résultat nécessaire, direct, de la lutte de classe prolétarienne : cela est entièrement faux… La conscience socialiste d’aujourd’hui ne peut surgir que sur la base d’une profonde connaissance scientifique… Or le porteur de la science n’est pas le prolétariat mais les intellectuels bourgeois ; c’est en effet dans le cerveau de certains individus de cette catégorie qu’est née le socialisme contemporain… Ainsi donc la conscience socialiste est un élément importe du dehors dans la lutte de classes du prolétariat et non quelque chose qui en surgit spontanément. »
Devant l’incapacité propre à la classe ouvrière et les effets dérisoires de sa spontanéité, s’impose le recours à un état-major de révolutionnaires professionnels qui s’arrogent le droit de commander dictatorialement le reste du parti et – naturellement – l’ensemble du prolétariat ignare. On a signalé dans ces idées les influences de Tchernychevski, de I (auteur, lui aussi, d’un « Que faire ? ») et aussi du « Catéchisme du révolutionnaire » de Netchaïev, célèbre par son cynisme, son amoralisme total et son machiavélisme systématique. Après la révolution bolcheviste (et jusqu’en 1926) Netchaïev fut officiellement considéré comme un précurseur du bolchevisme : des historiens consacrés par l’appui du parti, tels que Pokrowski et Gambarov présentèrent le programme de Netchaïev comme un point de départ, l’achèvement étant le mouvement bolcheviste russe.
Que faire ? suscita dans le parti ouvrier social-démocrate russe de vives protestations au nom du marxisme dénaturé par Lénine. Axelrod, Plekhanov, Trotsky signalèrent le danger de la dictature d’un petit groupe se substituant à la fois au parti, à la classe ouvrière. Voici quelques extraits d’un article de Rosa Luxembourg paru en 1904 dans la « Neue Zénith » et « l’iskra » :
« … Il es résulte que le centralisme social-démocrate ne saurait se fonder ni sur l’obéissance aveugle, ni sur une subordination mécanique des militants au centre du Parti. »
« … Lorsque Lénine affirme qu’aujourd’hui « ce n’est plus le prolétariat, mais certains intellectuels de notre parti qui manquent d’auto-éducation en ce qui concerne l’esprit d’organisation et de discipline » et qu’il glorifie l’action éducatrice de l’usine qui rompt le prolétariat « à la discipline et à l’organisation », il prouve une fois de plus que sa conception de l’organisation socialiste est trop mécanique. Ce n’est pas seulement l’usine, c’est encore la caserne et le bureaucratisme actuel, bref c’est tout le mécanisme de l’État bourgeois centralisé qui inculque au prolétariat la discipline dont parle Lénine. »
Et Rosa Luxembourg considère < l'ultra-centralisme de Lénine comme imprégné de l’esprit stérile du veilleur de nuit ! > et dénonce < cette volonté peureuse d’instaurer la tutelle d’un comité central omniscient et omnipotent >.
En 1905, Lénine commença par condamner les Soviets – création spontanée – les communes révolutionnaires – dangereuse utopie – et il s’exprime en ces termes : << En un mot, qu’il s’agisse de la Communes de Paris ou de toute autre commune, vous devez dire : ce fut un gouvernement comme ne doit pas être le nôtre. >> ( « Deux tactiques » – 1905) (3). Devant la pression des ouvriers, Lénine se rallia, fin 1905, à la conception du soviet : le parti et le soviet, dit-il alors, sont pareillement indispensables, mais l’action des sociaux-démocrates à l’intérieur des soviets, si elle est organisée sur une large échelle, peut rendre superflue les soviets. Miracle du noyautage-sabotage ! Après le coup de force, appelé Révolution d’Octobre, Lénine change de langage et exalte l’activité créatrice et spontanée des masses. < L’état et la révolution > est un hymne à la capacité politique et à la spontanéité du prolétariat. La commune de Paris devient le modèle impérissable dont il faut s’inspirer. Lénine insiste sur << la similitude du Marxisme avec l’anarchisme, avec Proudhon comme avec Bakounine>>. Et en janvier 1918, au IIIe congrès des soviets, Lénine revendique pour la classe ouvrière l’entière organisation de la production, affirme que la gestion ion des affaires de l’État n’est pas inaccessible aux ouvrier et se félicite de voir » les idées anarchistes prendre enfin des contours vivants ! » (cité par K. Papaioannou).
Trois mois Après, Lénine, accusant le contrôle ouvrier et la gestion ouvrière d’utopie démagogique, liquida les anarchistes et revint avec une violence accrue aux thèses de 1903. Seule compte maintenant une discipline de fer, et le renforcement des pouvoirs de l’État doit amener les masses ouvrières à une stricte obéissance. Dans cette marche à l’asservissement de la classe ouvrières, Trotsky a dépassé Lénine en autoritarisme… et en cynisme. La lecture attentive de l’ouvrage de Trotsky : < Terrorisme et Communisme > (1920) offre des surprises : la future victime de Staline préconise l’obligation du travail, la militarisation des ouvriers, l’envoi des travailleurs là où leur travail est nécessaire, au besoin le travail forcé qui après tout n’est pas si improductif qu’on l’a prétendu !!! Ajoutons à ce beau programme l’étatisation des syndicats, dont les dirigeants devraient être des fonctionnaires de l’État, et on devine l’ignorance crasse de ceux qui s’enrôlent sous la bannière du trotskisme… pour combattre la bureaucratie.
La période avril 18 Mars 21, clôturée par la liquidation de la commune de Cronstadt, est marquée par la violence des propos de Lénine à l’égard du prolétariat et de l’opposition ouvrière de Chliapnikov et Kollontaï. On voit réapparaître les injures traditionnelles : anarcho-syndicalistes, petits-bourgeois inaptes. Mais elles sortent du domaine livresque pour accabler tous ceux qui n’acceptent pas la ligne du Parti. Inutile d’insister : on sait que l’avenir stalinien et post-stalinien devait confirmer cette incapacité de la classe ouvrière, son impuissance à créer, sa domination par le parti, lui-même dominé par le comité central et le Politburo. Le Marxisme-Léninisme, à la mode aujourd’hui, c’est ce régime inhumain. Les soviets ne sont pas une création de Lénine, ils furent détruits par Lénine. Le léninisme est une caricature éhontée du marxisme et il n’y a entre lui et l’anarchisme aucune conciliation possible. On peut concevoir une discussion entre un anarchiste et un marxiste authentique. Entre un anarchiste et un marxiste-léniniste, dialoguer est perdre son temps…
LES RESPONSABLES ET LES IRRESPONSABLES
J’ai essayé de montrer que, sur la question de la capacité et de la spontanéité de la classe ouvrière, le marxisme et l’anarchisme et, davantage encore, le marxisme-léninisme et l’anarchisme étaient inconciliables. Il en résulte des différences fondamentales de comportements aussi bien en période de crise révolutionnaire que dans la lutte quotidienne. Les anarchistes pensent que l’action spontanée d’un groupe social déterminé dépend de l’existence d’individus qui, dans une situation donnée, ont une conscience précise de l’avenir historique du groupe et des fins qu’il poursuit : ils sont l’étincelle qui produit une réaction en chaîne et fait exploser les énergies latentes du groupe. L’action se déchaîne alors, sans qu’il y ait un ordre venu d’en haut, sans qu’un état-major dirige le mouvement, sans encadrement, sans une hiérarchie de chefs. De tels mouvements spontanés, dont on ne peut prévoir le développement, répugnent à la bourgeoisie, à l’état, aux partis disciplinés, car ils peuvent entraîner la déroute de l’autorité, la perte des privilèges, la déconfiture des bureaucraties syndicales ou politiques.
Ces individus, le plus souvent anonymes, qui ont été au point de départ du mouvement, se perdent dans la foule qui s’est rassemblée autour d’eux : ils constituent ce qu’on a appelé les minorités agissantes. Pour les bourgeois, ce sont les « meneurs » les « agitateurs professionnels ». Pour les appointés des partis se réclament de la classe ouvrière et pour les permanents des syndicats politisés, ce sont les agents provocateurs, les « éléments troubles », les fameux « irresponsables ».
Le 14-Juillet, le 10-Août furent des journées révolutionnaires et d’une importance capitale. Il n’y avait ni partis, ni syndicats pour lancer ou freiner le mouvement. Ces journées furent l’œuvre d’irresponsables autour desquels la foule enthousiaste se groupa. Et 1830 ? et 1848 ? Là encore il s’agit d’un mouvement spontané, avec, au départ, la volonté claire de petits groupes qui n’étaient pas téléguidés par un Comité Central de Parti centraliste. Imaginez ce qui se serait passés le 14 juillet, s’il avait existé un Parti, guide de la classe ouvrière, représentant par vocation les intérêts immédiats et lointains du peuple. On aurait vu au Palais-Royal les hommes de confiance, le service d’ordre, les responsables, tous les imbéciles à qui un brassard confère une parcelle d’autorité, apostropher Camille Demoulins et ceux qui appelaient aux armes les parisiens. < Citoyens, ne répondez pas aux provocations ! c’est un piège ! Obéissez au mot d’ordre du parti ! Dispersez-vous dans le calme et la dignité !… et patati… et patata. > Et la Bastille n’eût certainement pas été prise d’assaut le 14 Juillet 1789.
Ceci a l’air d’une plaisanterie et pourtant cet antagonisme entre responsables et irresponsables est un des points essentiels de la discussion entre autoritaires et anti autoritaires, entre communistes et anarchistes. Le responsable, c’est l’homme à qui on a délégué délibérément de l’autorité, qui a pris du galon et qui parfois est payé en raison de son galon. Il a conscience d’être supérieur au troupeau dont il est le berger ou le chien, il se croit plus intelligent car il participe parfois aux délibérations des « instances supérieures », il détient les mots d’ordre et il est un représentant de l’Ordre, une espèce de flic de la politique ou du syndicalisme : en un mot un Chef, le symbole dérisoire de l’aliénation des prolétaires !
Du haut en bas de la hiérarchie des responsables on trouve les mêmes traits caractéristiques : méfiance à l’égard de la masse et de ses réactions spontanées, souci de diriger et de canaliser les mouvements, de les contrôler, au besoin de les saboter quand sont en jeu les intérêts sordides des responsables. Mais les responsables, ce n’est pas seulement le secrétaire de cellule et de rayon ou la centième partie d’un comité central qu’élisent par acclamations neuf cent cinquante robots triés sur le volet, c’est aussi le rond de cuir du syndicalisme qui fut, il y a bien longtemps, mineur ou métallurgiste et qui, depuis son bureau, a la prétention de commander aux masses, l’expert en maquignonnage, cet éternel Judas en qui l’administrateur a tué l’apôtre.
Si le responsable en politique a une sainte horreur des groupuscules et des anarchisants, le responsable en syndicalisme poursuit d’une haine farouche les grèves sauvages. En France, en Allemagne, en Angleterre, il y a des ouvriers qui se mettent en grève sans la bénédiction des responsables, sans prendre l’avis des docteurs ès-stratégie,
sans tenir compte des ordres de la hiérarchie. Ne faut-il pas vraiment être sauvage pour pratiquer l’action directe, cette survivance des temps préhistoriques, alors que le monde civilisé ne pratique plus que l’action indirecte : d’un côté les patrons, de l’autre les ouvriers, avec entre eux, les responsables, ces professionnels du marchandage ? Quand je pense aux responsables, j’évoque une page d’un roman bien oublié du début du siècle : « Le maître de la mer » du vicomte E.M. de Vogüe. Un capitaine d’industrie américain donne son avis sur le socialisme : pris dans un sens large, ce terme englobe aussi le syndicalisme : « l’organisation socialiste exerce aujourd’hui sur les masses la compression nécessaire dont les anciens pouvoirs ne sont plus capables… Jadis, le pouvoir monarchique maintenait les activités individuelles sous le joug ; et, à son défaut, la puissance de l’église. De nos jours… l’organisation socialiste s’en charge. Grâce à elle, des milliers d’individus remuants rentrent dans le rang. » Je trouve ces quelques lignes singulièrement prophétiques.
Les responsables, les membres de l’Appareil, les apparatchiks des Démocraties dites populaires sont un obstacle à cette séparation, cette scission entre capitalisme et prolétariat jugée indispensable par Proudhon. Ils forment une sous-classe de caractère ambigu : leur origine, les intérêts qu’ils défendent en théorie les rattachent au prolétariat, mais leur situation déjà privilégiée, l’autorité qu’ils détiennent, leurs contacts avec les représentants du capitalisme à l’Assemblée nationale, dans les antichambres ministérielles, au cours des dialogues, colloques et entrevues, les rapprochent de la bourgeoisie. Et soyez assurés que s’ils prennent le pouvoir – comme ils disent ! – ils ne seront point partisans du dépérissement de l’État ! Grâce à eux on assiste à ce confusionnisme scandaleux, à ces mariages contre nature, conséquence d’un opportunisme inavoué, qui nous ont valu ces manifestations affligeantes, expression spectaculaire de l’asservissement de la classe ouvrière : cortèges pacifiques et dûment encadrés, avec drapeau rouges et tricolores, et chants alternés de l’internationale et de la marseillaise.
J’ai fait le portrait du responsable. Et l’irresponsable ? On peut le définir comme la négation du responsable, et je ne pense pas qu’un quelconque Hegel puisse réussir la synthèse des deux termes de la contradiction. En un mot, je définirai l’irresponsable : c’est celui qui dit : non ! au responsable Opposition irréductible des hommes libres à ceux qui, dans la société bourgeoise, préfigurent la nouvelle classe, les profiteurs de la politique et du syndicalisme, les exploiteurs de la Révolution.
RÉVOLUTION OU ÉVOLUTION ?
VIOLENCE OU NON-VIOLENCE
Les dictionnaires donnent du mot révolution la définition suivante : changement violent du gouvernement d’un État. Et ils semblent ainsi ne considérer que les révolutions politiques, celles qui modifient seulement la forme de l’État et non la structure économique, celles qui touchent aux apparences et non aux réalités. Mais pour l’homme de 1970, le mot révolution évoque des images confuses le souvenir de 93 vient se mêler à celui d’Octobre 17, la Terreur jacobine trouve un écho dans les excès de la Commune. Un peu d’apocalypse sur fond d’incendies et de massacres…
Débarrassée de ces oripeaux romantiques ou grand-guignolesques, la Révolution apparaît, pour ceux qui veulent transformer l’ordre économique et social, comme la crise brusque et violente qui détruira la vieille société et permettra la naissance de la société nouvelle. De 1830 à l’époque actuelle, telle fut la conception de tous ceux – penseurs et militants – qui se firent les apôtres de la transformation sociale et l’homme de la rue les englobes sous l’appellation révolutionnaires. Pour Marx, la violence est « l’accoucheuse de toute vieille société grosse d’une société nouvelle », et il écrit dans le « manifeste communiste » : « Les communistes déclarent ouvertement que leurs desseins ne peuvent être réalisés que par le renversement violent de tout l’ordre social traditionnel. »
Proudhon évoque maintes fois la liquidation générale du régime capitaliste, la nécessité d’une révolution sociale usant de la violence. Il écrira : Propriétaires défendez-vous ! il y aura des combats et des massacres, et, parlant de venger l’insurrection de juin 48, il considérera comme nécessaire de poser avec un redoublement d’énergie, avec une sorte de terrorisme, la question sociale.
Je ne citerai qu’un seul passage dans l’œuvre de Bakounine, un seul parmi tant d’autres : « La révolution, c’est la guerre, et qui dit guerre dit destruction des hommes et des choses. Il est sans doute fâcheux pour l’humanité qu’elle n’ait pas encore inventé un moyen plus pacifique de progrès, mais jusqu’à présent tout pas nouveau dans l’histoire n’a été réellement accompli qu’après avoir reçu le baptême du sang. »
Et faut-il parler de Blanqui, légendaire incarnation de la Révolution ? Dès 1832, peu après l’insurrection qui suivit les funérailles du général Lemarque, il voyait la France à la veille de « La plus effroyable catastrophe » et écrivait dans une lettre : « Savez-vous qu’il me paraît aujourd’hui impossible que des torrents de sang n’inondent pas le pays ? Je crains fort que 93 n’ait été qu’une plaisanterie auprès de ce qui se passera peut-être bientôt. » (4)
Jusqu’en 1871, l’imminence d’une révolution, d’un affrontement violent entre un prolétariat misérable et une bourgeoisie férocement égoïste, était article de foi. La naissance du capitalisme avait été marquée par une telle exploitation, les révoltes ouvrières avaient été réprimées avec une telle sauvagerie, qu’une révolution semblait inévitable. Mais il faut se hâter de dire que la position de Marx, de Proudhon et de Bakounine est plus nuancée, bien moins absolue que ne le font croire certaines simplifications arbitraires. Il faut noter chez Marx une certaine ambiguïté qui résulte d’une part de l’inéluctabilité de la victoire d’un prolétariat toujours plus nombreux en face d’un capitalisme de plus en plus concentré, d’autre part de la nécessité d’un parti organisé conduisant le prolétariat à une révolution violente. On conçoit que cette ambiguïté ait conduit à un courant marxiste réformiste attendant la transformation sociale du jeu fatal des contradictions économiques et un courant révolutionnaire caractérisé par un parti autoritaire et dont le léninisme devait être l’aboutissement. Et si l’on peut citer – nous y reviendrons plus loin – quelques écrits de Marx préconisant la dictature du prolétariat, il ne faut pas oublier que Marx considérait comme possible une transformation sociale pacifique dans certains pays ; en 1872, au congrès de l’internationale à la Haye, il s’exprimait ainsi : « nous ne nions pas qu’il y a des pays comme l’Angleterre et l’Amérique – et je ne pourrais ajouter la Hollande – où les travailleurs peuvent peut-être atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques. »
Certes, Proudhon est révolutionnaire et ne recule pas devant l’idée d’une révolution violente. Mais elle ne peut être, dans sa pensée, que le fruit d’une organisation patiente de la classe ouvrière sur le terrain économique. Et quand il parle « des armées de la révolution », il pense surtout à ces « compagnies ouvrières » qui portent le nom, dans le langage moderne, de conseils ouvriers d’autogestion, des syndicats, de coopératives de production. Les embryons de la société nouvelle doivent précéder la liquidation du capitalisme. Les émeutes, les violences de rue ne sont que des moyens d’accélérer le cours de l’histoire.
Et c’est aussi a ce travail obscur et obstiné d’organisation que Bakounine s’était consacré à partir des années soixante. Travail qui, loin d’être incompatible avec la foi révolutionnaire, est la condition essentielle du succès d’une révolution. On cite souvent, comme un mea culpa du vieux révolté, une lettre à Élisée Reclus, écrite au déclin de sa vie par un Bakounine usé physiquement, abattu moralement après l’écrasement de la Commune, lettre désabusée où on peut lire : « l’heure de la révolution est passée. » Je ne vois là aucune condamnation de l’idée même de la révolution, mais la simple constatation d’un fait indéniable : après 1871 on entrait dans une période de dépression pour le mouvement ouvrier, il fallait repartir à zéro, s’organiser et attendre des jours meilleurs. C’est ce qu’a fait la classe ouvrière et Bakounine, sil avait vécu assez, aurait applaudi à ce renouveau marqué par le syndicalisme révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme dont les militants reprenaient et amalgamaient les ides essentielles de Proudhon et de Bakounine.
Et nous autres, anarchiste de 1970, que pensons-nous de la Révolution ? Et tout d’abord précisons ce qu’elle n’est pas pour nous. La révolution n’est pas un prétexte à la violence verbales, à discours incendiaires, à articles véhéments. Ce n’est pas en criant : vive la Révolution ! qu’on hâtera sa venue, ni en la proclamant sur les mur, ni en brandissant des drapeaux rouges ou noirs Nous ne croyons pas au coup de force, aux prises d’armes comme on disait vers 1830, et ceci pour plusieurs raisons :
1) pratiquement, une minorité est impuissante devant l’énormité des forces de répression dont dispose le régime bourgeois et les coups de force du types blanquiste, déjà voués à l’échec il y a cent trente ans, sont maintenant impensables ;
2) il n’est pas question pour nous de prendre le pouvoir, d’instaurer une dictature imposant notre volonté (!) à des millions d’individus qu’on dresserait à l’obéissance par la terreur. Que des partis, se réclamant abusivement de la classe ouvrière, tentent cette sinistre aventure : libre à eux ! Mais nous ne serons pas à leur coté, ne voulant être ni complices, ni victimes de ces pseudo-révolutions. Nous savons trop bien que si pareille tentative réussissait, nous aurions le choix entre la prison ou le cimetière ;
3) la seule révolution qui nous intéresse, c’est celle voulue et réalisée par la classe ouvrière ayant pris conscience de sa mission, prête à prendre en mains ses destinées et ne remettant pas à un parti ou à un « Sauveur suprême » le soin d’organiser l’avenir. Si la classe ouvrière a pu convaincre le reste de la population active qu’elle ne poursuit pas des buts égoïstes mais qu’elle veut instaurer un régime économique rationnel fondé sur la liberté et l’égalité, alors l’affrontement final avec les privilégiés et les cadres du régime à abattre a des chances sérieuses d’entraîner la liquidation et la destruction de la vieille société.
Peu après le coup de force blanquiste du 12 mai 1839, Lemennais écrivait : « J’ai toujours été convaincu qu’une révolution n’est pas un coup de main et que, pour qu’elle se fasse dans les choses, il faut auparavant qu’elle soit faite dans les esprits. » (5) Nous pouvons faite nôtre cette déclaration . Mais, dira, t-on, vous renvoyez la révolution aux calandres grecques, vous acceptez purement et simplement l’évolution. Certes, nous désirons voir évoluer la condition ouvrière vers plus de bien-être et de liberté. Nous pensons que toute réforme est un pas en avant, pourvu qu’elle soit le résultat de l’action directe d’une classe ouvrière consciente qui ne perde pas de vue l’essentiel de sa mission. Mais il est certain qu’aucune évolution indéfiniment pacifique ne conduira à la transformation radicale de la société et du régime actuel de production. Jamais la classe au pouvoir, même si elle cède sur des points de détail, ne capitulera sur les points fondamentaux. Un ultime affrontement sera nécessaire, et c’est bien pour cela qu’il convient de réunir le maximum de chances.
Ces chances résultent de ce qui précède : travail d’organisation et d’étude. Il ne s’agit point de rester dans l’ignorance du présent en répétant inlassablement le catéchisme des grands principes ou d’appeler à grands cris la révolution sans se soucier de préparer l’avenir. Outre les tâches de propagande et de pénétration des idées libertaires dans les organisations propres de la classe ouvrière, il convient d’étudier les problèmes complexes de l’autogestion et du passage du régime économique à un autre suppose une connaissance sérieuse des problèmes techniques et le refus des improvisations irréfléchies qui conduiraient au pire désordre et très vite à l’arrêt de la production et de la distribution. Si nos idées ont une valeur pour l’avenir, elles doivent en avoir aussi pour le présent et nous devons favoriser ou créer tout groupement d’individus décidés à produire ou à consommer en dehors du cycle capitaliste. Telles étaient les idées qu’avait défendues en 1908 le socialisme libertaire Allemand Gustav Landauer en fondant l’union Socialiste, et qu’il avait exposées en 1911 dans son important ouvrage appel « au Socialisme », hélas ! à peu près inconnu en France. Il ne saurait être question ici de présenter en détail les idées de Landauer. Je citerai seulement quelques commentaires du militant bien connu de la C.N.T. espagnole, de Santillan (6) : on ne pourra jamais atteindre à plus de liberté et de justice qu’il n’en existe dans le cœur des peuples et dans des grandes masses humaines.
Ce qui importe donc, ce n’est pas la grande révolution de demain, mais la petite révolution qui se fait chaque heure et chaque jour, avec les moyens dont on dispose et autant que les circonstances le permettent. On peut toujours faire quelque chose de pratique, aussi peu que ce soit, et celui qui ne veut pas réaliser ce peu, possible aujourd’hui, pour se consacrer aux grands événement qui arriveront peut-être dans l’avenir, celui-là ne travaille ni pour l’avenir, ni pour le présent… Nous pensons avec Landauer que les grandes choses commencent toujours par les petites. »
Signalons enfin l’œuvre patiente et trop peu connue de l’organisation syndicale libertaire suédoise, la S.A.C., qui, dans un pays acquis à un réformisme béat et satisfait de lui-même, défend l’autonomie ouvrière, lutte contre un socialisme très proche des idées constructives de Landauer Sorel publia « les réflexions sur la violence » – un livre bien oublié ! – ce fut un beau concert de protestations: outrance et paradoxe, disait Jaurès ; conseils de voyous donnés aux ouvriers, disait je ne sais quel homme de droite. Les violences prolétariennes, disait Sorel, « sont purement et simplement des actes de guerres, elles ont la valeur de démonstrations militaires et servent à marquer la séparation des classes. Ce sont des actes spontanés « sans haine et sans esprit de vengeance ». Et Sorel oppose la violence prolétarienne à la force de l’État, cette violence à froid qui use de procédés juridiques, de répressions légales et au besoin de la main du bourreau. La violence prolétarienne maintenait la scission entre les classes, était un facteur moral face à l’état immoral. J’ose à peine écrire que j’approuve bien des propos de Sorel, car la violence est honnie de partout. Singulière indignation ! Depuis plus d’un demi-siècle, les états bourgeois ou prétendus socialistes se livrent aux pires atrocités, aux plus sanglantes répressions, sans parler des guerres, des assassinats collectifs, des génocides, des hécatombes atomiques, et toute la racaille bien-pensante de droite ou de gauche pousse des cris de réprobation pour quelques horions échangés, pour un policier contusionné ou pour une voiture – la sacro-sainte Voiture ! – incendiée. Une telle hypocrisie pousserait à la violence l’individu le plus pacifique…
Nous savons que la violence est stupide, qu’il est odieux de soumettre par la force un individu à la volonté d’un autre individu ou d’un état. Les anarchistes souhaitent une société débarrassée de la violence et où l’organisation fédéraliste qui succédera à l’État traditionnel usera de persuasion et non de contrainte. Mais nous vivons dans la société présente, en lutte sourde ou directe avec tous les soutiens de cette société et tout spécialement avec les forces de l’État; Faut-il, sous prétexte de non-violence, tout supporter et capituler par avance pour éviter tout acte de violence de notre part ? Certes, nous condamnons toutes les violences inutiles, tous les actes de terrorisme irréfléchi qui desservent notre cause, en général tous les moyens qui sont en contradiction absolue avec les fins de l’anarchisme. Mais, ceci étant dit, à l’époque actuelle et dans le monde actuel, l’anarchiste n’est prêt à renoncer à toute violence que si l’État commence ! Oh ! que la vérité dans cette vieille plaisanterie que je transpose ainsi : l’anarchisme n’est pas méchant ; quand on l’attaque, il se défend… Aussi, je n’arrive pas à me passionner pour ces débats théoriques sur le thème ; violence et non-violence. La question me semble mal posée, et je suis persuadé qu’au fond beaucoup de non-violents ne sont pas très éloignés des idées que j’ai exposées.
Pour mettre un point final à ce débat, je ne puis mieux faire que donner une analyse, hélas ! trop brève, d’une étude de E. Malatesta sur « Anarchisme et violence » (8). Malatesta exprime son désaccord aussi bien avec ceux qui sont opposés à toute violence hors le cas précis où ils sont directement attaqués, qu’avec les camarades prêt à toute violence contre les individus coupables de n’être pas anarchistes. Les premiers ne touchent pas les organisateurs de la violence d’État, mais seulement les auxiliaires insignifiants de l’état. Les seconds déconsidèrent le mouvement anarchiste qu’on dépeint comme une association de malfaiteurs et de meurtriers. Malatesta montre ensuite que l’anarchisme loin d’être fondé sur la violence, veut réaliser un monde d’harmonie, d’initiatives libres et de tolérance réciproque. Les anarchistes ne croient pas détenir la vérité ni l’infaillibilité : aussi sont-ils opposés à toute contrainte autoritaire, ce que ne font pas les partis politiques. Mais les anarchistes se heurtent aux lois, à l’armée, aux policiers, à toutes les forces qui défendent les privilégiés. Voulant transformer la société, ils sont révolutionnaires et « de ce point de vue, la violence n’est pas en contradiction avec l’anarchisme et ses principes« . Nous n’usons la violence que si on nous y contraint, mais « nous réclamons pleinement et totalement ce droit de légitime défense ».
Si Malatesta approuve l’acte de violence d’un homme qui, en pleine conscience, se sacrifie pour une cause qu’il estime juste, il condamne les actes désespérés d’individus qui, par pure réaction contre la société, s’arrogent le droit de frapper ou de terroriser des innocents, ou de ce qui sont guidés par leur seul instinct. Cette distinction faite, il dénie à la bourgeoisie et aux partis politiques tout droit de condamner la violence. Après cette très nette prise de position, Malatesta conclut en mettant en garde le mouvement anarchiste contre » les actes de certains anarchistes, dont nous voyons l’intolérance et le désir qu’ils ont de répandre autour d’eux la crainte et la terreur… Notre idéal est un idéal d’amour. Nous n’avons pas le droit de nous ériger en juges ou en bourreaux. Notre seul désir, notre fierté, notre idéal, c’est d’être des libérateurs ».
L’ÉTAT : DÉPÉRISSEMENT OU DESTRUCTION ?
Marxistes-léninistes et anarchistes, dit-on souvent, s’opposent irréductiblement sur la question de l’État. Sous cette forme simpliste, cette formule contient une part de vérité mais aussi bien de l’imprécision. Trop de gens se bornent à répéter que le marxisme conserve l’état et que l’anarchisme veut le détruire : je me propose, avec impartialité, d’exposer ce qui rapproche un peu les anarchistes des marxistes de toute obédience et ce qui les en sépare beaucoup.
L’État est l’instrument de domination de la bourgeoisie, il naît des antagonistes inconciliables de classes et tend à maintenir par tous les moyens les privilèges du capitalisme. Armée, police, prisons, bureaucratie en sont les manifestations les plus brutales. L’État est la négation de la liberté et quel anarchiste pourrait ne pas faire sienne cette formule de Lénine : « aussi longtemps qu’un État subsiste, il n’y a pas de liberté, et quand la liberté existera, il n’y aura plus d’État » ? l’État bourgeois est donc lié à l’existence des classes, à la propriété individuelle et, si le mode de production change, cet État disparaîtra. Il y a là-dessus unanimité des penseurs anarchiste et des marxistes conséquents. Mais déjà une critique se fait jour à l’égard des anarchistes : ils insistent trop sur la question de l’État, ils semblent en faire l’adversaire essentiel, ils confondent ainsi l’effet avec la cause et ne paraissent pas comprendre qu’il faut avant tout transformer l’infrastructure économique dont dépendent l’état et les idéologies. Une critique analogue fut faite à Bakounine par les marxistes au congrès de l’internationale à Bâle en septembre 1869. L’unanimité s’était faite sur la propriété collective du sol. Bakounine proposa alors d’adjoindre la condamnation du droit d’héritage : hérésie ! déclara Eccarius, c’est nier le matérialisme historique, l’héritage n’étant qu’une conséquence de la propriété individuelle. Affirmer l’appropriation collective des moyens de production, c’est par là-même, supprimer l’héritage. Donc confusion de la cause et de l’effet ! Certes, dit Bakounine, je sais fort bien que le droit civil est la conséquence de faits antérieurs, « mais le droit d’héritage est devenu plus tard la base de l’état politique et de la famille juridique qui garantissent et sanctionnent la propriété individuelle ». Donc, il faut l’abolir. Le point de vue de Bakounine était le suivant : il ne suffira pas de transformer les rapports de production, pour que, en un seul instant disparaissent certaines institutions, certaines idéologies et que les classes sociales cessent brusquement d’exister. Le droit bourgeois, la morale bourgeoise ont peu à peu acquis une vie propre et ne se dissiperont pas comme des fantômes. D’où la nécessité de les attaquer directement.
Je pense que cette position était infiniment plus réaliste que celle – toute théorique – des marxistes. Et lorsque ces derniers reprochent aux anarchistes d’accorder trop d’importance à la lutte contre l’Etat ils sont encore victimes de leur foi aveugles dans les théories et les dogmes. A une époque où l’état était loin d’avoir sa puissance actuelle, Proudhon avait déjà montré que le caractère essentiel de l’Etat était d’absorber toutes les forces collectives et d’étendre son emprise à toute la société. Par vocation, l’Etat est tentaculaire et dévorateur : « Les attributions de l’état grandissent continuellement aux dépens de l’initiative individuelle, corporative, communale et sociale. » L’Etat est centralisateur et destructeur de toute autonomie, il renforce son autorité en multipliant les lois, il entretient dans la masse des citoyens le mythe d’une providence protectrice et omniprésente, récompensant les bons et punissant les méchants. Vues prophétiques, quand on songe à l’Etat actuel planifiant l’économie, réglementant production et salaires, asservissant les syndicats, devenu patron par les nationalisations limitant les rares libertés communales et d’autan plus centralisateurs qu’il parle davantage de décentralisation ! Le capitalisme privé traditionnel conserve toujours ses privilèges essentiels défendus par l’Etat, mais il faut composer avec cet État fort de ces fonctionnaires, de ses technocrates, de sa police et de ses services de propagande. Certes, la classe ouvrière lutte pour une transformation économique de la société, mais, dans son combat quotidien, elle se heurte à l’Etat, à ses forces de répression, à ses tentatives sournoises d’enveloppement. Aux barons de la mine et du rail ont succédé les technocrates anonymes manipulant formules et statistiques, aussi froids et inhumains que leurs ordinateurs, serviteurs zélés de l’Etat-Dieu. Ceci justifie la position anarchiste : l’ennemi n° 1, c’est l’Etat et, comme nous le verrons, l’Etat quel qu’il soit.
****
Le marxisme-Léninisme est catégorique sur la disparition de l’Etat. Quand les classes auront disparu, l’Etat qui était une conséquence de l’antagonisme des classes aura cessé d’être nécessaire. Ce point de vue est amplement exposé dans l’œuvre de Marx et dans « l’Etat de la Révolution » de Lénine qui est un ouvrage fondamental. Je me contenterai de citer le texte célèbre d’Engels, tiré de « l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat » : « Avec la disparition des classes, disparaîtra inéluctablement l’Etat. La société qui réorganisera la production sur la base de l’association libre et égale des producteurs, reléguera la machine d’Etat à la place qui lui convient : au musée des antiquités, la machine d’Etat à la place qui lui convient : au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. » Ces quelques lignes ne peuvent que recueillir l’approbation de tous les anarchistes qui trouvent d’ailleurs un accent proudhonien dans cette association libre et égale des producteurs.
Le problème essentiel consiste dans la transition, au moment de la révolution violente du schéma marxiste, entre la société d’hier et celle de demain. On sait que ce passage est assuré par la dictature du prolétariat, pièce maîtresse de la conception léniniste. On sait aussi que cette dictature a soulevé bien des controverses. Lénine a-t’il été fidèle au marxisme, ou a t’il élaboré une théorie personnelle étrangère au marxisme ? Il faut reconnaître que Marx a été peu prodigue d’explications sur la phase de transition. On ne peut trouver dans son œuvre que quatre passages assez affirmatifs et Lénine en fait naturellement état :
1) « Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l’État, c’est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominantes. » (« Manifeste du parti communiste ».)
2) « Le prolétariat se groupe de plus en plus autour du socialisme révolutionnaire… Ce socialisme est la déclaration permanente de la révolution, la dictature de classe du prolétariat comme point de transition nécessaire pour arriver à la suppression des différences de classes en général. » (Lutte de classes en France » – 1850 –
3) « Ce que j’ai fait de nouveau, c’est d’avoir démontré… que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat, que cette dictature n’est elle-même que la transition à la suppression de toutes les classes et à la société sans classes. » (« Lettre à Waldemeyer » – 1852.)
4) « Entre la société capitaliste et la société communiste se situe la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. A quoi correspond une période de transition politique, où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. » (« Critique du programme de Gotha » – 1875.)
Ces textes affirment la nécessité d’une dictature – terme bien vague ! – exercée par le prolétariat – terme bien abstrait ! Lénine, invoquant après Marx l’exemple de la Commune de Paris précise qu’ils s’agit de briser la machine bureaucratique et militaire de l’Etat, de réprimer la bourgeoisie et de vaincre sa résistance. « La démocratie, de bourgeoise devient prolétarienne ; l’Etat (force spéciale destinée à réprimer une classe déterminée) s’est transformé en quelque chose qui n’est plus proprement un État » (Lénine). L’organisation de répression est la majorité de la population et non la minorité : « Or du moment que c’est la majorité du peuple qui opprime elle-même ses oppresseurs, plus n’est besoin d’une force spéciale de répression. C’est en ce sens que l’Etat commence à dépérir. » (Lénine).
Après l’anéantissement de l’Etat bourgeois, l’Etat prolétarien assume une tâche de répression et de direction. Au fur et à mesure qu’il supprime les antagonismes de classes, il commence à dépérir, il finira par disparaître, et Lénine cite Engels : « tant que le prolétariat a besoin de l’Etat, ce n’est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires ; et le jour où on pourra parler de liberté, il n’y aura pas d’Etat. »
Ainsi Lénine est amené à répondre à cette question : qu’est-ce qui nous sépare des anarchistes ? « Le prolétariat n’a besoin de l’Etat que pour un temps. Nous ne sommes aucunement en désaccord avec les anarchistes quant à l’abolition de l’Etat comme but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d’utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir de l’Etat contre les exploiteurs, de même que, pour la suppression des classes, la dictature provisoire de la classe opprimée est indispensable. »
**********
C’est en effet sur la nécessité d’une dictature du prolétariat que les anarchistes s’opposent irréductiblement aux marxistes-léninistes. Proudhon ignorait le point de vue de Marx, mais toute son œuvre s’insurge contre l’idée d’une dictature prolétarienne. Il ne recule pas devant l’idée d’imposer par la force une transformation économique à une minorité de privilégiés : mais ce n’est là qu’un pis-aller et il se méfie de toute dictature, car il voit dans l’acceptation de la dictature par la classe ouvrière une tendance au conformisme et à la soumission. On a vu qu’il considérait que toute autorité, tout gouvernement, tout État tendait à absorber les forces collectives, à augmenter sa puissance, et non à dépérir. Dans sa « Sociologie de Proudhon », Pierre Ansart résume excellemment le point de vue proudhonien : « … Un pouvoir, même ouvrier, s’il s’érigeait en autorité centrale, tendrait nécessairement à reconstituer lettres communes des régimes d’autorité : extension des polices, des bureaucraties, répression des libertés envahissement progressif de la société économique. »
Bakounine a maintes fois proclamé sa haine de l’Etat, de toute forme d’Etat. Je citera seulement cet extrait de son discours au congrès de la ligue de la Paix et de la Liberté (berne – 1868) : « l’Etat est la négation même de l’humanité… il n’y a pas et il ne peut y avoir d’Etat bon, juste, vertueux. Tous les Etats sont mauvais en ce sens que, par leur nature, par leur base, par toutes les conditions et par le but suprême de leur existence, ils sont tout l’opposé de la liberté, de la morale et de la justice humaine. » il critique (Marx le fit aussi) le programme de la social-démocratie préconisant l’institution d’un État populaire libre (freier Volkstaat), le mot « État » détruisant absolument le sens des deux mots qui le suivent : populaire et libre (Bakounine – « Lettre à un français »). Il voyait dans le socialisme d’État : « … Ce mensonge le plus vil et le plus redoutable qu’ait engendré notre siècle : le démocratisme officiel et la bureaucratie rouge. » (« Lettre à Hferzen » – 19 Juillet 1866.
Quant à la dictature du prolétariat, Bakounine y voyait surtout – et l’avenir devait lui donner raison ! – La dictature d’un parti :
Ce serait pour le prolétariat un régime de caserne où la masse uniformisée des travailleurs et des travailleuses s’éveillerait, s’endormirait, travaillerait et vivrait au tambour ; pour les habiles et les savants un privilège de gouvernement. » (« Lettre au journal la Liberté »).
Le socialisme, la révolution sociale impliquant la destruction de l’Etat, il est évident que, qui tend à l’Etat doit renoncer au socialisme, doit sacrifier l’émancipation économique des masses à la puissance politique d’un parti privilégié quelconque. » (« Lettre à un français »).
Contrairement à cette pensée des communistes autoritaires, selon moi tout à fait erronée, qu’une révolution sociale peut être décrétée et organisée soit par une dictature, soit par une assemblée constituante issue d’une révolution politique, nos amis les socialistes de Paris ont pensé qu’elle ne pouvait être faite et amenée à son plein développement que par l’action spontanées et continue des masses, des groupes et des associations populaires ». Préambule pour la deuxième livraison de « l’empire Knouto-germanique »).
Les anarchistes ne conçoivent pas une révolution imposée par un parti qui se prétendant le représentant de la classe ouvrière, exerce une dictature au nom du prolétariat. Ils ne pensent pas que cette dictature puisse être passagère et ils affirment, d’accord avec Bakounine, qu’elle conduit inéluctablement à l’instauration d’un régime autoritaire avec renforcement des pouvoirs de l’Etat dit prolétarien. Pour les anarchistes la révolution ne peut être que l’ouvre des organisations économiques propres à la classe ouvrières, si cette classe veut gérer la production et la distribution et si elle en est capable. Cette révolution sera l’aboutissement d’une longue évolution de la pensée ouvrière et d’une capacité toujours accrue des institutions propres au prolétariat. Si dans la phrase finale la violence ne peut être exclue, elle ne nécessitera pas, après la destruction de l’Etat bourgeois, la création d’un nouvel État. L’organisation économique du travail remplacera l’organisation politique avec ses révolutionnaires professionnels, ses policiers et ses bureaucrates. Les derniers vestiges des fonctions traditionnelles de l’Etat disparaîtront et l’on s’acheminera vers cette « association libre et égale des producteurs » dont parlait Engels.
J’ai exposé, le plus objectivement possible, les désaccords qui existaient entre marxistes et anarchistes, puis entre marxistes-léninistes et anarchiste, jusqu’à la parution de « L’état et la Révolution » (début de 1918). Les deux points de vue apparaissaient déjà à cette époque inconciliable. Comme nous le verrons plus loin, les suites de la Révolution d’Octobre ont fait perdre à ce débat son caractère purement théorique et ont mis en pleine lumière l’antagonisme irréductible entre l’anarchisme et les diverses formes du marxisme-Léninisme.
Cependant certains bons esprits tentent encore d’impossibles synthèses ; d’autres, poussées par un goût de la nouveauté et du paradoxe, ajoutent à la confusion et obscurcissent les notions les plus claires. Les colloques internationaux du C.N.R.S., tenus à Paris du 16 au 18 novembre 1964, étaient consacrés à la Première Internationale. Notre camarade Lehning, qui dirige à Amsterdam la publication des « Archives Bakounine » », faisait un exposé sur le conflit Marx-Bakounine. Dans la discussion qui suivit, M. M. Rubel, un de nos plus éminents marxologues, prit la parole et voici ce qu’on lit dans le compte rendu officiel du Colloque : « Sur le plan de la théorie sociale, Bakounine fut un des premiers disciples de Marx et on peut même le considérer comme le premier marxiste russe… Il n’est pas admissible d’opposer, comme l’a fait M. Lehning, l’anarchisme de Bakounine au prétendu communisme d’Etat de Marx que l’on peut plutôt considérer (comme M. Rubel s’est efforce de le prouver dans la thèse de doctorat) comme le théoricien de l’anarchie, autrement dit de la société sans classes, sans état et sans argent ». J’admire sincèrement M. M. Rubel qui, à ses qualité de philosophe, joint des dons certains d’acrobate et de prestigitateur ! Et je mets fin à cet intermède comique en reproduisant la réponse de Lehning : « M. Rubel a présenté Bakounine comme le premier marxiste russe et Marx comme le théoricien de l’anarchie ; c’est jouer sur les mots. Certes le but à atteindre selon Marx, comme selon Blanqui, était l’organisation sans classe et sans État. Mais dans la lutte des tendances au sein de l’A.I.T., il ne s’agissait pas de cette discussion théorique sur la conception d’une « Anarchie post-dictatoriale ». Il s’agissait de décider si la classe ouvrière devait s’organiser en partis politiques visant à la conquête du pouvoir ».
« LA NOUVELLE CLASSE DIRIGEANTE » (9)
Jusqu’en 1918 la thèse léniniste apparaissait à beaucoup comme réaliste et séduisante, alors que la position anarchiste semblait naïve et utopique. Dans l’inconscient des individus persiste ce respect de l’Etat que signale Proudhon, cette crainte que la disparition de l’Etat soit le signal du chaos et de la décomposition du cors social. Le maintien provisoire d’un État prolétarien a quelque chose de rassurant et un peu de dictature ne déplaît pas à ceux qui rêvent de représailles. Aussi bien, cet État dépérira, ainsi qu’il est écrit dans la Bible léniniste.
Hélas ! nous avons vu que, dès avril 1918, Lénine dénonça comme une dangereuse utopie cette foi dans les créations spontanées de la classe ouvrière, qui semblait jusque-là l’animer et préconisa le retour aux méthodes autoritaires et la mise en tutelle des syndicats et des soviets. Quand parut « L’état et la Révolution », la chasse aux anarchistes était déjà commencée ! il ne faut point s’en étonner : l’expression dictature du prolétariat prêtait à toutes les confusions. On ne peut imaginer le prolétariat exerçant en tant que tel une dictature qui suppose des organismes de répression et une direction fortement centralisée. Le parti bolchevik, parti détenteur de la vérité et représentant providentiel de la classe ouvrière, parti constitué par une fraction minoritaire du prolétariat encadrée par des révolutionnaires professionnels, était tout désigné pour exercer la dictature au nom du prolétariat et, au besoin, sur le prolétariat. Ceci supposait la concentration en tout les pouvoirs sans contrôle de la classe ouvrière, dans les mains du parti, c’est-à-dire de son appareil, c’est-à-dire du Politburo, c’est-à-dire du secrétariat. Une telle dictature entraîne la suppression de toute les libertés, non seulement pour les classes privilégiées, mais aussi pour toutes les tendances du mouvement ouvrier autres que le parti bolchevik, et bientôt pour ceux qui dans le parti, critiqueraient la ligne officielle. Un tel régime suppose la disparition des mal-pensants, la domestication des syndicats, la création d’une police politique pléthorique, la multiplication des organismes de contrôle du Parti unique à tous les échelons, la naissance d’une bureaucratie toute puissante ne dépendant que des instances du Parti. Trompés par l’importance de l’appareil policier ou militaire, certains naïfs évoquent périodiquement dans la presse occidentale de prétendues divergences entre le Parti d’une part et la Police ou l’Armée d’autre part. En fait Police et Armée dépendent étroitement du Politburo et sont férocement épures quand ce dernier le juge nécessaire. Du vivant de Lénine collaborant avec Trotsky, le régime prenait les traits caractéristiques d’un État totalitaire ; liquidation morale ou physique des partis, des oppositions, écrasement en 1921 de la commune de Cronstadt, établissement d’un système policier qui frappait indistinctement les anciens privilégiés et les prolétaires indociles. Je dis bien : État totalitaire, car le Parti unique asservit la totalité des activités de la société, la totalité – corps et âme ! – de la personne humaine. Le parti ne se contente pas d’imposer ce qu’il f faut penser en économie ou en politique. Il définit la « ligne » dans le domaine scientifique, littéraire et artistique. Il faite l’histoire l’auxiliaire de l’autorité du Parti, il corrige les biographies, il rature les événement, il crée une histoire officielle qui n’admet aucune hérétique. La logique du système a conduit bientôt à la dictature d’un seul homme, à la mise en place d’un univers opposants, il fallait les forcer à se déshonorer. Je renvoie au célèbre rapport de Krouchtchev, ou l’on trouvera la liste, d’ailleurs incomplète, des crimes de Staline (10).
Parfois un brusque changement de personnes s’opère au sommet de la hiérarchie. Tout ceci se décide au politburo et est ratifié par un Comité Central judicieusement manipulé. Qu’en pense le parti ? Qu’en pense la classe ouvrière ? Cela importe peu à l’appareil Suprême : le silence apeuré des masses est une approbation suffisante. Cependant on procède à des élections, où la foule des citoyens plébiscite une liste unique avec ces unanimités à 99,9 % que connaissent les régimes totalitaires hitlériens ou communistes. De bonnes âmes prétendent que l’U.R.S.S. et les républiques populaires sont en voie de libéralisation. En fait, on emprisonne toujours, le conformisme et la dictature sont toujours florissants, mais il y a progrès : on ne tue plus ! on se contente de « soigner » dans les hôpitaux psychiatriques les quelques insensés qui s’écartent de l’orthodoxie et qui sont assez fous pour penser et exprimer leur pensée !
_****_
Telle a été durant un demi-siècle l’évolution de cet État prolétarien (transitoire !) chargé d’exercer la dictature du prolétariat. Je ne rend pas Marx responsable de cette accumulation de forfaits, dont il serait le premier indigné. Mais on ne saurait passer sous que la révolution russe, l’U.R.S.S., les républiques dites populaires se réclament du marxisme et du léninisme. Staline se prétendait marxiste et léniniste lorsqu’il affirmait que plus les vestiges des classes bourgeoise disparaissent, plus les vestiges des classes bourgeoises disparaissent, plus il faut renforcer la dictature et l’Etat ! C’est au nom du marxisme que Boukharine écrivait dans le « Troud » (13 Novembre 1927) : « La seule situation imaginable est la suivante : un parti règne, tous les autres sont en prison. » Et Tomski dans la « Prandial » (19 Novembre 1927) : « La seule situation imaginable est la suivante : un parti règne, tous les autres sont en prison. » Et Tomski dans la « Prandial (19 Novembre 1937) : « sous la dictature du prolétariat, deux, trois, quatre partis peuvent exister, mais à une seule condition : l’un au pouvoir, les autres en prison. »
Devant un tel cynisme, peut-on évoquer le dépérissement de l’Etat ? Non seulement l’Etat ne dépérit pas, mais il n’y a aucun indice d’une agonie prochaine. L’état est en parfaite santé partout où flotte le drapeau du marxisme. Si l’on ne peut démontrer, avec preuve à l’appui, la justesse du point de vue anarchiste, on peut proclamer la faillite éclatante de la théorie marxiste-léniniste de l’Etat. Ce que pressentait Proudhon et Bakounine s’est réalisé, bien au-delà de leurs prédictions. La dictature du prolétariat, disait Bakounine, conduisait à la caserne : plutôt au bagne !.
Sorel avait déjà prévu, dans ses « Réflexions sur la violence », qu’une révolution politique utilisant « pour son plus grand avantage personnel la force des organisations vraiment prolétariennes… ne toucherait pas gravement l’Etat traditionnel ». Le peuple des producteurs changerait beaucoup plus durs et plus insolents que les prédécesseurs. » Ce sont ces nouveaux maîtres qui constitue, en U.R.S.S. et dans les républiques populaires, ce que Djilas appelle la nouvelle classe a été l’œuvre d’un ordre militaire et conspiratif ; le parti Bolchevik caractérisé par l’unité de croyance et la discipline militaire. « La nouvelle classe règne, au nom des ouvriers sur le reste de la société, mais, avant tout, sur les ouvriers eux-mêmes. Son autorité est d’abord intellectuelle, sur la fameuse avant-garde du prolétariat ; puis elle s’étend au prolétariat tout entier – imposture qui dépasse toutes celles qu’une classe a jamais pu commettre aux dépens d’une autre »
En régime communiste, la propriété est sociale et nationale. C’est au nom de la sauvegarde du patrimoine national que l’on incite les ouvriers à la discipline et au travail, que la grève est interdite comme dénuée de sens, que les syndicats ne sont plus que des organismes soumis à l’Etat. En réalité, « un groupe minoritaire administre la propriété dans son propre intérêt… En régime communiste, pouvoir et propriété sont concentrés dans les mêmes mains ; mais ce fait est dissimulé sous une fiction légale puisque, aux yeux de la loi, tous les citoyens sont égaux ce qui concerne la possession des biens matériels. Le propriétaire nominal et fictif est la Nation, tandis qu’en fait l’administration monopoliste se réduit à une couche très restreinte, qui jouit seule des droits de possession. »
Cette nouvelle classe jouit, comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, d’avantages matériels importants. Mais elle se réserve en plus les postes de commandement du Parti et de l’Etat, elle s’identifie avec l’appareil. « Le gouvernement communiste, en même temps qu’une structure de classe, est un gouvernement de parti ; l’armée communiste est une armée de Parti ; et l’Etat lui-même est un État de Parti. La loi non écrite qui exclut de certains postes (policiers, militaires, diplomatiques et autres) les citoyens n’appartenant pas au Parti, ou les prive de toute autorité sérieuse, donne naissance à un groupe spécialement privilégié de bureaucrates et met en court-circuit certains mécanismes du gouvernement et de l’administration. »
Djilas insiste sur l’unité idéologique obligatoire du Parti : ce monolithisme en matière d’idées entraîne la dictature des instances supérieures sur la pensée de chaque membre du Parti. « Le marxisme est devenu une théorie exclusivement définie et délimitée par les chefs du parti…Il n’est pas suffisant d’être marxiste, il faut encore l’être de la manière désirée et prescrite par la direction, ce qui, d’une pensée révolutionnaire libre, fait un dogme imposé à tous. » Ainsi toute démocratie a disparu dans le Parti qui a adopté le Führerprinzip, « d’après lequel les idéologues sont tout simplement les gens au pouvoir dans le Parti, qu’elles que soient leurs capacités ou incapacités intellectuelles ». A partir du moment où l’on ne tolère plus dans le Parti de divergences publiques, le fameux « centrisme démocratique tant vanté par Lénine » disparaît « et c’est le despotisme sans voiles de l’autocratie qui prend le dessus ». Et Djilas, formé par le marxisme-léninisme, depuis sa jeunesse soldat du communisme, constate la ruine de ses illusions et, devant le renforcement de l’Etat prétendu prolétarien, il écrit les lignes suivantes qui rejoignent la pensée anarchiste : « Aux yeux de Lénine, tout ce qui renforce dans l’immédiat la dictature du prolétariat conduit ipso facto à l’abolition des classes – et est, du même coup, justifié comme liberté réelle. Ainsi s’établit pour lui une séparation arbitraire entre la démocratie bourgeoise et la démocratie socialiste, bien que la seule distinction juste et valable ne puisse être fondée que sur la somme de liberté humaine dont chacun jouit et sur l’universalité de cette jouissance… L’expérience de la dictature prolétarienne a donné des résultats complètement opposés à ceux qu’envisageait Lénine. Les classes ne disparaissent point et l’Etat ne manifeste aucune tendance à dépérir. La croissance du pouvoir d’état ou, plus précisément, de la bureaucratie à travers laquelle l’Etat impose sa tyrannie, bien loin de s’arrêter avec la dictature du prolétariat, ne fait que prendre un nouvel essor. »
****
Peut-être Lénine était-il sincère, lorsque, développant les idées de Marx, il se proposait d’établir une société sans classes et sans État : Djilas dresse le bilan de la faillite du léninisme, faillite prévue par les anarchistes. On ne peut en effet négliger le facteur humain, aucune théorie ne peut faire abstraction de l’homme. La dictature du prolétariat n’est pas impersonnelle : elle est exercée par une fraction de ce prolétariat, encadrée et dirigée par un groupe de révolutionnaires professionnels. Les marxistes-léninistes auraient du penser que, puisque les idéologies dépendent des intérêts de classes, une idéologie de l’autorité et du pouvoir sans frein allait naître dans la nouvelle classe des dictateurs. Les anarchistes ont toujours souligné le caractère corrupteur de l’autorité. « Mettez Saint Vincent de Paul au pouvoir il y sera Guizot ou Talleyrand » (Proudhon). Et dans « Fédéralisme, Socialisme, anti-théologisme » Bakounine écrivait : « Rien n’est aussi dangereux pour la morale privée de l’homme que l’habitude du commandement. Le meilleur homme, le plus intelligent, le plus désintéressé, le plus généreux, le plus pur, se gâtera infailliblement et toujours à ce métier. Deux sentiments inhérents au pouvoir ne manquent jamais de produire cette démoralisation : le mépris des masses populaires et l’exagération de son propre mérite. » Le culte de la personnalité naîtra à la fois de la démission du peuple acceptant un chef et de l’orgueil insensé des dictateurs, ce que Beaudelaire exprime magnifiquement :
« Le poison du pouvoir énervant le despotisme,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant. »
Et si l’autorité tombe aux mains de médiocres ou d’imbéciles, ils montreront leur supériorité en se livrant à des représailles plus ou moins justifiées : ainsi se recrutent les tchékistes, les tortionnaires des polices politiques et les gardiens des camps de concentration. Rien n’est plus dangereux que de donner du galon à un crétin et de l’élever à la dignité de caporal ou de contremaitre…
Et penser-vous que ces individus, ayant joui d’un pouvoir illimité et profité des avantages matériels attachés à leurs fonctions, accepteront de disparaître, de reconnaître leur inutilité et de proclamer que l’Etat – leur État ! doit dépérir ? Peut-on imaginer qu’une classe disposant d’une autorité absolue signe d’un cœur léger son arrêt de mort et se suicide délibérément ? Rien que l’énoncé de ces questions montrent la naïveté et l’irréalisme de la théorie léniniste. La nouvelle classe dirigeante montrera son utilité toujours croissante et réprimant des complots imaginaires, en frappants les oppositions, les fractions, les « anti-Parti », en étendant son pouvoir sur toutes les activités, en contrôlant les pensées des individus, en un mot en réalisant l’Etat totalitaire. Dés 1918, on pouvait prévoir que telle serait l’évolution fatale de la dictature du prolétariat, et les Républiques populaires crées après 1945 ont suivi la même voie, sans en excepter la République de Tito. Et lorsque Djilas écrit : « il n’y a ni air ni lumière sous le poing de fer du gouvernement communiste », il justifie le propos de Bakounine : « La liberté sans le socialisme, c’est le privilège, l’injustice. Le socialisme sans liberté c’est l’esclavage et la brutalité. »
****
Les sectes trotskystes condamnent sévèrement le stalinisme et dénoncent le régime autoritaire de l’U.R.S.S. Ils en constatent les vices et les impostures, mais ils restent fidèles au marxisme-léninisme de grand-papa. La dictature du prolétariat, convenablement exercée, doit conduire au dépérissement de l’État. Pour eux, la théorie reste vraie, seule l’application a été faussée. Condamner la théorie, c’est le fait de l’infantilisme anarchiste et l’on sait fort bien que Trotsky avait fort peu de sympathie pour les anarchistes… Comment expliquer cette « déviation » du parti bolchevik ? Les trotskystes ont trouvé une raison qui se traduit par un mot magique : la Bureaucratie. C’est la bureaucratie qui a engendré tous les maux, c’est elle le bouc émissaire, c’est elle le monstre fabuleux qui s’emparant du parti et de l’état prolétarien en a fait ce que Djilas dénonce ! Est-ce de la part des trostkystes naïveté ou imprudence ? La dictature du prolétariat, exercée par une minorité, nécessitait un appareil important capable de réagir à la fois la police, l’armée, l’économie les syndicats, la jeunesse, les intellectuels. Lorsque Lénine, en 1918, a refusé à la classe ouvrière toute spontanéité créatrice, toute capacité d’autogestion, lorsqu’il a tout soumis à la dictature de son parti, la création d’une bureaucratie nombreuse et autoritaire devenait la condition même du développement de la révolution bolchevique. La bureaucratie n’est pas une déviation ou une usurpation passagère : elle naît de la dictature d’une minorité et elle est la base indispensable d’un État qui tend à être totalitaire. Et je pense que Staline avait raison lorsqu’il déclarait Après l’accomplissement du premier plan quinquennal : « Si nous n’avions pas crée l’appareil, nous serions perdus. » La dictature du prolétariat ? Ce fut dès le début, et toujours davantage, la dictature des apparatchiks.
LA SOCIÉTÉ POST-RÉVOLUTIONNAIRE
Transformer la société n’est pas seulement savoir comment se fera la révolution, mais préciser l’image de la société post-révolutionnaire. Les combattants de Juin 1948, ceux de la Commune de Paris et plus généralement tous les révolutionnaires luttaient et mourraient non pour des idées abstraites, non pour la philosophie, mais pour conquérir un peu de liberté et de d’égalité. La société future, c’est d’abord pour les déshérités et les exploités un monde d’où seront bannies les injustices et les inégalités criantes et où ils jouiront d’une vie moins pénible, je ne dis plus heureuse car le bonheur ne dépend point seulement d’une transformation de l’économie. Il ne saurait être question de décrire le monde parfait de l’avenir et de rêver une société utopique dont la science-fiction moderne nous offre maintes images. La société réglementée de Fourier ou de Weitling est plutôt affligeante, sinon sinistre. Et le monde que décrit Dejacque dans « l’Humanisphère » (1861) donne la chair de poule ! On ne peut que féliciter Marx de s’être refusé à préciser les formes de la société communiste, et de décrire par le menu ses institutions. Mais il est catégorique sur le but final à atteindre, ce que Lénine appellera la phase supérieure de la société communiste : « …Quant avec le développement multiple des individus, les forces productrices s’accroîtront et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l’étroit horizon du droit bourgeois pourra être complètement dépassé et la société pourra inscrire sur ses drapeaux : « De chacun selon ses capacités, à chacun ses besoins. » (Critique du Programme de Gotha »). Et Lénine, qui cite texte dans « l’Etat et la Révolution », ajoute : l’Etat pourra disparaître totalement quand la société aura réalisé le principe : de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, c’est-à-dire quand les hommes se seront si bien habitués à observer les règles fondamentales de la vie en société, et que leur travail sera devenu si productif qu’ils travailleront volontairement selon leurs capacités. »
Cette phase supérieure de la société communiste ne diffère en rien d’essentiel du communisme anarchiste que Kropotkine a étudié dans la « Conquête du pain » : « …C’est le communisme sans gouvernement, celui des hommes libres. C’est la synthèse des deux buts poursuivis par l’humanité à travers les âges : la liberté économique et la liberté politique. » Il est évident que nul ne pense réaliser le communisme anarchiste intégral, immédiatement après l’acte révolutionnaire. La formule à chacun selon ses besoins suppose une production accrue sans une augmentation de la fatigue humaine, c’est-à-dire une organisation rationnelle du travail et une utilisation étudiée des machines. La question essentielle est donc de savoir d’après quels principes fondamentaux se développera ce que Lénine appelle la première phase de la société communiste. La dictature du prolétariat, dit-il, ne fera pas disparaître toutes les inégalités ; « La justice et l’égalité, la première phase du communisme ne peut donc pas encore les réaliser ; des différences dans la richesse subsisteront et des différences injustes ». Mais le dépérissement de l’Etat conduira à la phase supérieure et à la disparition des inégalités. On a vu ce qu’il faut penser du schéma marxiste-léniniste. Loin de conduire à la société sans classes et au communisme anarchiste, il faut dès le début de la période post-révolutionnaire s’orienter vers des formes de la société comportant le maximum de liberté et d’égalité, le minimum d’autorité et de gouvernement. Tendre vers quelque chose, c’est s’en rapprocher de façon continue. On ne tend pas vers la liberté en instaurant la dictature. On ne tend pas vers l’égalité en perpétuant les privilèges de classe !
Nous avons déjà vu que les anarchistes n’admettent point l’idée d’une révolution dirigée par un parti, par une fraction de la classe ouvrière et imposant par la dictature sa volonté au reste du peuple et aux autres fractions du prolétariat. Ils envisagent seulement une révolution inspirée et réalisée par les organisations économiques de la classe ouvrière, avec la collaboration ou l’assentiment de la paysannerie et de la classe moyenne : ceci suppose que la classe ouvrière veut et peut gérer l’économie et a déjà crée des cellules d’autogestion et des organismes d’études de la société économique future. Le problème est donc de faire disparaître cette hiérarchie du capitalisme qui transforme le producteur en salarié, et cette hiérarchie de l’Etat qui opprime les individus et les communes. L’anarchisme se propose donc de substituer l’organisation autonome des producteurs aux hiérarchies extérieures : la vie de la société ne vient pas d’en haut, elle doit poindre d’en bas. Ce que Proudhon appelle le système fédéral sera un équilibre entre la société tout entière et les groupes multiples. Les entreprises occupant un grand nombre d’ouvriers de diverses spécialités constitueront des unités industrielles dont la gestion sera confiée aux producteurs eux-mêmes. Proudhon donne ainsi la première idée de ce que nous appelons maintenant l’autogestion ouvrière. Ces unités industrielles constitueraient des fédérations nationales et ainsi on concilierait l’autonomie et la coordination. La fédération industrielle serait doublée d’une fédération agricole : Proudhon conserve l’indépendance des producteurs paysans individuels, mais il est évident que la situation a évolué et que maintenant les paysans tendent à se grouper et à constituer des syndicats et des coopératives.
Le seul système qui peut, au lendemain de la révolution, supprimer le centralisme économique et le pouvoir d’Etat c’est, dans le domaine de l’économie, la fédération, qui sauvegarde la liberté et la spontanéité des producteurs. A la base l’autogestion tient compte des possibilités et des nécessités de la production ; à tous les échelons les représentants des ouvriers sont choisis non d’Après leur appartenance à un parti politique, mais d’après leur compétence sur tel ou tel point particulier de l’économie : responsables devant leurs mandants, ils ne sont point des permanents ou des bureaucrates. L’élément essentiel de discussion et de décision est, dans l’unité industrielle, le conseil ouvrier, c’est à-dire l’ensemble des ouvriers de l’unité. Les anciens syndicats qui furent les facteurs décisifs de l’acte révolutionnaire subsistent comme organismes d’études mais leurs propositions sont soumises à l’assemblée – ou conseil – des ouvriers.
Le fédéralisme économique se double du fédéralisme politique. Ce dernier, que Proudhon appelait aussi décentralisation, brise le dogme de l’Etat centraliste et autoritaire. L’Etat disparaît en tant qu’instrument central et ses fonctions ou bien disparaissent, ou sont transférées à ces organismes décentralisés que sont les communes. L’Etat traditionnel empiétait toujours davantage sur les activités des communes. En rendant aux communes leur indépendance, on rend à la base même de la société toutes ses possibilités de développement harmonieux et de vie collective. La commune, en tant que groupe local, joue un rôle correspondant à celui de l’atelier, en tant qu’unité industrielle. On criera peut-être à l’utopie. En effet, nombreux sont ceux qui ne peuvent imaginer l’Etat dépossédé de toutes les fonctions qu’il a peu à peu assumées et de tous les services qu’il gère au lieu et place des communes. Le fédéralisme serait un retour au bon sens et la mort de la bureaucratie tatillonne et autoritaire, ce serait « le remplacement de l’ancienne organisation fondée, de haut en bas, sur la violence et le principe d’autorité, par une organisation nouvelle n’ayant d’autre base que les intérêts, les besoins et les attractions naturelles des populations, ni d’autre principe que la fédération libre des individus dans les communes, des communes dans les provinces, des provinces dans les nations. » (Bakounine, « Fédéralisme, socialisme, antithéologisme ».)
Ainsi fédération agricole-industrielle et fédération politique sont les garants de la liberté du producteur et de l’individu. Une telle organisation permettrait de se diriger vers cette phase supérieure du communisme en introduisant, dès la période post-révolutionnaire, autant de liberté et autant d’égalité qu’il est possible dans les rapports humains. Proudhon, qui aimait les formules bien frappées, résumait son ouvrage « Du principe fédératif » par ces quelques mots : » Qui dit liberté, dit fédération, ou ne dit rien. Qui dit république, dit fédération ou ne dit rien. Qui dit socialisme dit fédération, ou ne dit rien ».
****
Fédéralisme, communes, autogestion ont suscité l’ironie ou l’hostilité des marxistes et des léninistes. Le fédéralisme de Proudhon, le communalisme des ouvriers parisiens apparaissaient comme des puérilités aux yeux de Marx. Quant à l’autogestion, voici comment, en 1922, Lénine l’exécute : « Toute ingérence directe des syndicats dans la gestion des entreprises doit être reconnue pour absolument néfaste et inadmissible ». (Du rôle et des tâches des syndicats »). Et cependant marxistes et léninistes ont glorifié les ouvriers parisiens de 1871 : Ils avaient choisi le nom de fédéré et le mouvement animé par eux est connu partout sous le nom de la Commune. Certes, on trouvait chez les fédérés bien des idées disparates, bien des idéologies confuses, plus de bonne volonté et d’optimisme que de clarté et de sens aigu des réalités. Mais ce qui animait les plus clairvoyants, c’étaient quelques principes hérités de Prudhon et les idées bakouniniennes de la Première Internationale. Les mesures prises par la Commune, et dont Marx et Lénine font l’éloge, ressemblent fort peu au régime institué après 1918 en Russie par la dictature du prolétariat. Contrairement à ce qu’a écrit Lénine, les anarchistes n’essaient pas « de présenter la Commune de Paris comme une chose à eux », mais ils ne peuvent oublier que c’est au nom des idées des fédérés que les ouvriers et les marins de Cronstadt se révoltèrent contre la dictature du parti bolchévik : ils furent écrasés le 18 Mars 1921, alors que leurs assassins fêtaient hypocritement le cinquantième de la proclamation de la commune parisienne !.
Dans l’U.R.S.S. actuelle, que reste-t’il de l’exemple de la commune ? Rien : sur tous les points, le régime communiste est en contradiction absolue avec les idées des fédérés, ce qui n’empêche point, chaque année, cet hommage rituel que le vice rend à la vertu… il en est de la Commune de paris comme des soviets : ce sont des mots creux, vidés de toute signification et qui servent d’alibi à la nouvelle classe dirigeante. Les soviéts représentèrent, au début, le symbole d’une institution fédérale, anti centraliste, remettant l’économie aux mains des producteurs. Les soviets, c’étaient la promesse de l’auto-gestion et de l’autonomie des communes. Et maintenant ? « Les Soviets se transformèrent presque insensiblement de rassemblements révolutionnaires en une simple couverture pour la dictature totalitaire de la nouvelle classe et en une courroie de transmission pour le Parti.3 (Djilas).
Et cependant, dans ces régimes de dictature, lorsque des hommes se dressent pour réclamer un peu de liberté et d’égalité, ils invoquent la Commune de Paris. Ils ne font point appel au marxisme-léninisme même déstalinisé, mais aux fédérés et au mythe qu’ils ont crée. L’exemple le plus curieux est celui de cette nouvelle gauche qui s’est développés dans la province chinoise de Hunan en automne 1967 (11) : une organisation de jeune (Scheng-wu-lien) se constitua et réclama pour la Chine un régime inspiré par la Commune de Paris, c’est-à-dire un régime où le peuple se gouvernerait directement. en même temps, le Scheng-wu-lien exaltait l’idée de soviet et publiait, fin 1967, un programme dénonçant à la fois la majorité des dirigeants communistes d’avant la révolution culturelle, traités de capitalistes et de classe privilégiée, et les nouveaux chefs qui ne valaient pas mieux que les bureaucrates destitués. le Scheng-wu-lien publia aussi sous le titre : « Où va la Chine ? » un long texte développant ses critiques et ses buts. A la manifestation de masse du 21 mai 1968 à Pékin, cette nouvelle gauche lança le mot d’ordre Commune de Paris, mais les dirigeants du Parti mirent un terme à cette agitation. Le Scheng-wu-lien fut dénoncé comme anarchiste dans un tract inspiré par les fidèles de Mao : on relevait dix points où la nouvelle gauche était accusée d’anarchisme. Le Scheng-wu-lien a été étouffé, mais il est probable que chez beaucoup de jeunes persiste cette foi dans la Commune de Paris. Il est vraiment symptomatique que, dans la Chine de Mao qui accuse l’U.R.S.S. de révisionnisme, on considère comme une manifestation d’anarchisme le rappel des principes de la Commune de Paris, l’appel au gouvernement direct et l’évocation des soviets. De tels faits sont une justification de notre position et montrent que seule une révolution anarchiste, fédéraliste, communaliste viendra à bout des régimes totalitaires inspirés marxisme-léninisme.
LES ANARCHISTES ET LES HIÉRARCHIES
Les anarchistes, dit-on, sont opposés à toute hiérarchie et à toute autorité : donc l’anarchisme est une monstrueuse utopie rendant impossible une vie sociale coordonnée, car toute activité humaine suppose un cerveau qui commande et des mains qui obéissent = il y eut de même, il y a vingt siècles, de bons esprits qui croyaient à la pérennité de l’esclavage et, il y a cinq siècles, de non moins bons esprits qui considéraient le servage comme une nécessité sociale !
« Nous repoussons toute législation, toute autorité et toute influence privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortie du suffrage universel, convaincu qu’elle ne pourrait tourner jamais qu’au profit d’une minorité dominante et exploitante, contre les intérêts de l’immense majorité asservie. Voilà dans quel sens nous sommes réellement anarchistes. » (Bakounine – « Dieu et l’Etat ».)
Ce que nous repoussons, c’est l’autorité officielle et imposée des politiciens et des incompétents, des bons-à-tout et des propres-à-rien qui promènent d’un ministère à l’autre leur ignorance arrogante, des technocrates archi-diplomés qui, de leur bureau parisien, ont la prétention de diriger l’économie et la nation à coups de plan et de formules, des soi-disants savants qui traitent les problèmes humains comme des problèmes abstraits de mathématiques. En un mot, ce que nous repoussons, c’est l’autorité des gens incontrôlés pour qui l’individu n’est plus qu’un numéro, et l’ensemble des producteurs un vil bétail. On m’excusera de laisser la parole à Bakounine qui s’exprime en termes excellents :
« Sensuit-il que je repousse toute autorité ? Loin de moi cette pensée. Lorsqu’ils’agit de bottes, j’en réfère à l’autorité des cordonniers ; s’il s’agit d’une maison, d’un canal ou d’un chemin-de-fer, je consulte celle de l’architecte ou de l’Ingénieur. Pour telle science spéciale, je m’adresse à tel ou tel savant. Mais je ne me laisse imposer ni le cordonnier ni l’architecte ni le savant. Je les accepte librement… en réservant toutefois mon droit inconstestable de critique et de contrôle. Je ne me contente pas de consulter une seule autorité spécialiste, j’en consulte plusieurs ; je compare leurs opinions et je choisis celle qui me paraît la plus juste. Mais je ne reconnais point d’autorité infaillible,… je n’ai de foi absolu en personne. Une telle foi serait fatale à ma raison et ma liberté et au succès même de mes entreprises… Si je m’incline devant l’autorité des spécialistes, et si je me déclare prêt à en suivre, dans une certaine mesure et pendant tout le temps que cela me paraît nécessaire, les indications et même la direction, c’est parceque cette autorité ne m’est imposé par personne, ni par les hommes, ni par dieu… Je m’incline devant l’autorité des hommes spéciaux parcequ’elle m’est imposée par ma propre raison… La plus grande intelligence ne suffirait pas pour embrasser le tout. D’ou résulte, aussi bien pour la science que pour l’industrie, la nécessité de la division et de l’association du travail. Je reçois et je donne, telle est la vie humaine. Chacun est dirigeant et chacun est dirigé à son tour. Donc il n’y a pas d’autorité fixe et constante, mais un échange continu d’autorité et de subordination mutuelles, passagères et surtout volontaires. » (« Dieu et l’Etat »).
Ce texte expose lumineusement comment peut fonctionner de la base au sommet la fédération industrielle, les compétences étant choisies et constituées à chaque échelon. Dans une telle organisaton disparait l’actuelle hiérarchie inamovible, cette technocratie dominée par les franc-maçonneries des diplômés de Polytechnique, de l’E.N.A. et de l’inspection des Finances qui mettent au service du capitalisme et de l’Etat leur science indéniable et leur inhumanité non moins indéniable.
Mais un danger subsiste : après avoir brisé les cadres hiérarchisés, le peuple pourrait, poussé par une admiration aveugle et naïve envers la science, laisser se reconstituer un gouvernement de savants. La foi dans la Science et le Progrés indéfini avait marqué le XIXe siècle. Si le XXe siècle a enlevé à l’homme de la rue quelques illusions sur les réalisations de la science et les miracles de la machine, les savants et les spécialistes jouissent encore d’un large crédit. Bakounine avait dénoncé cette tyrannie de la science sur l’homme : « La science, c’est la boussole de la vie, mais ce n’est pas la vie… La science a pour mission unique d’éclairer la vie, non de la gouverner… La science est l’immolation perpétuelle de la vie fugitive, passagère, mais réelle sur l’autel des abstractions éternelles ». Et prévoyant qu’un jour les savants , non contents d’être ingénieurs des choses, voudraient être ingénieurs des âmes, Bakounine écrit : « Ce que je prêche, c’est donc jusqu’à un certain point la révolte de la vie contre la science ou plutôt contre le gouvernement de la science, non pour détruire la science – ce serait un crime de lèse-humanité – mais pour la remettre à sa place, de manière qu’elle n’en puisse plus jamais sortir… l’Aristocratie savante ! au point de vue pratique, la plus implacable, et au point de vue social, la plus vaniteuse et la plus insultante : tel serait le pouvoir constitué au nom de la science. Ce régime serait capable de paralyser la vie et le mouvement de la société. Les savants, toujours présomptueux, toujours suffisants et toujours impuissants, voudraient se mêler de tout, et les sources de la vie se dessécheraient sous leur souffle d’abstractions. »
Détruire la hiérarchie des autorités, c’est le premier pas vers la liberté des individus et des groupes de producteurs. Mais on ne tendra vers l’égalité que si l’on détruit la hiérarchie des salaires. Il ne s’agit point ici d’évoquer le communisme anarchiste, cette phase supérieure de la société communiste, ou chacun travaillant selon ses capacités pourra satisfaire ses besoins et où l’argent ne sera plus qu’un mauvais souvenir des temps anciens. Je me place dans cette période de transition, ou le fédéralisme industriel et politique aura remplacé l’Etat capitaliste, où il faudra liquider le lourd héritage des vieilles idéologies et où se posera, dans l’immédiat, le problème quotidien de la rétribution du travail. Nous repoussons la théorie léniniste qui a abouti à une société sans liberté et sans égalité. Nous pensons que le fédéralisme conduit à la liberté, mais si nous n’instaurons pas le maximum d’égalité, jamais nous n’arriverons au communisme anarchiste et nous courrons à un échec certain. Je dis même que l’inégalité des salaires est un principe si fortement ancré dans l’esprit des individus, qu’il faut déjà, dans la société actuelle, combattre ce principe et le saper dans la mesure du possible.
Dans le monde capitaliste – et dans cette partie du monde qui se prétend socialiste – tout s’exprime en argent : l’individu, sa fonction, son métier, son degré de respectabilité, sa place dans la société. L’inégalité des rétributions distingue le chef du subordonné, celui qui est à un échelon supérieur du manœuvre qui est au bas de l’échelle. Même la rétribution due au travail change de nom : toucher un salaire est moins honorable que percevoir des appointements, un traitement, une solde ou des honoraires ! tout le système social repose sur cette inégalité des revenus qui assure aux uns largement le superflu et aux autres moins que le nécessaire. Si l’on réfléchit à cette inégalité, on s’aperçoit qu’elle n’est fondée ni sur l’utilité du travail, ni sur son caractère pénible ou dangereux, ni sur le temps mis à effectuer, ni même sur la plus ou moins grande intelligence de l’individu. Tout semble arbitraire et incohérent. Mais très vite on se rend compte que le travail qui se fait dans le monde des privilégiés est presque exclusivement un travail nerveux, c’est-à-dire celui de l’imagination, de la mémoire et de la pensée ; tandis que le travail des millions de prolétaires est un travail musculaire, et souvent, comme dans toutes les fabriques, par exemple, un travail… qui se fait dans des conditions nuisibles à la santé du corps et contraires à son développements harmonieux ». (Bakounine). Tout se passe comme si pesait sur une partie de l’humanité la malédiction du travail manuel et ce mépris séculaire à l’égard de ceux qu’on appelait jadis les mécaniques. Comme l’écrit notre camarade Louzon dans la « Révolution Prolétarienne » (février 1970) : « l’exploitation a toujours été basée sur le même motif : la différence de valeur entre les différentes sortes de travaux. Tous les travaux, prétend-on, n’ont pas la même valeur ; il y a des travaux ou des fonctions « nobles tandis que d’autres ne le sont pas… Le travail manuel est un travail de qualité inférieure ; ceux qui effectuent un travail « supérieur », un travail où ne ne se salit pas les mains, ont donc droit d’abord à une considération particulière et ensuite à une part du travail des manuels… »
L’homme de la rue, le bon citoyen, justifie en général l’inégalité des salaires par deux arguments ;
1) n’importe qui peut faire un manœuvre alors que n’importe qui ne peut pas faire un ingénieur. Mais alors vous faites fi de l’effort fourni et de l’utilité du travail effectué. Et ne pourrait-on pas dire que certains métiers manuels exigent une endurance et une force physique dont sont privés bien des grattes-papier mieux favorisés par la hiérarchie des salaires ?
2) Certaines professions exigent de longues études – donc des dépenses – des frais élevés d’installation, l’achat d’une charge ou d’un cabinet. Il est normal que ces capitaux investi procurent une rente : cette rente, c’est le revenu que percevra, durant toute sa vie, l’ingénieur, le notaire ou le médecin. En régime capitaliste, cet argument est inattaquable : l’argent investi doit à son tour créer de l’argent ! nous reviendrons plus loin sur cette question.
Ce qui me parait essentiel, c’est de savoir si dans la période post-révolutionnaire, dans cette première phase qui conduira au communisme anarchiste, persisteront les inégalités héritées du régime capitaliste. S’il doit en être ainsi, si une nouvelle classe de privilégiés se constitue, si le camarade de l’appareil continue à traiter le camarade ouvrier en parent pauvre, à quoi bon faire une révolution ? A quoi bon réclamer l’appropriation collective des moyens de production, si le producteurne fait que changer de maîtres, avec la seule promesse fallacieuse d’une égalité rejetée dans l’avenir, selon la formule consacrée : demain on rasera gratis ? Si donc, dans cette première phase où subsistent sans doute l’argent et les rémunérations traditionnelles, nous ne réalisons pas dans le plus bref délai l’égalité des salaires – le maximum d’égalité possible – la révolution ne sera qu’une qu’une monstrueuse escroquerie.
Tous les penseurs anarchistes ont étudié cette question. Pour Bakounine,l’égalisation des revenus s’impose. Kropotkine dans « la Conquête du pain » condamne tout système de rétribution du travail (argent ou bon de travail). Ce qu’il appelle le salariat collectiviste est incompatible avec le communisme supérieur. On peut trouver qu’il fait preuve d’un optimisme exagéré : je n’en discuterai pas. L’essentiel ici c’est la condamnation absolue des inégalités résultant des diverses sortes de travail.
La position de Proudhon est plus nuancée et marque quelques hésitations. Son souci de l’égalité lui fait condamner la constitution hiérarchique préconisée par les saint-simoniens. Produire est un acte collectif et par suite aucun individu ne peut exiger une part privilégiée pour son apport personnel et ceci est valable même pour l’inventeur et l’homme de génie. La rétribution est proportionnelle au travail fourni : seul compte le temps de travail et les journées de travail sont égales quelle que soit la nature du travail. On trouve donc chez Proudhon une condamnation très nette de l’inégalité entre le travail « noble et le travail manuel. Et Proudhon sait, à ce sujet, manier l’ironie et la formule percutante : « Je crois, je dis et j’affirme que tel ouvrier dépense plus d’esprit à ferrer un cheval, que tel feuilletonniste à écrire une nouvelle ! » Et encore : « Toute prééminence sociale accordée, ou, pour mieux dire, extorquée, sous prétexte de supériorité de talent ou de service est iniquité et brigandage. » Il rejoint ici Bakounine : « Je ne pense pas que la société doive trop engraisser les hommes de génie, ni surtout leur accorder des privilèges ou des droit exclusifs quelconques ; et cela pour trois raisons : d’abord parcequ’il lui arriverrait souvent de prendre un charlatan pour un homme de génie, ensuite parce que, grâce à ce système de privilèges, elle pourrait transformer en un charlatan même un véritable homme de génie, le démoraliser l’abêtir ; et enfin parce qu’elle se donnerait un maître. » Je parlais plus haut des hésitations de Proudhon : chez lui, comme chez Bakounine, on rencontre des contradictions. C’est ainsi qu’il a admis qu’un citoyen prodige (?) pourrait gagner seize (?) fois plus qu’un citoyen ordinaire. Boutade ? Inconséquence ? Peut-être excusait-il – dans une vision prophétique – les salaires des modernes « idoles » de la chanson…
Il reste à examiner, sur cette importante question, les points de vue de Marx et de Lénine et de voir comment l’Etat prolétaire a résolu le problème des salaires en U.R.S.S. et dans les républiques populaires. Il l’est encore davantage sur la question de l’inégalité des salaires ! Tout le monde connait « la guerre civile en France » et nul n’ignore que Marx a félicité la commune de Paris pour avoir supprimé « les bénéfices d’usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l’Etat », et pour avoir décidé que « depuis les membres de la Commune jusqu’au bas de l’échelle, la fonction publique devait être assurée pour des salaires d’ouvriers ». Notons à ce sujet la persistance d’une légende tenace. Comme l’en fait remarquer Kropotkine « La Commune décida de payer les membres du Conseil de la Commune quinze francs par jour, tandis que les fédérés aux rempart ne touchaient que trente sous ». Passons… Je crois qu’on ne trouve dans Marx qu’un texte traitant de l’inégalité des salaires, et d’ailleurs pour la justifier. Pour Marx, la valeur d’une marchandise se mesure par le temps de travail socialement nécessaire pour sa production. Or l’ouvrier qualifié (et aussi le technicien, l’ingénieur, l’intellectuel) produit dans le même temps des objets qui pont plus de valeur que la production d’un simple manœuvre. Voici comment Marx justifie cette valeur supérieure : il oppose au travail complexe de l’ouvrier qualifié le travail simple du manœuvre et il écrit (12) : « Ce travail complexe n’est qu’une puissance du travail simple, ou plutôt n’est que le travail simple multiplié, de sorte qu’une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. » Explication complexe est une puissance du travail simple. Ou Marx n’explique rien ou il reprend – sous une forme détournée – l’argument n° 2 dont je parlais plus haut. Le travail complexe tire sa valeur du capital investi dans la période d’études et de formation, capital qui provient du travail social de la collectivité. Mais alors ce capital, qui est un travail mort, devient productif, ce qui est en contradiction avec la théorie marxiste. En fait Marx justifie la création d’une nouvelle classe de techniciens, de dirigeants analogue à la classe capitaliste. Et c’est bien ce qui s’est produit…
Lénine, dans « l’Etat de la Révolution », fait, lui aussi, l’éloge des mesures prises par la Commune et prend une position très nette : « on peut et on doit, dès à présent, du jour au lendemain, commencer à remplacer la hiérarchie spécifique des fonctionnaires de l’Etat par de simples fonctions de surveillants et de comptables, fonctions qui, dès aujourd’hui, sont en général parfaitement accessibles au niveau de développement des citadins et parfaitement réalisables pour le salaire d’un ouvrier. » Et Lénine considère comme « une tâche concrète, pratique, immédiatement réalisable », la rémunération du travail « de tous les techniciens, des surveillants, des comptables, ainsi que de tous les fonctionnaires publics », selon un salaire d’ouvrier. Mais ce que donne Lénine, il le retire aussitôt, car, dans la première phase de la société communiste, ces salaires d’ouvriers seront inégaux : « on continuera à protéger le droit bourgeois qui consacre l’inégalité défait ». La répartition des objets de consommation se fera encore selon le travail, mais la nature du travail intervient : travail complexe ou travail simple. Parler d’égalité et de justice en général, c’est là « une formule confuse et petite-bourgeoisie.
L’état prolétarien n’a que trop bien suivi cet enseignement : la société qu’il a fondée est strictement hiérarchisée, autant, sinon plus, que le monde capitaliste. L’éventail des salaires et des revenus est largement ouvert et la nouvelle classe dirigeante est non moins largement privilégiée. La tendance à l’inégalité n’a fait que se développer, s’est affirmée à l’époque stalinienne et rien ne permet actuellement de prévoir un affaiblissement de la hiérarchie. Ce qu’écrivait Djilas en 1957 reste toujours vrai : « …Le salaire annuel moyen de l’ouvrier en U.R.S.S. se chiffrait en 1935 par 1.800 roubles seulement, tandis que le traitement et le indemnités perçus par le secrétaire d’un comité de rayon formaient un revenu annuel de 45.000 roubles ; la situation des ouvriers et celle des fonctionnaires du parti ont évolué depuis lors, mais la différence est restée d’un même ordre de grandeur…Dans un régime communiste, l’exercice du pouvoir politique est la vocation idéale de tous ceux qui veulent vivre en parasites aux dépens des autres… Le secrétaire du Parti et le chef de la police secrète jouissent , dans la plupart des localités, des plus beaux immeubles, automobiles et autres privilèges matériels… Des quartiers résidentiels spéciaux et des maisons de repos réservées deviennent l’apanage de la haute bureaucratie dirigeante. » En Yougoslavie, où « les salaires réels des ouvriers et des employés sont plus bas qu’ils ne l’étaient avant la deuxième guerre mondiale ». Djilas dénonce la prétendue gestion ouvrières : « Qu’est-ce qu’une gestion ouvrière qui n’est pas accompagnée d’un partage des profits entre eux qui travaillent, que ce soit à l’échelle locale ou nationale ? »
Ce triste bilan d’un demi-siècle de dictature du prolétariat serait incomplet, si j’oubliais le discours prononcé par Staline, le 23 juin 1931, à la conférence des dirigeants de l’industrie. Staline s’élève contre les tendances à l’égalitarisme, au « nivellement gauchiste dans le domaine des salaires ». Il faut ouvrir bien plus largement l’éventail des salaires et ceux qui défendent les principes du nivellement brisent avec le marxisme et le léninisme. Au 17e congrès du Parti (1934), Staline devait préciser sa pensée (si l’on peut dire !) : « Par égalité, le marxisme entend, non pas le nivellement des besoins personnels et de la manière de vivre, mais la suppression des classes. Le marxisme n’a jamais reconnu ni ne reconnaît d’autres inégalités ». On supprime théoriquement les classes mais elles renaissent pratiquement. A une minorité d’exploiteurs succède une autre minorité d’exploiteurs et Staline pourra lancer en 1935 ce mot d’ordre nouveau : »les cadres décident de tout ». Devant cet aveu cynique de la dictature d’une nouvelle classe, devant cette glorification de l’Appareil, peut-on imaginer possible une conciliation entre les anarchistes d’une part, et les marxistes-léninistes-stalinistes d’autre part ?
ANARCHISME, SYNDICALISME ET POLITIQUE
J’ai parlé à maintes reprise des organisations propres au prolétariat, des organisations économiques et professionnelles de la classe ouvrière : ce sont – en langage plus moderne – les syndicats et les coopératives. Dans la pensée de Proudhon comme de Bakounine, ces organisations sont des créations originales des travailleurs. Indépendantes de l’Etat et de la classe bourgeoise, elles assurent la séparation entre prolétariat et classe capitaliste. Ce sont à la fois des organismes de défense (qu’on songe à la vieille appellation : société de résistance) et des organisme d’attaque. Leur rôle est dans l’immédiat d’améliorer le sort de l’ouvrier,dans l’avenir de transformer la société en abolissant le salariat. Qu’est devenu le rôle du syndicat dans la théorie marxiste et
léniniste et dans la pratique soviétique ? On cite souvent cette déclaration de Marx, affirmant que les syndicats ne peuvent remplir leur rôle que s’ils sont indépendants des partis politique. Mais on est obligé de constater que ceux qui se réclament du marxisme, qu’ils soient réformistes ou révolutionnaire, ont tout fait pour domestiquer les syndicats et les soumettre aux directions autoritaires des partis se réclamant de la classe ouvrière. Le syndicalisme allemand fut étroitement subordonné au parti social-démocrate (il en est encore de même !). Quant à Lénine, on sait comment 1902 il refusait à la classe ouvrière toute spontanéité créatrice : les syndicats ne pouvaient dépasser le stade du réformisme trade-unioniste. Seul le parti avait conscience de son rôle révolutionnaire et pouvait diriger la masse ouvrière. Après une vague éclipse, cette théorie réapparut en 1918 et fut systématiquement appliquée. Lénine – on l’a vu plus haut – refusa toute ingérence directe des syndicats dans le domaine de la production. Peu à peu les syndicats devinrent des rouages de l’Etat, chargés de veiller dans les usines à la stricte application des ordres de l’appareil dirigeant : contrôle du travail, accélération du rythme de ce travail, glorification des stakhanovistes, organisation des emprunts forcés, votes de motions exigeant l’exécution des oppositionnels et autre agents de l’impérialisme. En somme, l’appareil syndical est une police d’usine aux ordres du parti : rien d’étonnant si récemment on désigna comme secrétaire de la centrale syndicale le grand responsable de la police d’Etat : il ne changeait guère de fonction ! Djilas résume ainsi cette situation : « Les syndicats, par leurs buts et leurs fonctions, ne peuvent être en régime communiste que l’apanage d’un seul possesseur en potentat, l’oligarchie politique elle-même ; c’est pourquoi leur finalité principale consiste à « construire le socialisme » – en intensifiant la production. Le reste de leur tâche, c’est de répandre des illusions et d’entretenir ainsi la docilité des travailleurs sous prétexte de hausser le niveau culturel des masses. »
***
Nul ne prévoyait un tel avilissement des organisations ouvrières, lorqu’à la fin du siècle dernier les anarchistes entrèrent dans les syndicats. L’importance de cet événements fut soulignée par Fernand Pelloutier dans un article intitulé « L »Anarchisme et les Syndicats ouvriers » et paru en novembre 1895 dans les « Temps nouveaux » (13) : « …Cette entrée des libertaires dans le syndicat eut un résultat considérable. Elle apprit d’abord à la masse la signification réelle de l’anarchisme, doctrine qui, pour s’implanter, peut fort bien, répétons le, se passer de la dynamite individuelle ; et, par un enchaînement naturel d’idées, elle révéla aux syndiqués ce qu’est, et ce que peut devenir cette organisation corporative dont ils n’avaient eu jusqu’alors qu’une étroite conception… Que les homme libres entrent donc le syndicat, et que la propagation de leur idées y prépare les travailleurs, les artisans de la richesse, à comprendre qu’ils doivent régler leurs affaires eux-même, et à briser, par suite, le jour venu, non seulement les formes politiques existantes, mais toute tentative de reconstruction d’un pouvoir nouveaux ».
Le syndicalisme révolutionnaire devait naître de cette pénétration des idées libertaires dans le mouvement ouvrier.Il avait l’ambition d’être une doctrine nouvelle, une théorie entre les théories anarchiste et socialiste, une doctrine se suffisant à elle-même (déclaration de Latapie au congrès d’Amiens – 1906) (14). La théorie et la pratique du syndicalisme révolutionnaire sont exposées dans les brochures écrites par Pouget, Grueffelhes, Jouhaux et sont résumées dans la charte votée à la quasi-unanimité au congrès syndical d’Amiens. Le syndicat a une double tâche : quotidienne et d’avenir. Groupement de résistance, il deviendra le groupement de production et de répartition et il est le groupement essentiel. Il lutte contre toutes les formes d’exploitation, et il lutte directement. Il doit être indépendant des partis et des sectes. Il « préconise comme moyen d’action la grève générale ».
Certes, on retrouve dans la chartes d’Amiens et dans tous les écrits des militants syndicalistes révolutionnaires l’influence de la pensée de Proudhon et de Bakounine, mais il serait inexact de dire que le syndicalisme révolutionnaire se confond avec l’anarchisme. L’emploi du mot sectes dans la charte d’Amiens marque une méfiance à l’égard de l’anarchisme. Le & prépondérant du syndicat dans la période post-révolutionnaire réduit à néant celui de la commune dont le nom n’est même pas prononcé. Là, peut-être apparait la différence essentielle entre anarchisme et syndicalisme révolutionnaire, et l’on comprend que par la suite les anarchistes participant au mouvement syndical aient plutôt l’appellation d’anarcho-syndicalistes. Je n’insisterai pas sur le congrès anarchiste d’Amsterdam (1907) où s’opposèrent les deux conceptions : l’anarchisme défendu par Malesta, le syndicalisme révolutionnaire défendu par Monatte Ces débats n’ont plus maintenant qu’un intérêt historique, tant d’événements ayant, en soixante ans, bouleversé le mouvement syndical !
Le syndicalisme révolutionnaire était fondé sur cette idée bien proudhonienne d’une classe ouvrière autonome, séparée de la classe capitaliste et de l’Etat, ayant pris conscience des intérêts communs à tous les travailleurs et rebelle aux sollicitations des partis politiques. Deux dangers menaçaient cette unité du prolétariat : l’intégration à l’Etat, la domestication par un parti politique, et elle ne put survivre à l’acceptation de l’Union sacrée, puis du rôle dirigeant du Parti Communiste.
Dans la C.G.T. et la C.G.T.U., puis dans la C.G.T. réunifiée avec la permission de Staline, la pensée syndicaliste révolutionnaire ne disparut pas tout à fait, grâce à des noyaux de militants ne pliant pas sous les insultes et les menaces d’exclusion. Les anarcho-syndicalistes se groupèrent dans la C.G.T.S.R., numériquement faible, mais dont l’action ne fut pas négligeable de 1936 à 1939.
En 1970 ? la classe ouvrière est plus que jamais divisée : six centrales ou groupements syndicaux se partagent une minorité d’ouvriers et une majorité de fonctionnaires : tout le monde se réclame de la Charte d’Amiens… et jamais il n’y eut tant de maquignonnages dans les préfectures et les ministères… et jamais on ne vit une C.G.T. davantage aux ordres du parti communiste ! la création d’une C.N.T. anarcho-syndicaliste a échoué : nombre infime d’adhérents et action à peu près inexistante. Dans la C.G.T., toute opposition a disparu et les éléments suspects d’anarcho-syndicalisme ont été exclus. Cependant, dans la C.G.T.-F.O., et dans la fédération de l’éducation nationale subsistent des noyaux d’opposition syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste. A la suite des mouvements d’étudiants et d’ouvriers qui, en mai 68,, se sont heurtés à la violence répressive de la démocratie bourgeoise, et au désir des bureaucraties syndicales de freiner l’action et de maintenir leur autorité, un regroupement s’est effectué : syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes ont tenu plusieurs conférences, édité une brochure « Le véritable syndicalisme » et fondé fin février 1970 « l’alliance syndicaliste » nettement orientée ver un syndicalisme libertaire. A cette alliance collaborent nos camarades de l’Union des anarcho-syndicalistes, dont le bulletin mensuel est déjà ancien (n° 95 en mars 70 !). Bien que la Charte d’Amiens soit toujours actuelle, il semble que, dans cette Alliance, le point de vue libertaire soit nettement affirmé. Il s’agit défendre dans les syndicats les idées anarchistes, de lutter contre la hiérarchie des salaires, contre le cumul des fonctions syndicales et politiques, contre la permanence à vie des bureaucrates. « Cette présence militante n’a rien de commun avec l’organisation d’une fraction style P.C.-C.G.T. ; elle n’a rien de commun non plus avec le noyautage pour prendre la direction des syndicats. Nous ne sommes pas la direction de rechange éventuelle. »(15)
Cependant, certains anarchiste pensent que le syndicalisme est tellement corrompu que c’est perdre son temps que de tenter un vain redressement. « Les syndicats ne sont que des organismes amenant les syndiqués à mieux s’intégrer dans le système bourgeois… Les syndicats sont non-réformables. » Ceci conduit à reconnaître l’incapacité des anarchistes à diffuser leurs idées à l’intérieur de groupements où ils sont en minorité. Que faire alors ? Rien, ou bien de constituer des comités d’action où se réuniront – en vase clos ! – des anarchistes et des gauchistes plus ou moins politisés. J’espère que ces camarades n’attribuent pas aux inorganisés toutes les qualités qu’ils refusent aux organisés : on vit jadis le Parti communiste, après avoir fait de la C.G.T.U. une centrale squelettique, faire appel aux inorganisés, et leur découvrir une conscience de classe qu’il refusait aux syndiqués. Dans les périodes de crise, en 36, en 68, les inorganisés – pas tous ! – participent aux mouvements, mais retombent pour la plupart dans cette apathie et cette indifférence qui rendent impossibles les tâches quotidiennes et ingrates de l’action syndicale. Inutile de nier que le rôle des anarchistes dans les syndicats est extrêmement difficile : mais c’est, je crois, une attitude un peu simpliste et trop commode que de reculer devant cet effort en proclamant dans un délire d’optimisme : « Recherchons la joie en nous et dans les autre… C’est ça, la révolution… Soyons des êtres humains soyons nous-mêmes – la jeunesse veut la vie et la joie » (16).
La participation des anarchistes au mouvement syndical est, comme on vient de le voir, une question complexe, maintes fois débattue et qui soulève encore des discussions passionnées. Au contraire, lorsqu’il s’agit de la politique – prise dans son sens le moins noble ! – il y a unanimité chez les anarchistes : l’unanimité du dégoût et du refus ! l’anarchisme n’a rien de commun avec la politique des partis, qu’ils soient bourgeois ou ouvriers, de droite, de gauche ou d’extrême-gauche. L’anarchisme combat tous les états-majors, avec l’appui de troupes disciplinées, s’efforcent – légalement ou non – de prendre le pouvoir, de remplacer un Etat par un autre État, et pour qui la Révolution est l’avènement d’une nouvelle classe dirigeante. Toutes les pages qui précèdent montrent le bien-fondé de la position anarchiste. Toute collaboration, même passagère, avec un parti politique est une duperie : un exemple suffira. Prenons le cas de ces manifestations anti-U.S.A. à propos de la guerre du Viet-Nam, auxquelles les communistes de toute obédience convient les naïfs. L’objectif est strictement limité : combattre l’impérialisme américain… sans la moindre allusion aux impérialisme russe et chinois. Cela va rejoindre la distinction entre guerres propres et guerres sales, bombes atomiques progressistes et bombes atomiques impérialistes. Les camarades qui participent à ces démonstrations hypocrites font le jeu de leurs pires adversaires : ils grossissent le nombre de ceux que les bolcheviks appellent « les idiots utiles »…
Il est une manifestation périodique de la politique que revêt aux yeux de l’Etat – de tous les Etats ! – une importance capitale : ce sont les élections. Voter est un devoir civique qui assure à l’autorité une justification légale. Voter pour des chefs consacre leur puissance. Même les Etats totalitaires organisent des élections : « C’est ainsi qu’en régime communiste, le peuple souverain doit, pour sauvegarder les apparences, confirmer ce que les communistes décident et approuver tout ce qu’ils font. » (Djilas). Je n’ai point l’intention de reprendre toute les critiques que depuis Rousseau on peut formuler à l’égard du parlementarisme et de la délégation des pouvoirs du peuple souverain à des représentants. Il suffit de souligner l’escroquerie du mécanisme électoral. Les électeurs participent à un jeu dont on leur impose les règles : les lois électorale visent essentiellement à assurer aux partis déjà au pouvoir (de gauche ou de droite) une majorité parlementaire. Selon les cas on préconise le scrutin majoritaire ou la représentation proportionnelle ou tel système bâtard imaginé à toutes fins utiles. Depuis 1919, peut-on dresser la liste complète de tous les modes de scrutin qu’ont connus les citoyens français ? Le découpage des circonscriptions est l’occasion de discussions sordides. Et après chaque scrutin, on assiste à la même comédie : les statisticiens du parti communiste pleurent sur les sièges que le scrutin majoritaire leur fait perdre ! Est-ce à dire que la représentation proportionnelle apporterait dans cette sinistre face un peu de justice ? Attention il s’agit d’éliminer les minorités trop faibles et l’on décide – comme en Allemagne ! – qu’une liste ayant moins de 5 % des suffrages est mise hors-la-loi. Il y a mieux : comme on craignait que le N.P.D. arrivât à 5 %, on a sérieusement discuté pour savoir si on ne porterait pas à 10 % ce minimum obligatoire !
Peut-on parler de liberté pour l’électeur ? il a la liberté de choisir entre des candidats désignés par les partis à la suite de marchandages aussi sordides que secrets. Il a la liberté de les écouter dans des exercices oratoires ou de lire une prose délirante riche en promesses et ruisselant d’optimisme. La télévision lui permet d’apprécier les sourires enjôleurs, les mentons volontaire, tous les artifices dont peuvent user des catins défraîchies pour raccrocher client. Après le vote, l’heureux élu échappe à tout contrôle et l’électeur n’a plus qu’à attendre la prochaine représentation qui se jouera selon le même scénario.
On reproche aux anarchistes leur coupable indifférence : en ne votant pas pour le candidat de gauche le plus favorisé, ils font le jeu de la réaction, car il existe, paraît-il, une énorme différence entre Servan-Schreiber et Chaban-Delmas, ou entre Pompidou et Duclos. Nous continuons à mettre dans le même sac les sales réactionnaires et les propres progressistes. Nous savons que les réformes importantes ont toujours été la conséquence de l’action directe des travailleurs et que, lorsque la pression du prolétariat a été assez forte, les majorités parlementaires de droite ou de gauche ont fini par céder ce qu’elles pouvaient plus défendre.
« Vous autre, anarchistes, diront enfin de bonnes âmes, en ne participant pas aux élections, vous vous privez d’un excellent moyen de propagandes. La campagne électorale permet de diffuser des idées, de « toucher les masses ». Il ne s’agit point tant d’avoir des élus que de convaincre des individus, etc., on reconnaît là l’argument traditionnel, depuis Lénine, des partis communistes. Nul, plus que Lénine, n’a attaqué le crétinisme parlementaire. Mais il pensait que l’action au parlement pourrait éclairer les masses. La fraction parlementaire communiste, résolument distincte des autres fractions, utilise le parlement comme une tribune d’où la propagande du parti s’exprime avec éclat. La position infantile de gauche du K.A.P.D. allemand hostile à toute participation électorale fut condamnée par Lénine comme une déviation anarchisante. C’est au nom des même principes que Duclos, Rocard, Krivine nagent dans le marais électoral : Oh ! ils n’espèrent pas être élus, mais ils veulent toucher les masses. Hélas ! dès qu’un parti ouvrier (où se disant tel !) a des élus, ceux-ci sont gagnés par la corruption parlementaire, se conduisent en gens de bonne compagnie, tiennent des propos châtiés et ne se distinguent plus de leurs collègues de droite. Parfois, ils deviennent même ministres dans un gouvernement bourgeois et tout le monde a pu apprécier l’action révolutionnaire d’un Thorez acoquiné avec De Gaulle…
Rien ne justifie une participation quelconque à la foire électorale. L’abstention des anarchistes est consciente et raisonnée : ce n’est point au Parlement qu’il faut faire entendre la voix des travailleurs, ce n’est point là que se décidera la transformation de la société, mais à l’atelier et dans la rue.
LES ANARCHISTES ET L’INDIVIDU
On distingue en général trois formes de l’anarchisme : l’anarcho-syndicalisme, le communisme anarchiste, l’individualisme. Dans la réalité il est bien difficile de classer un compagnon anarchiste dans l’une ou l’autre de ces tendances, et, en particulier, on peut dire que tous les anarchistes sont des individualistes, à condition toutefois de préciser le sens de ce terme. Les anarchistes luttent pour assurer le plein épanouissement de la personne humaine qui doit jouir de toutes les libertés compatibles avec une vie sociale harmonieuses ordonnée. Ils combattent donc les autorités abusives et incontrôlées, et les États qui, tous, tendent à faire l’individu un robot sans personnalité et un simple rouage dans une machine inhumaine. Ils dressent l’individu contre le froid déterminisme de l’économie et de la politique, et, avec Proudhon, ils proclament « l’insurrection de la raison des individus contre le raison des autorités ».
Mais les anarchistes condamnent cet individualisme d’origine bourgeoise, « cette tendance qui pousse l’individu à conquérir et à stabiliser son bien-être, sa prospérité, son bonheur, contre tout le monde, au détriment et sur le dos de tous les autres » (Bakounine). Aucun penseur anarchiste n’a montré avec plus de force que Bakounine la nécessité de concilier la liberté de chacun avec la liberté de tous, les droits de l’individu avec ceux du groupe social :
« La liberté des individus n’est point un fait individuel : c’est un fait, un produit collectif. Aucun homme ne saurait être libre en dehors de toute l’humaine société et sans son concours… Tout ce qui est humain dans l’homme, et plus que toute autre chose, la liberté, est le produit d’un travail social, collectif. Être libre dans l’isolement absolu est une absurdité inventée par les théologiens et les métaphysiciens qui ont remplacé la société des hommes par celle de leur fantôme, de Dieu… Pour être libre, j’ai besoin de me voir entouré et reconnu comme tel par les hommes libres… La liberté de tous, loin d’être une limite de la mienne comme le prétendent les individualistes, en est au contraire la confirmation, la réalisation et l’extension infinie. Vouloir la liberté et la dignité humaine de tous les hommes, voir et sentir ma liberté confirmée, sanctionnée, infiniment étendue par l’assentiment de tout le monde, voilà le bonheur, le paradis humain sur la terre. »
Bakounine reprend ces idées, presque avec les mêmes termes, dans le « Catéchisme Révolutionnaire » (Programme de la Fraternité internationale révolutionnaire – 1865) : « …L’homme n’est réellement libre qu’autant que sa liberté, librement reconnue et représentée comme par un miroirs la conscience libre de tous les autres, trouve la confirmation de son extension à l’infini dans leur liberté. L’homme n’est vraiment libre que parmi d’autres hommes également libres. »
Dans la « protestation de l’alliance » (1871) Bakounine montre que la liberté de l’individu n’est pas incompatible avec l’organisation, ni « avec la loi naturelle et sociale de la solidarité humaine » et il ajoute : « … La liberté même de chaque individu est la résultante toujours de nouveau reproduite de cette masse d’influences matérielles, intellectuelles et morales que tous les individus qui l’entourent que la société au milieu de laquelle il naît, se développe et meurt, exercent sur lui. Vouloir échapper à cette influence, au nom d’une liberté transcendante, divine, absolument égoïste et se satisfaisant à elle-même, c’est la tendance au non-être… Cette indépendance tant prônée par les idéalistes et les métaphysiciens, et la liberté individuelle conçue dans ce sens – c’est donc le néant. »
De même pour Proudhon l’anarchisme ne peut être confondu avec l’individualisme : les décisions de l’anarchisme ne sont pas individuelle mais collectives. La raison collective prend naissance dans les énergies individuelles libérées et dans la confrontation de ces énergies ; la spontanéité collective sera le résultat de ces affrontements et de ces tensions aboutissant à un équilibre sans cesse remis en question. La liberté de l’individu sera garantie par l’extention des opinions diverses dont aucune ne sera étouffée par que autorité supérieure. Proudhon voit dans les différents échelons du fédéralisme exaspéré stigmatisé par Bakounine. Darwin avait pris pour base principale de sa théorie de l’évolution, l’idée de conflit, la lutte pour la vie. Dans le domaine biologique, la lutte entre les individus aboutissait à l’élimination des êtres inférieurs ou plus faibles. T.H. Huxley, disciple de Darwin, avait encore accentué cette idée de combat inévitable et nécessaire entre les individus et entre les groupes : c’était la loi même de la vie. Une telle théorie – si elle était vraie – ruinait l’anarchisme qui veut fonder une société sur la coopération et l’l’entraide volontaire des individus. Kropotkine, dans « L’entraide, un facteurs de l’évolution » (1910), montra, en utilisant l’étude des espèces animales et des sociétés primitives, que l’entraide entre individus de la même espèce peut être considérée comme une loi naturelle. La lutte des individus à l’intérieur de l’espèce est exceptionnelle et n’est pas un facteur utile de l’évolution. Krapotkine, dans son ouvrage inachevé sur la « Morale », devait faire de l’entraide le fondement d’une morale anarchiste. Nous sommes bien loin de cet individualisme mal défini qu’on reproche habituellement aux anarchistes…
On ne manquera pas de nous dire : « parlez-nous donc de Stirner ? Voilà un penseur anarchiste dont l’individualisme absolu est bien éloigné de Proudhon, de Bakounine, et de Kropotkine ! » Parler de Stirner, c’est tout d’abord écarter de deux caricatures de la pensée de Stirner : d’une part les commentateurs bourgeois et marxistes voient en Stirner un énergumène, égoïste forcené, apologiste du meurtre et de la destruction universelle, d’autre part, depuis le malencontreux ouvrage de Victor Basch : « L’individualisme anarchiste : Max Stirner » (1904) certains ont annexé Stirner à l’anarchisme et en ont fait un précurseur de la grève générale et de l’insurrection. Tout ceci eût fort étonné Stirner : « L’unique et sa propriété » n’est ni un manuel de guerre civile, ni l’œuvre d’un réformateur social. En 1844, Stirner a dressé la protestation orgueilleuse de l’individu, du Moi, de l’Unique en face d’une société qui l’écrase, il a dénoncé les mensonges sur lesquels se fonde la contrainte sociale et exorcisé les fantômes, les idées fixes qui s’emparent du cerveau de l’individu : Dieu, l’Humanité, le Travail, la Vérité, la Justice, l’Altruisme. L’Etat, les Partis, le communisme naissant n’échappent pas à cette critique destructrice, et pas davantage toutes les formes d’autorité et de hiérarchie. Cette exaltation du Moi et de l’Égoïsme semble aux antipodes de l’anarchisme de Proudhon et de Bakounine. Mais il ne faudrait pas croire que le Moi Stirnerien reste seul sur les ruines de la société. Stirner envisage un monde harmonieux qu’on peut considérer comme une limite, un au-delà du communisme anarchiste. Les Uniques, à la recherche d’un équilibre entre la nécessité de vivre en commun et la sauvegarde de leur personnalité, se grouperont en associations librement constituées, essentiellement fluides et dont le maintien est subordonné aux intérêts égoïstes des membres. Stirner accepte même l’organisation du travail et fait de l’amour – amour qui voit dans l’être qu’on aime l’objet de la passion égoïste du Moi – le principe fixe des associations des Uniques.
Stirner n’est pas partisan de la liberté absolue : La liberté en soi est une absurdité. Au dessus de la liberté, dont on ne peut éviter la limitation, il y a la personnalité qui est l’essentiel du Moi. Stirner condamne la société qui restreint la liberté et opprime la personnalité, et lui oppose l’Association, « dont le but n’est pas la liberté, qu’elle lui oppose l’Association dont « le but n’est pas la liberté, qu’elle sacrifie à la personnalité, mais cette personnalité elle-même ». Ainsi même dans la forme extrême que lui a donnée Stirner, l’individualisme anarchiste – si on tient à conserver cette expression ambiguë ! – n’aboutit pas à la glorification de l’individu contre les autres individus, à la loi de la jungle et au refus de toute organisation.
LES ANARCHISTES ET DIEU
L’attitude des anarchistes à l’égard des religions et de Dieu résulte des pages précédentes. L’anarchisme combat l’autorité sans frein, la raison d’Etat, l’intolérance, le pouvoir des classes et des castes fondé sur la hiérarchie ; il croit que l’homme, s’appuyant sur sa sensibilité et sa raison, est capable de transformer le monde où il vit sans faire appel à un fantôme divin et sans se plier à une volonté supra-terrestre. Tout ce que combat l’anarchisme est le fondement des religions et toute les religions jettent l’anathème sur la pensée anarchiste. Judaïsme, catholicisme, islamisme, cultes réformées : toutes ces religions, de persécutées sont devenues persécutrices, ont été ou sont des facteurs d’intolérance et d’oppression, car toutes tendent à l’universalité, à la « catholicité ». Elles ont toutes essayé d’unir, à leur profit, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et lorsqu’elles ont échoué dans cette conquête de la puissance absolue, elles se sont toujours rangées du côté de l’Etat, de l’ordre établi, et la bénédiction de la caste sacerdotale n’a jamais fait défaut à la hache du bourreau. Rien de plus normal que cette évolution des religions : comme on l’a vu dans les régimes communistes, prendre et garder le pouvoir conduit à persécuter et à opprimer les individus. « La vérité, c’est que toute idéologie, politique ou religieuse, si elle possède des moyens de coercition et détient le pouvoir de faire périr ses adversaires, s’efforce de les anéantir : il y va de sa propre existence. L’intolérance est l’attribut constant de toute foi qui se juge en possession de la Certitude et qui a le pouvoir de l’imposer. »(17)
Mais laissons là le Dieu des religions révélées : Yahvé ou Allah qui ont tous les traits d’un tyran jaloux, cruel, sanguinaire, aux desseins arbitraires et impénétrables, ou le Dieu de Calvin qui promet à certaines créatures la félicité éternelle et qui voue les autres « par un jugement occulte et incompréhensible, bien qu’il soit juste et équitable » (Calvin), à la damnation éternelle. Et occupons nous du Dieu des théistes, créateurs et administrateur de l’univers, omniprésent et omniscient, de ce Dieu qui prend des formes si diverses, depuis le Dieu qu’invoque le Vicaire savoyard de Rousseau, jusqu’au Dieu horloger de Voltaire qui règle les rouages de la machine universelle ou au Dieu policier de Frédéric II et de Napoléon nécessaire au peuple et à la canaille. Les anarchistes se proclament athées et l’athéisme est la première qualité requise pour faire partie de la Fraternité internationale révolutionnaire : « il faut que le frère international soit athée et qu’il revendique avec nous pour la terre et pour l’homme tout ce que les religions ont transporté dans le ciel et attribué à leurs dieux : la vérité, la liberté, la justice, la félicité, la bonté » (Bakounine – 1865). Bakounine écrira dans « Dieu et l’Etat » : « l’idée de Dieu implique l’abdication de la raison et de la justice humaines ; elle est la négation la plus décisive de la liberté humaine et aboutit nécessairement à l’esclavage des hommes, tant en théorie qu’en pratique… Si Dieux est, l’homme est esclave ; or l’homme peut, doit être libre; donc Dieu n’existe pas. »
Bakounine sent fort bien que cet argument est insuffisant pour vaincre chez les individus une croyance millénaire. Les « preuves » de l’inexistence de Dieu sont incapables de triompher du Dieu « sensible au cœur et non à la raison. Et Bakounine écrit : « …Tant que la racine de toutes les absurdités qui tourmentent le monde ne sera pas détruite, la croyance en Dieu restera intacte et ne manquera jamais de pousser des rejetons nouveau. » Qu’importe alors l’existence ou la non-existence de Dieu ? Dieu fantôme, idée fixe, vit dans des millions de cerveaux avec son cortège de superstitions malfaisantes. Il nous faut combattre Dieu dans les esprits, l’attaquer et le détruire en nous. « On n’a jamais fini de se débattre contre Dieu », disait Proudhon et cette parole pourrait servir de fondement à l’anarchisme, philosophie de la révolte. On peut donc se poser la question : Proudhon, Bakounine et bien des anarchistes sont-ils athées ou anti-théistes ?
Proudhon a toujours repoussé la qualification d’athée, et parfois, en termes véhéments, comme dans sa lettre à Pierre Leroux (1849). Il semble que Proudhon considère Dieu comme un ennemi personnel, la somme de tous les maux, le garant de l’Etat et de l’ordre : « Dieu, c’est tyrannie et mystère ; Dieu, c’est le mal ! » La marche de l’humanité vers le progrès social, c’est la lutte contre Dieu : lutte toujours nécessaire, toujours renouvelée, éternelle révolte de Prométhée. Et Pierre Ansart résume ainsi cet Anti-théisme de Proudhon : « L’humanité est et doit l’antithèse de Dieu. Le Divin, loin de symboliser la protection d’une providence, exprime tout ce dont une société libre doit se défaire : l’autorité, la fatalité, la tyrannie, l’inégalité des classes et la misère, en un mot le mal ».
Je crois que l’antithèse de Bakounine est encore plus radical que celui de Proudhon. Bakounine constate la présence de Dieu dans les esprits. Si nous avons en nous des restes d’intolérance ou d’autoritarisme, c’est que Dieu est encore caché dans un replis de notre âme. Il faut extirper Dieu : faire la révolution dans les esprits, c’est d’abord en chasser Dieu : et si Dieu existait réellement, avec une existence autre qu’une idée fixe dans les esprits ? Si dieu existait, faudrait-il se plier ou continuer à combattre ? Voici la réponse de Bakounine : « Si Dieu existait, il n’y aurait pour lui qu’un seul moyen de servir la liberté humaine ; ce serait de cesser d’exister… Je retourne la phrase de Voltaire, et je dis que, si Dieu existait, il faudrait l’abolir ».
Cet antithéisme, expression la plus pure de la révolte de l’individu contre « le silence éternel de la Divinité », se retrouve chez tous les combattants passionnés qui se refusent à tout compromis et à toute abdication. Voici ce qu’écrit Milovan Djilas, évoquant son séjour en prison en 1956 (18) : je me réjouissais de trouver en moi la pensée diabolique que si l’existence de Dieu devenait un jour impossible à nier, je me révolterais contre son omniscience et son ordre immuable, exactement comme je me réjouissance me révolter, hérétique que j’étais, contre l’unité organisée, despotique et inhumaine du parti. » Proudhon, Bakounine, Djilas : si différents par leur formation, si semblables dans leur révolte ! L’antithéisme n’est pas propriété d’un parti, il exprime la pensée profonde de tout homme libre.
L’antithéisme va plus loin dans la révolte que l’athéisme traditionnel. Si Dieu n’existe pas en fait, l’antithéisme combat ce Dieu qui ronge les esprits ; si Dieu existe, l’antithéisme le combat comme un tyran et refuse de reconnaître sa souveraineté. C’est une résurrection du mythe antique de Prométhée bravant le destin et les Dieux immortels, de ce Prométhée disant à Zeus dans la célèbre poésie de Goethe : « …Je forme des hommes à mon image, une race qui me ressemble, faite pour souffrir, pour pleurer, pour jouir, pour connaître la joie, et pour le mépriser – comme moi. » C’est la réponse enthousiaste au cri de Baudelaire :
« race de Caïn, au ciel monte et sur la terre jette Dieu ! »
Poésie ! diront ironiquement les docteurs en dialectique. Mais la mission du poète n’est-elle pas de donner aux meilleures pensées des hommes une forme immortelle ?
FAUT-IL « REPENSER » L’ANARCHISME ?
Depuis plusieurs années ou « repense » beaucoup… à défaut de penser. Cet affreux néologisme signifie sans doute rajeunir, moderniser, mettre au goût du jour. J’avais quelque répugnance pour ce terme, mais les ondes et la presse m’ont appris qu’un agrégé des lettres, qui a mal tourné, n’avait pas hésité à l’employer, et avec une maîtrise ! (19). Celui qui repense apparaît résolument tourné vers l’avenir, il ne s’embarrasse pas du passé et peut même l’ignorer : ainsi des gens pleins de bonnes intentions ont voulu repenser le marxisme, le syndicalisme, voire l’anarchisme. Certes, le marxisme aurait besoin d’un bon coup de plumeau ! Mais marxistes et léninistes attachent au moindre lambeau de phrase écrit par les Saints Prophètes une valeur universelle et éternelle. On trouve dans l’œuvre de Marx et de Lénine toujours une justification pour le moindre Zig-zag de la ligne du Parti ou pour le moindre retournement de veste ! Les « repenseurs » du marxisme auraient fort à faire… et pourtant leur ardeur risque de se briser contre le mur de l’orthodoxie.
Contrairement au marxistes-léniniste les anarchistes n’ont montré ni servilité, ni respect exagéré à l’égard de leurs philosophes et de leurs penseurs. Toute une partie de leur proudhonisme était considérée comme périmée du temps de l’Association internationale des travailleurs. Certaines conceptions de Bakounine sont abandonnées : ainsi sa croyance au rôle révolutionnaire des déclassés et des brigands, position justifiée en Russie vers 1860, mais insoutenable maintenant. J’affirme que l’anarchisme, bien plus que le marxisme, a heureusement évolué en tenant compte des circonstances et des époques : il a gardé quelques principes généraux que rien ne vient encore infirmer, tels que le refus des autorités abusives, le refus de l’Etat, l’autogestion, le fédéralisme ; il a renoncé à certaines utopies et à certaines déviations qui connurent quelque succès au début de ce siècle. A quoi bon, dira-t-on, repenser l’anarchisme ?
On ne saurait oublier que l’anarchisme – et ce n’est pas un de ses moindres aspects – s’intéresse à la personne humaine et veut fonder sur la liberté une morale individuelle. Rien de ce qui touche aux problèmes de la conscience et de l’inconscient, à la vie affective, à la sensibilité ne peut lui être étranger. Il est évident que, depuis Stirner et même Kropotkine, il s’est produit dans le monde des idées une évolution considérable et qu’il serait insensé d’ignorer Freud et Reich. L’érotisme et la sexualité jouent dans la vie de l’individu un rôle qu’on ne peut négliger : sous prétexte que ces questions donnent lieu à des manifestations spectaculaires et tapageuse ou à des idéologies confuses, il serait ridicule pur un anarchiste de les passer sous silence.
Je ne puis que donner ici quelques brèves indications en m’excusant de leur insuffisance. Certains camarades pensent que les idéologies révolutionnaires, quelles qu’elles soient, exagèrent l’importance de l’infrastructure économique, nient le corps et ne s’attachent qu’à la socialisation des moyens de production. Or il y a des besoins que l’homme peut satisfaire, sans se soucier des moyens de production, et l’acte sexuels infrastructure, mais de montrer que l’économie n’est qu’un élément parmi d’autres et que la réalité est unitaire. L’homme ne se distingue pas seulement de l’animal par sa faculté de produire des moyens d’existence, mais aussi par la continuité de sa vie sexuelle.
Ces camarades insistent sur le rôle de l’inconscient, nié par des idéologues révolutionnaires (Lénine : « La théorie de Freud est une niaiserie à la mode ! »). Mais ils considèrent que le freudisme est en partie périmé et adoptent le point de vue de W. Reich (« La fonction de l’orgasme » – « La révolution Sexuelle »). A l’opposition freudienne entre l’instinct sexuel (Eros) et l’instinct de mort (Thanatos), ce dernier conduisant aux tendances masochistes et au besoin de punition, Reich substitue, comme conséquence de l’inhibition sexuelle, une pulsation destructrice tendant à détruire une source de danger. On voit comment Reich bouleverse ainsi la psychanalyse traditionnelle qui tendait aux renoncement et au refus conscient de l’instinct et non à la satisfaction de l’instinct naturel.
La division entre prolétariat et bourgeoisie est d’ordre idéologique. « Il n’y a pas de limites de classes pour les structures caractérielles comme il y en a pour les situations économiques et sociales. Ce n’est pas une question de lutte de classes entre le prolétariat la bourgeoisie » (W. Reich). Il faut vivre selon ses envies et ses collectifs ou communes affinitaires. Sur ce point, ces camarades rejoignent les associations d’égoïstes de Stirner et il semble bien que les solutions envisagées pour faire vivre de telles communautés sont celles de l’anarchisme traditionnel.
Ceci nous écarte du problème sexuel proprement dit. Je pense que ce problème est le problème du couple, car l’acte sexuel exige au moins un partenaire momentané, sinon durable. Or dès que deux individus sont en présence, il y a limitation de la liberté et Stirner est bien d’accord sur ce point : la liberté de chacun est en effet limitée par la liberté de l’autre. Les relations sexuelles constituent un fait privé, pour lequel ne doit exister ni interdit, ni tabou. Chacun des deux partenaires est parfaitement libre pourvu qu’il ne restreigne pas la liberté de l’autre. En outre, tout acte comporte des conséquences : le bons sens – je ne dis pas la morale ! – exige qu’on accepte les responsabilités qui résultent de ces conséquences. L’enfant a lui aussi une liberté et une personnalité au moins en puissance. Éluder ces responsabilités au nom de la liberté absolue de l’individu est une forme d’oppression à l’égard de l’enfant : c’est un acte contraire à tous les sentiments profonds des anarchistes. Débarrassé de tout un appareil savant, de beaucoup de philosophie et de pas mal de littérature, le problème sexuel peut ainsi être posé en termes simples et je pense que tout anarchiste le résoudra dans le même sens.
Mais au cours de cette étude, je me suis avant tout attaché à préciser le rôle de l’anarchisme dans la transformation de la société, dans la pratique des luttes ouvrières, dans l’organisation rationnelle et humaine de l’économie. Nous venons d’assister depuis un demi-siècle à une évolution extrêmement rapide des sciences, à plusieurs révolutions de la technique, à un énorme développement de l’industrialisation. Il n’y a plus de commune mesure entre la société industrielle de 1970 et le monde d’avant 1914. D’où ces questions essentielles : le progrès accéléré des sciences et des techniques confirme-t-il ou infirme-t-il les théories anarchiste où chaque individu travaillant selon ses capacités pourra satisfaire tous ses besoins ? Des camarades de Berlin et de Hambourg, dont certains sont des techniciens, ont pensé que ces questions ne pouvaient être éludées. Ils ont fondé un cercle d’études et édité une revue « Anarchie » dont le premier numéro a paru fin 1969. « Faire prendre conscience de la révolution scientifique et technique, de l’homme nouveau, du problème social de l’avenir », tel est le dessein de ces camarades qui représentent l’anarchisme pragmatique. Je ne puis ici que donner les grandes lignes de leurs premières études, d’après un article du camarade Uwe Timm paru en juillet 1969 dans la revue anarchiste allemande « Befreiung ».
I. Non seulement le progrès scientifique et technique s’accélèrent, mais les découvertes de la science mettent moins de dix ans pour pénétrer dans l’économie et transformer la production. En même temps le fossé s’élargit entre le progrès scientifique et le progrès social. La structure de la société actuelle fait de ce progrès un facteur d’anéantissement de l’humanité.
II. Les savants considèrent la science comme neutre, ils n’en décident pas les applications. Ce ne sont point les forces de la science et de la technique qui déterminent notre destin : seul l’ordre existant peut faire de la technique une bénédiction ou malédiction. Une société fondée sur la liberté utilisera le progrès technique dans un sens bénéfique, tandis qu’une société – capitaliste ou communiste – fondée sur l’autorité et l’oppression servira de ce même progrès pour des fins de destruction. « Ce n’est pas l’équilibre dans la terreur, lequel peut tôt ou tard basculer, mais seulement une nouvelle morale qui fondera une vie stable. » (Karl Steinbuch – Die informierte Gesellschaft » – 1968.)
III. La machine ne pense pas, ne décide pas, mais son travail peut remplacer de plus en plus celui de l’homme, et l’usine sans ouvriers n’est plus une utopie. Actuellement on est loin d’épuiser les possibilités de l’automation. La réduction du temps de travail est obtenue surtout par la rationalisation. D’après une étude américaine (Hermann Kahn et Anthony Wiener), en l’an 2000, 2 % des travailleurs actuellement employés dans une industrie déterminée suffiraient à en assurer le fonctionnement, tandis que s’accroîtrait le nombre des travailleurs dans les divers services, les professions libérales, l’enseignement, les professions d’ingénieur et de technicien.
On pense communément que le salarié est rétribué selon ses capacités : en réalité, elles sont toujours estimées au-dessous ou au-dessus de leur valeur et parfois, en raison de la loi de l’offre et de la demande, les capacités ne jouent qu’un rôle illusoire. De plus en plus, la main-d’œuvre individuelle perdra de sa valeur – un homme ne peut rivaliser avec un ordinateur ! – on élèvera le niveau d’instruction et on accroîtra considérablement le nombre des techniciens : la concurrence entraînera pour les salaires une limite supérieure à ne pas dépasser. Certes, il n’y a plus de misère au sens ancien du mot, le pauvre participe au progrès de la technique, mais si l’on étudie la répartition du revenu national, on s’aperçoit qu’il y a toujours le même écart entre le riche et le pauvre. D’ailleurs, la possession d’une auto ou d’une petite maison compense-t-elle la nécessité de toujours apprendre, d’être de plus en plus zélé et efficace, la peur d’une crise possible, la crainte de vieillir et de ne plus trouver d’emploi ? La question essentielle est celle que pose Steinbuck : « Quelles sont les formes de société et d’économie propres à assurer une vie respectant la dignité humaine, en tenant compte du développement futur de la technique ? »
IV. Les anarchistes pensent que les conquêtes de la science ne doivent apporter à l’homme aucun préjudice physique ou moral et que nul ne doit les utiliser dans ce dessein : on retrouve là les deux règles de la robotique formulées par le biologiste et écrivain de science-fiction Isaac Asimov. « Le développement de la technique donne à l’homme la possibilité de se libérer du travail d’esclave » (Kropotkine). Au droit au travail il faut substituer le droit au bien-être et les hommes devraient comprendre « ce que tant d’entre eux ne savent plus aujourd’hui, que les seules choses qui comptent dans ce monde sont des impondérables : la beauté et la sagesse, le rire et l’amour. » (Arthur C. Clarke : « Regard sur l’avenir de la technique » – 1963.)
Pour la bourgeoisie, l’homme est un être voué au travail et peu importe si ce travail est utile ou non, s’il est au service des œuvres de destruction, si le travailleur est un idiot spécialisé ou un soldat !
Pour les dirigeants des syndicats et les social-démocrates, une seule chose compte, c’est le plein emploi. Ils luttent pour que chacun puisse exercer son droit au travail, que ce soit dans le cycle d’une production destinée à accroître le bien-être général, ou dans les industries de guerre, l’armée et la bureaucratie.
Entre le système des salaires dont dépend le revenu individuel et les capacités de chacun, il n’a plus de rapport rationnel ni même réel. Nous devons donc rejeter cette liaison revenu-travail. Le problème n’est plus d’augmenter le revenu individuel par une diminution – illusoire ! – des bénéfices des entreprises, mais de faire cesser la vente au plus offrant de la force de travail et de mettre fin au régime du salariat. Les solutions anarchistes : propriété sociale, coopération, autogestion, structures fédéraliste, ont conservé toute leur valeur au siècle de l’automation.
Le nouveau prolétariat qui groupera bientôt plus d’employés et de techniciens que d’ouvrier pose un problème capital : le capitalisme tend à augmenter le plus rapidement possible le nombre des spécialistes en les soumettant à une formation accélérée qui ne tient plus compte des connaissances prétendues inutiles, de l’intelligence, de la critique, mais qui tend à former des robots spécialisés aptes à remplir une tâche précise et parfaitement ignorants en dehors de leur spécialité. Cette déshumanisation de l’individu pratiquée par les régimes autoritaires ou démocratiques, par les États-Unis ou par l’U.R.S.S., conduit à la destruction de la personne humaine.
D’où trois conséquences de cette analyse :
1) A l’ère de la technique, une école fondée sur la liberté doit remplacer l’enseignement autoritaire et orienté par le capitalisme ;
2) l’accroissement de la production résultant de l’automation et de la cybernétique doit assurer à la société plus de liberté et de sécurité, à condition d’organiser l’économie pour assurer l’existence matérielle des hommes ;
3) ces deux points ne peuvent se réaliser qui si l’on détruit le militarisme mondial qui est l’instrument de toutes les idéologies autoritaires. Cette étude conduit à deux sortes de réflexions. D’abord l’homme court un péril mortel. Les États capitalistes et communiste se sont parfaitement adaptés à l’industrialisation accéléré et par la manipulation des esprits, par la propagande effrénée, par un enseignement de plus en plus utilitaire, ils tendent à former des robots spécialisés incapables de rattacher leur activités à l’économie générale, incapables de comprendre le monde, de le juger et de le transformer. D’autres part, le développement des techniques et de l’automation rend possible une société où les besoins de chacun seraient satisfaits : cette société libre, anti-autoritaire, où l’homme pourrait laisser s’épanouir sa personnalité, ne présente plus le caractère utopique qu’elle avait peut-être il y a un siècle. Plus que jamais l’avenir dépend des hommes et le choix s’impose non pas demain, mais aujourd’hui ! On m’objectera que les gens semblent s’accommoder de la société actuelle et que l’automobile, le week-end et le tiercé ne développent ni la raison ni l’intelligence. Mais je sais aussi que les sociétés sont périssables et qu’on a vu dans le passé disparaître des institutions qu’on croyait éternelles. Sans doute, il faut des générations pour juger et condamner une société, mais une génération suffit pour la détruire et en fonder une nouvelle.
L’anarchisme n’est pas seulement la négation et le refus du monde dans lequel nous vivons ; il est aussi un acte de foi dans l’homme qui peut et doit se libérer de la servitude économique, et aussi de toutes ces autorités hiérarchisées qui étouffent en lui la personnalité et le rendent esclave des machines dont il devrait être le maître. Face à tous les conformistes, à toutes les dictatures, à toutes les fausses cultures, la pensée anarchiste défend la cause de l’homme, qui au cours des siècles, à toujours fini par triompher.
—————————————————————
(1) Voir Labriola – Essais sur la conception matérialiste de l’Histoire, Paris – 1897. Traduit de l’italien.
(2) Que faire ? Édition du Seuil – 1966. Les citations de Lénine et de Rosa Luxembourg sont empruntées à cette édition.
(3) K. Papaioannou a publié dans les N° 4 et 5 (année 1963) de la revue Le contrat Social un article intitulé << Classe et Parti >> qui étudie der façon remarquable l’évolution des idées de Lénine. Cette citation est empruntée à cet article.
(4) Cité par Maurice Dommanget : Auguste Blanqui, des origines à la révolution de 1848 (Paris – 1969).
(5) Cité par Dommanget : Auguste Blanqui, des origines à la révolution de 1848.
(6) Diégo A. de Santillan traduisit en 1931 l’appel au Socialisme de Landauer. Cette traduction en espagnol fut rééditée en 1947. La citation donnée est extraite de la préface de Santillan. Signalons que des maisons d’édition allemandes viennent de rééditer l’Appel au socialisme et de publier un choix d’écrits de Landauer.
(8)Cette étude de Malestra parut, traduite en allemand, dans le cahier n°4 (1906) de la revue Die frele Génération. Elle vient d’être reproduite dans la revue mensuelle anarchiste Befreing publiée à Mülheim – Ruhr.
(9) Tel est le titre du livre de Milovan Djilas (Paris – 1957). Djilas né au Monténégro en 1911, milita très jeune dans les rangs du Parti communiste Yougoslave. Torturé et condamné à trois ans de prison avant 1939. Devint membre du comité Central, adjoint de Tito dans la résistance, ministre de la République fédérale Yougoslave. Ses écrits lui valurent d’être exclu du Comité Central. La parution à l’étranger d’une nouvelle classe dirigeante fut payée par neuf ans de prison. Dans son premier ouvrage, Djilas dénonce le mode de gouvernement issu du marxisme. Dans un second livre, une société imparfaite (Paris – 1969), il fait la critique du marxisme.
(10). Voir Autopsie du Stalinisme, de A. Rossi (Spartacus n°) 26 B). Cet ouvrage contient le texte intégral du rapport Khrouchtchev.
(11) Voir l’ouvrage de Klaus Mehnert : Peking und die neue Lintre (Pékin et la nouvelle gauche) paru en 1969 à Stuttgart (DVA). K. MEHNERT avait déjà publié deux ouvrages sur les questions chinoises : Pékin et Moscou (1962) et la seconde révolution de Mao (1966). Dans son troisième ouvrage, il étudie la naissance du gauchisme chinois et publie de nombreux documents sur cette question.
(12) K. Marx – Le capital, tome 1 (page 60 de la traduction de Roy, utilisée dans l’édition du bureau d’Editions – Paris – 1939). Voir aussi la traduction Molitor (tome 1, page 16) et l’ouvrage de Pierre Bigo : Marxisme et humanisme (Paris – 1954).
(14) voir l’ouvrage de Jean Maitron : Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914) (3e partie – chapitre 1).
(14) Voir l’ouvrage de Jean Maitron : Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914) (3e partie – chapitre I).
(15) Article de J. Salamero, date du 16-10-1969 et paru dans l’anarcho-syndicaliste.
(16) Voir l’article paru sous le titre Révolution dans « l’anarcho-syndicaliste » de mars 1970.
(17) A; Bailly- La réforme en France jusqu’à l’édit de Nantes (Paris – 1960)
(18) Milovan Djilas – Une société imparfaite (Paris – 1969)
(19) Il s’agit évidemment de M. Pompidou, et voici : … Le fond du problème est, pour l’enseignement supérieur, de repenser toute sa substance et sa finalité » (discours prononcé à Albi – 5 Avril 1970).
/image%2F1177296%2F20160924%2Fob_3cef60_5611e5e319cae687d9feba2c414cfe02-l.jpg)


/image%2F1177296%2F20240315%2Fob_84971a_capitalisme.jpg)
/image%2F1177296%2F20230919%2Fob_c6c78f_fighters-for-freedom-0000.jpg)
/image%2F1177296%2F20231020%2Fob_e94f97_leon-tolstoi.jpg)
/image%2F1177296%2F20240130%2Fob_edecb9_no-pasaran.jpg)
/image%2F1177296%2F20160920%2Fob_970032_ob-8dc177-190px-rb-star-svg.png)
