★ La Domestication Industrielle

Si le capital prend la science à son service, l’ouvrier récalcitrant sera contraint d’être docile.
Autrefois, si quelqu’un traitait d’ouvrier un homme de métier, il risquait la bagarre. Aujourd’hui qu’on leur dit que l’ouvrier est ce qui se fait de mieux dans l’Etat ils insistent tous pour être ouvriers.
« Le terme de révolution industrielle couramment utilisé pour qualifier la période qui va de 1750 à 1850 est un pur mensonge bourgeois, symétrique de celui sur la révolution politique. Il ne contient pas le négatif, et procède d’une vision de l’histoire comme seule histoire des progrès technologiques. C’est un coup double pour l’ennemi, qui légitime ainsi l’existence des managers et de la hiérarchie comme conséquence inéluctable de nécessités techniques, et impose une conception mécaniste du progrès, considéré comme une loi positive et socialement neutre. C’est le moment religieux du matérialisme, l’idéalisme de la matière. Un tel mensonge était évidemment destiné aux pauvres, parmi lesquels il devait faire des ravages durables. Il suffit pour le réfuter de s’en tenir aux faits.
La plupart des innovations techniques qui ont permis aux usines de se développer avaient été découvertes depuis un certain temps déjà, mais étaient restées inemployées. Leur application à grande échelle n’en est pas une conséquence mécanique, mais procède d’un choix, historiquement daté, des classes dominantes. Et celui-ci ne répond pas tant à un souci d’efficacité purement technique (efficacité souvent douteuse) qu’à une stratégie de domestication sociale. La pseudo-révolution industrielle se résume ainsi à une entreprise de contre-révolution sociale. Il n’y a qu’un seul progrès : le progrès de l’aliénation.
Dans le système qui existait antérieurement, les pauvres jouissaient encore d’une grande indépendance dans le travail auquel ils étaient contraints. La forme dominante en était l’atelier domestique : les capitalistes louaient les outils aux ouvriers, leur fournissaient les matières premières, et leur rachetaient à vil prix les produits finis. L’exploitation n’était pour eux qu’un moment du commerce, sur lequel ils n’exerçaient pas de contrôle direct. Les pauvres pouvaient encore considérer leur travail comme un « art » sur lequel ils avaient une marge notable de décision. Mais surtout ils restaient maîtres de l’emploi de leur temps : travaillant à domicile et pouvant s’arrêter quand bon leur semblait, leur temps de travail échappait à tout calcul. Et la variété, autant que l’irrégularité, caractérisait leur travail, l’atelier domestique n’étant le plus souvent qu’un complément aux activités agricoles. S’ensuivaient des fluctuations de l’activité industrielle incompatibles avec l’essor harmonieux du commerce. Ainsi les pauvres disposaient-ils encore d’une force considérable qu’ils exerçaient en permanence. La pratique de la perruque, le détournement de matières premières, était monnaie courante et venait alimenter un vaste marché parallèle. Surtout, les travailleurs domestiques pouvaient faire pression sur leurs employeurs : les fréquentes destructions de métiers étaient le moyen d’un « marchandage collectif par l’émeute » (Hobsbawn). Du fric ou on casse tout !
C’est pour supprimer cette indépendance menaçante des pauvres que la bourgeoisie se voit contrainte de contrôler directement la sphère de l’exploitation. Voilà la raison qui préside à la généralisation des usines. Il s’agit d’autonomiser la sphère du travail, temporellement et géographiquement. « Ce ne sont pas tant ceux qui sont absolument oisifs qui font du tord au public, mais ceux qui ne travaillent que la moitié de leur temps », écrivait déjà Ashton en 1725.
L’art militaire est appliqué à l’industrie, et les usines sont littéralement construites sur le modèle des prisons, qui leur sont d’ailleurs contemporaines. Un vaste mur d’enceinte vient les séparer de tout ce qui est extérieur au travail, et des vigiles sont chargés de refouler ceux qui au début trouvaient naturel de rendre visite à leurs infortunés amis. A l’intérieur, des règlements draconiens avaient pour premier objet de civiliser les esclaves. En 1770, un écrivain avait projeté un nouveau plan pour produire des pauvres : la Maison de la Terreur, dont les habitants seraient maintenus au travail quatorze heures par jour, et tenus en main par la diète. Son idée ne précéda que de peu la réalité : une génération plus tard, la Maison de la Terreur s’appelait tout bêtement une usine.
C’est en Angleterre que se généralisèrent d’abord les usines. Dans ce pays, les classes dominantes avaient depuis longtemps surmonté leurs conflits internes, et pouvaient donc s’adonner sans retenus à la passion du commerce. Et la répression qui avait suivi l’échec de l’assaut millénariste des pauvres [1] avait préparé le terrain de la contre-offensive industrielle. Les pauvres en Angleterre eurent donc le triste sort de subir les premiers toute la brutalité d’un mécanisme social en formation. Il va sans dire qu’ils considéraient un tel sort comme une dégradation absolue, et ceux qui l’acceptaient subissaient le mépris de leurs semblables. Déjà au temps des Niveleurs, il était courant de penser que ceux qui vendaient leur force de travail contre un salaire abandonnaient de fait les droits des « Anglais nés libres ». Avant même de commencer, les premiers propriétaires d’usines avaient déjà eu du mal à recruter de la main-d’œuvre, devant souvent parcourir de longues distances pour cela. Il leur fallait ensuite fixer les pauvres à leur nouveau travail, et les désertions étaient massives. Voilà pourquoi ils prirent en charge l’habitat de leurs esclaves, en tant qu’anti-chambre de l’usine. La constitution de cette vaste armée de réserve industrielle entraîna une militarisation de l’ensemble de la vie sociale.
Le luddisme fut la réponse des pauvres à l’instauration de ce nouvel ordre. Dans les premières décennies du XIXème siècle, le mouvement de destruction des machines se développa dans un climat de fureur insurrectionnelle. Il ne s’agissait pas seulement d’une nostalgie d’un âge d’or de l’artisanat. Certes, l’avènement du règne du quantitatif, de la camelote en série, entrait pour une bonne part dans la colère des gens. Désormais, le temps nécessaire pour accomplir un travail primait sur la qualité du résultat, et cette dévalorisation du contenu de tout travail particulier conduisit les pauvres à s’en prendre au travail en général qui manifestait ainsi son essence. Mais le luddisme fut avant tout une guerre d’indépendance anticapitaliste, une « tentative de destruction de la nouvelle société » (Mathias). « Tous les nobles et tous les tyrans doivent être abattus », disait un de leurs tracts. Le luddisme est l’héritier du mouvement millénariste des siècles précédents : bien que ne s’exprimant plus par une théorie universelle et unificatrice, il demeure radicalement étranger à tout esprit politique et à toute pseudo-rationalité économique. A la même époque en France, les soulèvements des canuts, qui étaient aussi dirigés contre le processus de domestication industrielle, étaient en revanche déjà contaminés par le mensonge politique. « Leur intelligence politique les illusionnait sur la source de la misère sociale et faussait chez eux la conscience de leur véritable but », écrit le Marx de 1844. Leur slogan était « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». En Angleterre, alors que le trade-unionisme naissant était faiblement réprimé, voire toléré, la destruction des machines était punie de mort. La négativité absolue des luddites les rendait intolérables socialement. L’État répondit de deux manières à cette menace : il constitua une police professionnelle moderne, et reconnut officiellement les trade-unions. Le luddisme fut d’abord défait par la répression brutale, puis s’éteignit à mesure que les trade-unions parvinrent à imposer la logique industrielle. En 1920, un observateur anglais note avec soulagement que « le marchandage sur les conditions du changement l’a emporté sur la seule opposition au changement ».
Joli progrès !
Parmi toutes les calomnies qui ont été déversées sur les luddites, la pire est venue des apologues du mouvement ouvrier, qui y ont vu une manifestation aveugle et infantile. Ainsi ce passage du Capital, contresens fondamental d’une époque :
« Il fallut du temps et de l’expérience avant que les travailleurs apprennent à faire la distinction entre les machines elles-mêmes et la manière dont elles sont utilisées par le capital ; et qu’ils dirigent leurs attaques non contre les instruments matériels de production, mais contre la forme sociale particulière dans laquelle ils sont utilisés. »
Cette conception matérialiste de la neutralité des machines suffit à légitimer l’organisation du travail, la discipline de fer (sur ce point Lénine fut un marxiste conséquent), et finalement tout le reste. Prétendument arriérés, les luddites avaient du moins compris que les « instruments matériels de production » sont avant tout des instruments de domestication dont la forme n’est pas neutre, puisqu’elle garantit la hiérarchie et la dépendance.
La résistance des premiers ouvriers d’usine se manifestait principalement à propos de ce qui avait été une de leurs rares propriétés, et dont ils se voyaient dépossédés : leur temps. Un vieil usage religieux voulait que les gens ne travaillent ni le dimanche ni le lundi, appelé « Lundi Saint ». Le mardi étant consacré à se remettre de deux jours de beuveries, le travail ne pouvait raisonnablement commencer que le mercredi ! Générale au début du XIXème siècle, cette saine pratique subsista dans certains métiers jusqu’en 1914. Les patrons usèrent de divers moyens coercitifs pour combattre cet abstentionnisme institutionnalisé, sans résultats. Ce fut à mesure que les trade-unions s’implantèrent que le samedi après-midi férié vint se substituer au « Lundi Saint », une glorieuse conquête : la semaine de labeur augmentait ainsi de deux jours !
Ce n’était pas seulement la question du temps de travail qui était en jeu dans le Lundi Saint, mais aussi celle de l’usage de l’argent. Les ouvriers ne revenaient pas travailler avant d’avoir dépensé tout leur salaire. Dés cette époque, l’esclave n’était plus seulement considéré comme travailleur, mais aussi comme consommateur. Adam Smith avait théorisé la nécessité de développer le marché intérieur en l’ouvrant aux pauvres. De plus, comme l’écrivait l’évêque Berkeley en 1755 : « La création de besoins ne serait-elle pas le meilleur moyen de rendre le peuple industrieux ? » De manière encore marginale, le salaire alloué aux pauvres vint donc s’adapter aux nécessités du marché. Mais ceux-ci n’utilisèrent pas ce surcroît de numéraire selon les prévisions des économistes ; l’augmentation du salaire, c’était du temps gagné sur le travail (ce qui est un heureux retournement de la maxime utilitariste de Benjamin Franklin : « time is money »). Le temps gagné sur l’usine se passait dans les public houses, les biens nommées (à cette époque, les révoltes se communiquaient de pub en pub). Plus les pauvres avaient d’argent, plus ils le buvaient. C’est dans les spiritueux qu’ils ont d’abord découvert l’esprit de la marchandise, au grand dam des économistes qui prétendaient leur faire dépenser utile. La campagne pour la tempérance menée alors conjointement par la bourgeoisie et les « fractions avancées (et donc sobres) de la classe ouvrière », ne répondait pas tant à un souci de santé publique (le travail fait encore plus de dégâts, sans qu’ils en demandent l’abolition), qu’à une exhortation à bien utiliser son salaire. Cent ans après, les mêmes ne conçoivent pas que des pauvres puissent se priver de bouffer pour s’acheter une marchandise « superflue ».
La propagande pour l’épargne vint combattre cette propension à la dépense immédiate. Et là encore, il revint à « l’avant-garde de la classe ouvrière » d’instaurer des établissements d’épargne pour pauvres. L’épargne accroît encore l’état de dépendance des pauvres, et le pouvoir de leurs ennemis : grâce à elle, les capitalistes pouvaient surmonter les crises passagères en baissant leurs salaires, et contenir les ouvriers dans la pensée du minimum vital. Mais Marx relève dans les Grundrisse une contradiction alors insoluble : chaque capitaliste exige que ses esclaves épargnent, mais seulement les siens, en tant que travailleurs ; tous les autres esclaves sont pour lui des consommateurs, et doivent donc dépenser. Cette contradiction ne pourra être levée que beaucoup plus tard, lorsque le développement de la marchandise permettra l’instauration du crédit à l’usage des pauvres. Quoi qu’il en soit, la bourgeoisie, si elle a pu un temps civiliser la conduite des pauvres dans leur travail, n’a jamais pu domestiquer totalement leur dépense. L’argent est ce par quoi la sauvagerie revient toujours…
Après que la suppression du Lundi Saint eût allongé la semaine de labeur, « les ouvriers prenaient désormais leur temps de loisir sur le lieu de travail » (Geoff Brown). Le coulage des cadences était de règle. Ce fut finalement l’instauration du travail à la pièce qui imposa la discipline dans les ateliers : l’assiduité et le rendement augmentèrent ainsi par la force. L’effet majeur de ce système, qui se généralisa à partir des années 1850, fut de contraindre les ouvriers à intérioriser la logique industrielle : pour gagner plus ; il fallait travailler plus, mais ceci se faisait au détriment du salaire des autres, et les moins ardents pouvaient même se trouver licenciés. Pour remédier à cette concurrence sans frein s’imposa la négociation collective sur la quantité de travail à fournir, sa répartition et sa rémunération. Ainsi se trouvèrent consacrées les médiations trade-unionistes. Une fois remportée cette victoire sur la productivité, les capitalistes consentirent à diminuer les horaires de travail. La fameuse loi des dix heures, si elle constitue effectivement une victoire du trade-unionisme, est donc une défaite des pauvres, la consécration de l’échec de leur longue résistance au nouvel ordre industriel.
La dictature omniprésente de la nécessité fut ainsi instaurée. Une fois supprimés les vestiges de l’organisation sociale antérieure, plus rien n’existait dans ce monde, qui ne soit déterminé par les impératifs du travail. L’horizon des pauvres se limitait à la « lutte pour l’existence ». On ne saurait cependant comprendre le règne absolu de la nécessité comme un simple accroissement quantitatif de la pénurie : c’est avant tout la colonisation des esprits par le principe trivial et grossier de l’utilité, une défaite dans la pensée. On mesure là la conséquence de l’écrasement de cet esprit millénariste qui animait les pauvres dans la première phase de l’industrialisation. A cette époque, le règne du besoin brutal était clairement conçu comme l’œuvre d’un monde, ce monde de l’Antéchrist fondé sur la propriété et l’argent. L’idée de la suppression du besoin ne se séparait pas de l’idée de la réalisation de l’Éden de l’humanité, « ce Canaan spirituel où coulent le vin, la lait et le miel, et où l’argent n’existe pas » (Coppe). Avec l’échec de cette tentative de renversement, le besoin accède à une apparence d’immédiateté. La pénurie apparaît dès lors comme une calamité naturelle à laquelle seule l’organisation toujours plus poussée du travail pourra remédier. Avec le triomphe de l’idéologie anglaise, les pauvres, déjà dépossédés de tout se voient en plus dépossédés de l’idée même de la richesse.
C’est dans le protestantisme, et plus précisément dans sa forme anglo-saxonne puritaine, que le culte de l’utilité et du progrès trouve sa source et sa légitimité. Faisant de la religion une affaire privée, l’éthique protestante entérina l’atomisation sociale générée par l’industrialisation : l’individu se retrouvait isolé face à Dieu comme il se retrouvait isolé face à la marchandise et à l’argent. Ensuite, elle mit en avant les valeurs qui étaient précisément requises des pauvres modernes : honnêteté, frugalité, abstinence, travail, épargne. Les puritains, qui avaient combattu sans relâche les fêtes, les jeux, la débauche, tout ce qui venait s’opposer à la logique du travail, et voyaient dans l’esprit millénariste « l’étouffement de tout esprit d’entreprise chez l’homme » (Webbe en 1644) taillèrent la route à la contre-offensive industrielle. De plus, on peut dire de la Réforme qu’elle fut le prototype du réformisme : née d’une dissidence, elle favorisa à son tour toutes les dissidences. Elle « n’exige pas que l’on professe ce christianisme, mais qu’on ait de la religion, une religion quelconque ».
C’est en France et en 1789 que ces principes allaient trouver leur pleine réalisation, en se dépouillant définitivement de leur forme religieuse et en s’universalisant dans le Droit et la politique. La France était retardataire dans le processus d’industrialisation : un conflit irréconciliable opposait la bourgeoisie et la noblesse rétive à toute mobilisation de l’argent. C’est paradoxalement ce retard qui conduisit la bourgeoisie à avancer le principe le plus moderne. En Grande-Bretagne, où les classes dominantes avaient fusionné depuis longtemps en un cours historique commun, « la Déclaration des droits de l’homme pris corps, non pas habillée de la toge romaine, mais sous le manteau des prophètes de l’Ancien Testament » (Hobsbawn). Voilà précisément la limite, l’inachèvement de la contre-révolution théorique anglaise : finalement, la citoyenneté y repose encore sur la doctrine de l’élection, les élus se reconnaissant au fruit de leur travail et à leur adhésion morale à ce monde. Elle laissait donc en dehors d’elle-même une populace qui pouvait encore rêver au pays de cocagne. La mise au travail forcé dans les usines eut d’abord pour but de réduire cette force menaçante, de l’intégrer par la force d’un mécanisme social. Il manquait encore à la bourgeoisie anglaise ce raffinement dans le mensonge qui devait caractériser son homologue d’outre-Manche, lui permettant de réduire les pauvres d’abord par l’idéologie. Aujourd’hui encore les défenseurs britanniques du vieux monde ne font pas tant état de leurs opinions politiques que de leur rectitude morale. La frontière sociale, particulièrement visible et arrogante, qui sépare les riches des pauvres dans ce pays, est à la mesure de la faible pénétration de l’idée d’égalité politique et juridique des individus.
Alors que l’endoctrinement moral puritain avait eut d’abord pour effet d’unifier et de conforter tous ceux qui avaient quelque intérêt particulier à défendre dans un monde changeant et incertain, il vint faire ses ravages sur les classes inférieures après que celles-ci se soient déjà trouvées pliées sous le joug du travail et de l’argent, pour parachever leur défaite. Ainsi Ure recommandait-il à ses pairs d’entretenir avec autant de soin la « machinerie morale » que la « machinerie mécanique », dans le but de « rendre l’obéissance acceptable ». Mais cette machinerie morale allait surtout révéler ses effets néfastes une fois relayée par les pauvres, en marquant de son empreinte le mouvement ouvrier naissant. Ainsi se multiplièrent les sectes ouvrières méthodistes, wesleyennes, baptistes et autres, jusqu’à rassembler autant de fidèles que l’Église d’Angleterre, institution d’État. Dans cet environnement hostile des nouveaux sites industriels, les ouvriers se replièrent frileusement autour de la chapelle. On est toujours porté à justifier les affronts desquels on ne se venge pas : la nouvelle morale ouvrière érigea la pauvreté en grâce et l’austérité en vertu. Dans ces localités, le syndicat fut le rejeton direct de la chapelle, et les prédicateurs laïcs se transformèrent en délégués du trade-union [2]
La campagne menée par la bourgeoisie pour civiliser les pauvres ne devait avoir raison de la haine sociale que par ricochet, une fois relayée par les représentants ouvriers qui, dans leurs luttes contre les maîtres parlaient désormais le même langage qu’eux. Mais les formes encore religieuses que pouvait prendre la domestication dans la pensée n’étaient qu’un épiphénomène. Celle-ci avait une base autrement plus efficiente dans le mensonge économique.
J. et P. Zerzan [3] relèvent fort justement cette contradiction : c’est dans le deuxième tiers du XIXème siècle, au moment où les pauvres subissent les conditions les plus dégradantes et mutilantes dans tous les aspects de leur vie, au moment où toute résistance à l’instauration du nouvel ordre capitaliste est défaite, c’est à ce moment donc que Marx, Engels et tous leurs épigones saluent avec satisfaction la naissance de « l’armée révolutionnaire du travail » et estiment que les conditions objectives sont enfin réunies pour un assaut prolétarien victorieux. En 1864, dans sa célèbre adresse à l’Internationale, Marx commence par dresser un tableau détaillé de la situation épouvantable des pauvres anglais, pour ensuite célébrer « ces merveilleux succès » que sont la loi des dix heures (on a vu ce qu’il en était) et l’établissement de manufactures coopératives marquant « une victoire de l’économie politique du travail sur l’économie politique de la propriété » ! Si les commentateurs marxistes ont abondamment décrit le sort effroyable des ouvriers au XIXéme siècle, ils le jugent quelque part inévitable et bénéfique. Inévitable parce qu’ils y voient une conséquence fatale des exigences de la Science et nécessaire développement des « rapports de production ». Bénéfique, dans la mesure où « le prolétariat se trouve unifié, discipliné et organisé par le mécanisme de production » (Marx). Le mouvement ouvrier se constitue sur une base purement défensive. Les premières associations ouvrières étaient des « sociétés de résistance et de secours mutuel ». Mais alors qu’auparavant les pauvres en révolte s’étaient toujours reconnus négativement, en nommant la classe de leurs ennemis, c’est dans et par le travail, placé par la contrainte au centre de leur existence, que les ouvriers en vinrent à rechercher une communauté positive, produite non par eux mais par un mécanisme extérieur. Cette idéologie devait prendre corps en premier lieu dans la « minorité aristocratique » des ouvriers qualifiés, « ce secteur auquel s’intéressent les politiciens et d’où viennent ceux que la société n’est que trop empressée à saluer comme les représentants de la classe ouvrière », comme le note avec pertinence Edith Simcox en 1880. L’immense masse des travailleurs encore intermittents et non qualifiés n’a de ce fait pas droit de cité. Ce sont eux qui, lorsque les portes des trade-unions s’ouvriront, préserveront le légendaire esprit combatif et sauvage des travailleurs anglais. Un long cycle de luttes sociales commence alors, parfois très violentes, mais qui resteront dépourvues de tout principe unificateur.
« Quoique l’initiative révolutionnaire partira probablement de la France, l’Angleterre peut seule servir de levier pour une révolution sérieusement économique. (…) Les Anglais ont toute la matière nécessaire à la révolution sociale. Ce qui leur manque, c’est l’esprit généralisateur et la passion révolutionnaire. » Cette déclaration du conseil général de l’Internationale porte en elle à la fois la vérité et la fausse conscience d’une époque. Du point de vue social, l’Angleterre a toujours constitué une énigme : le pays qui a donné naissance aux conditions modernes d’exploitation et a donc le premier produit une grande masse de pauvres modernes est aussi celui dont les institutions sont restées inchangées depuis maintenant trois siècles, n’ayant jamais été ébranlées par un assaut révolutionnaire. Voilà qui contraste avec les nations du continent européen, et vient contredire la conception marxiste de la révolution. Les commentateurs ont tenté d’expliquer une telle énigme par quelque atavisme britannique, d’où les salades maintes fois répétées sur l’esprit réformiste et antithéorique des pauvres anglais, en regard de la conscience radicale animant les pauvres de France, toujours prêts à monter sur les barricades. Une telle vision a-historique oublie tout d’abord le foisonnement théorique des années de guerre civile, au XVIIème siècle, ensuite la chronicité et la violence qui ont toujours caractérisé les luttes sociales des pauvres anglais, et qui se sont sans cesse amplifiées depuis le milieu de ce siècle. En réalité, l’énigme se résout ainsi : la révolte des pauvres est toujours tributaire de ce à quoi elle s’affronte.
En Angleterre, c’est sans phrases, par la force brutale d’un mécanisme social, que les classes dominantes ont mené leur entreprise de domestication. Aussi les historiens anglais déplorent-ils souvent que la « révolution industrielle » n’ait pas été accompagné d’une « révolution culturelle » qui aurait intégré les pauvres à « l’esprit industriel » (de telles considérations se sont multipliées dans les années 70, quand l’extension des grèves sauvages en a révélé l’acuité). En France, la contre-offensive bourgeoise a d’abord été théorique, par la domination de la politique et du Droit, « ce miracle qui depuis 1789 tient le peuple abusé » (Louis Blanc). Ces principes représentaient un projet universel, c’était une promesse de participation faite aux pauvres dés lors qu’ils en feraient leurs les modalités. Vers 1830, une partie des pauvres s’en fit le porte-parole, revendiquant que « soient rendus à leur dignité de citoyens des hommes que l’on infériorise » (Proudhon). A partir de 1848, les mêmes principes furent invoqués contre la bourgeoisie, au nom de la « république du travail ». Et on sait à quel point le poids mort de 1789 pèsera lourd dans l’écrasement de la Commune. C’est un projet social qui se scinde en deux au XIX ème siècle. En Angleterre, métropole du Capital, les luttes sociales ne peuvent se fondre dans un assaut unitaire, restant de ce fait travesties en luttes « économiques ». En France, berceau du réformisme, cet assaut unitaire reste contenu dans une forme politique, laissant ainsi le dernier mot à l’État. Le secret de l’absence de mouvement révolutionnaire outre-Manche est donc identiquement le secret de la défaite des mouvements révolutionnaires continentaux.
Aujourd’hui s’achève le processus dont nous venons de décrire la genèse : le mouvement ouvrier classique s’est définitivement intégré à la société civile, alors que s’amorce une nouvelle entreprise de domestication industrielle. Aujourd’hui donc apparaissent en pleine lumière tant la grandeur que les limites des mouvements passés, qui déterminent toujours les conditions sociales particulières à chaque région de ce monde.
Léopold ROC
Texte paru dans Os Cangaceiros n°3, pp 43-48, juin 1987.
On peut télécharger ce numéro dans la Fanzinotheque.
[1] Cf. l’Incendie millénariste, p.233-258
[2] Un exemple significatif : l’Église travailliste, fondée à Manchester en 1891, eut pour seule fonction d’amener les ouvriers du nord à rejoindre un Parti travailliste indépendant, après quoi elle disparut.
[3] Industrialism & Domestication, Black Eye Press, Berkeley, 1979.
/image%2F1177296%2F20190210%2Fob_18a50d_industrialisme.jpg)
★ Quelle devrait être l'attitude des anarchistes envers la machine ? - Socialisme libertaire
Avant-propos Shmuel Marcus (1893-1985) était l'un des quatorze enfants d'une famille juive orthodoxe de Dorshoi en Roumanie. Emigré aux USA vers 1907, il commença très vite à collaborer à la ...
★ Quelle devrait être l'attitude des anarchistes envers la machine ?
/image%2F1177296%2F20190331%2Fob_0b9ed6_ouvrier-et-machine.jpg)
★ L'ouvrier et la machine - Socialisme libertaire
★ Texte de Ricardo Flores Magon (1916). " Maudite machine ! " peste l'ouvrier, suant à grosse gouttes, las et découragé. "Maudite machine qui m'obliges à suivre ton rythme infernal, comme si,...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2018/02/l-ouvrier-et-la-machine.html
★ L'ouvrier et la machine.
/image%2F1177296%2F20160708%2Fob_f7bed1_luddite.jpg)
★ Les briseurs de machine et le Luddisme - Socialisme libertaire
★ Les briseurs de machine. Il nous est souvent difficile de nous figurer à quel point la Révolution industrielle marqua une rupture dans l'organisation sociale et économique des sociétés ...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/07/les-briseurs-de-machine-et-le-luddisme.html
★ Les briseurs de machine et le Luddisme.
/image%2F1177296%2F20160203%2Fob_4dbd05_le-mythe-777x437.png)
Le mythe de la machine : la pensée de Lewis Mumford - Socialisme libertaire
Lewis Mumford (1895-1990) Critique et historien de l'architecture et de l'urbanisme, Lewis Mumford est né en 1895 près de New York à Flushing (Long Island). Il a fait des études de sociologie ...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/02/le-mythe-de-la-machine-la-pensee-de-lewis-mumford.html
Le mythe de la machine : la pensée de Lewis Mumford.
/image%2F1177296%2F20181214%2Fob_b9e47f_une-croissance-indc3a9finie-est-imposs.jpg)
★ L'homme au service du progrès - Socialisme libertaire
" Après un premier rapport paru en 2001, l'Agence européenne de l'environnement a publié le 23 janvier 2013 un rapport intitulé Signaux précoces et leçons tardives : science, précaution, inn...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/07/l-homme-au-service-du-progres.html
★ L'homme au service du progrès.
/image%2F1177296%2F20190210%2Fob_cf766d_chaplin-tempsmodernes.jpg)
★ La société industrielle : mythe ou réalité ? - Socialisme libertaire
" Le capitalisme ne date pas d'hier. Les formes embryonnaires qu'il a pu prendre remontent à l'Antiquité. Mais le capitalisme industriel, lui, né sous le parrainage de l'État centralisé et dan...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/04/la-societe-industrielle-mythe-ou-realite.html
★ La société industrielle : mythe ou réalité ?
/image%2F1177296%2F20190315%2Fob_df55f3_simone-weil-07.jpg)
Progrès et production - Socialisme libertaire
"Progrès et production", Par Simone Weil (1937). " Nous vivons dans un âge éclairé, qui a secoué les superstitions et les dieux. Il ne reste attaché qu'à quelques divinités qui réclament e...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2017/09/progres-et-production.html
Progrès et production.
/image%2F1177296%2F20190907%2Fob_7ad830_anarchy-alive-anarquismo-uri-gordon-ac.jpg)
★ Contre la croissance infinie - Socialisme libertaire
Uri Gordon (אורי גורדון ), né en 1976, est un théoricien et militant anarchiste israélien. > Texte inédit, en français, pour le site de Ballast " C'est le grand problème de notre é...
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/02/contre-la-croissance-infinie.html
★ Contre la croissance infinie.
/image%2F1177296%2F20160924%2Fob_3cef60_5611e5e319cae687d9feba2c414cfe02-l.jpg)

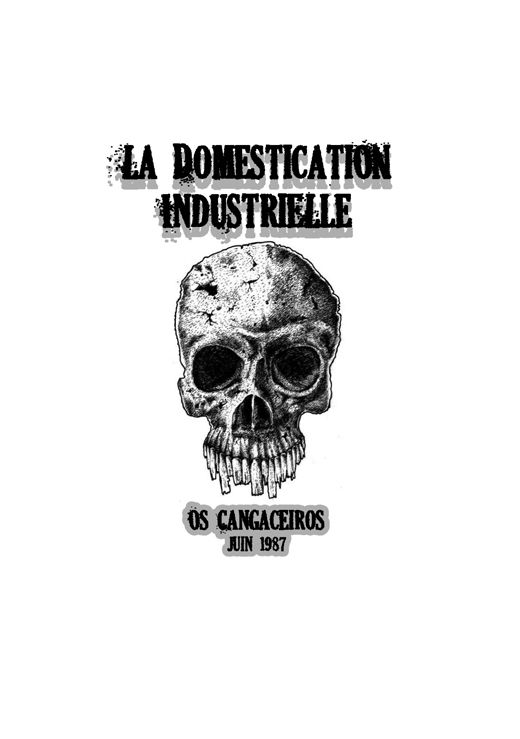


/image%2F1177296%2F20240130%2Fob_edecb9_no-pasaran.jpg)
/image%2F1177296%2F20240329%2Fob_f6b79e_arton93967.jpg)
/image%2F1177296%2F20231004%2Fob_0f9f32_jean-grave.jpg)
/image%2F1177296%2F20231210%2Fob_35fc3e_hanryner01.jpg)
/image%2F1177296%2F20160920%2Fob_970032_ob-8dc177-190px-rb-star-svg.png)
